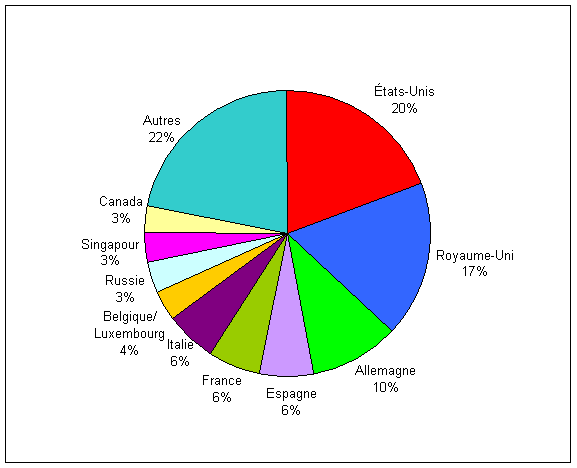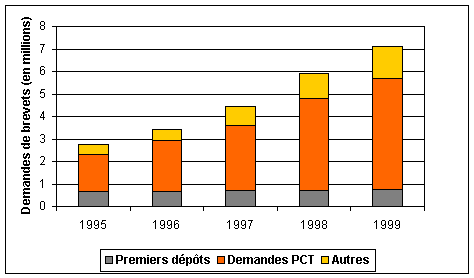Intégrer
les droits de propriété intellectuelle et la
politique de développement
Rapport de la Commission
britannique des droits de propriété intellectuelle
Londres
Septembre 2002
Publié par la
Commission on Intellectual Property
Rights
c/o DFID
1
Palace Street
London SW1E 5HE
Tél. : 00 44 207
023 1732
Télécopieur : 00 44 207 023 0797 (à l'attention de Charles
Clift)
Courrier électronique : ipr@dfid.gov.uk
Site web : http://www.iprcommission.org
Novembre 2002 (2e édition)
Le texte intégral du rapport et le résumé peuvent être
téléchargés du site web de la Commission britannique des droits de propriété
intellectuelle : http://www.iprcommission.org
Pour obtenir une copie papier du rapport ou toute autre information,
s’adresser au Secrétariat de la Commission à l'adresse ci-dessus.
© Commission on Intellectual
Property Rights 2002
Conçu et imprimé par
Dsprint/redesign
7 Jute
Lane
Brimsdown
Enfield EN3 7JL
LES COMMISSAIRES
Professeur
John Barton (Président de la Commission)
Professeur de droit, Université de Stanford, Chaire George
E. Osborne, Californie, Etats-Unis
Daniel Alexander
Avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle,
Londres, Royaume-Uni
Professeur Carlos Correa
Directeur, Programme de magistère sur la politique et la
gestion en matière de science et technologie, Université de Buenos Aires,
Argentine
Ramesh Mashelkar FRS
Directeur général du Conseil indien de la recherche
scientifique et industrielle et Secrétaire au Département de la recherche
scientifique et industrielle, Delhi, Inde
Gill Samuels CBE
Directeur principal de la politique et des questions
scientifiques (Europe), Pfizer Inc., Sandwich, Royaume-Uni
Dr Sandy Thomas
Directeur du Conseil Nuffield sur la bioéthique, Londres,
Royaume-Uni
SECRETARIAT
Charles Clift –
Directeur
Phil Thorpe –
Analyste politique
Tom Pengelly –
Analyste politique
Rob Fitter –
Chargé de recherche
Brian Penny –
Chef de bureau
Carol Oliver –
Secrétaire de direction
PREFACE
Madame Clare Short, ministre
britannique du Développement international, a créé la Commission on Intellectual Property Rights (Commission des droits
de propriété intellectuelle) en mai 2001. Cette Commission est composée de
membres provenant d'une diversité de pays, d'horizons et de perspectives. Nous
avons tous apporté à la Commission nos différents points de vue. Originaires de
pays développés et en développement, nous appartenons au domaine de la science,
du droit, de l'éthique et de l'économie tout autant qu’à l'industrie, aux
organes de l'Etat et au monde universitaire.
Il est tout à fait remarquable à
mon avis que nous soyons parvenus à nous accorder sur autant de points tant en
ce qui concerne notre démarche que nos conclusions générales. Comme l'implique
le titre de notre rapport, nous estimons que les objectifs en matière de
développement doivent être intégrés dans l'élaboration de la politique relative
aux droits de propriété intellectuelle (DPI), tant au plan national
qu’international, et notre rapport expose certaines voies pour y parvenir.
Bien que nous ayons été nommés
par le gouvernement britannique, nous avons été entièrement libres de fixer
notre ordre du jour, d'élaborer notre programme de travail et de rédiger nos
conclusions et recommandations. Les possibilités et le soutien financier
nécessaires nous ont été accordés pour améliorer notre compréhension des
problèmes en question, en commanditant des études, en organisant des ateliers
et des conférences et en allant rendre visite à des fonctionnaires ou à des
groupes intéressés dans le monde entier. Nous avons été assistés dans notre
tâche par un secrétariat hautement compétent mis à notre disposition par le
Department for International Development (DFID) et l’Office britannique des brevets
et nous tenons à le remercier tout spécialement.
Notre première réunion s’est
tenue les 8 et 9 mai 2001 et nous nous sommes depuis réunis à sept autres
reprises. Nous tous, ou certains d'entre nous, avons pu nous rendre au Brésil,
en Chine, en Inde, au Kenya et en Afrique du Sud et nous avons eu des
consultations avec de hauts fonctionnaires, des représentants du secteur privé
et des ONG à Londres, Bruxelles, Genève et Washington. Nous avons visité le
centre de recherche de la société Pfizer à Sandwich. A la fin du rapport figure
la liste des principales institutions que nous avons consultées. Nous avons
commandité dix-sept documents de travail et tenu huit ateliers à Londres sur
divers aspects de la propriété intellectuelle. Nous avons également organisé à
Londres, les 21 et 22 février 2002, une grande conférence pour que nous
puissions entendre des questions et des préoccupations reflétant toute une
variété de perspectives. Ces réunions ont constitué à elles seules une partie
importante de notre travail, car en réunissant tout un ensemble de
personnalités, elles ont facilité le dialogue et permis d'explorer les moyens
de faire progresser certaines des questions en cause.
En notre nom à
tous, je voudrais remercier tous ceux qui, trop nombreux pour être cités ici,
ont de par le monde participé à nos débats et rédigé nos documents de
travail.
Nous avons été chargés
d'examiner :
·
comment concevoir les régimes nationaux
de DPI de telle sorte qu’ils bénéficient aux pays en développement dans le
contexte des accords internationaux, y compris l'Accord sur les ADPIC ;
·
comment le cadre international de
règles et d'accords pourrait être amélioré et développé – par exemple dans le
domaine des savoirs traditionnels – et quels sont les rapports entre les règles
et les régimes en matière de DPI qui couvrent l'accès aux ressources génétiques
;
·
quel cadre politique plus large est
nécessaire pour compléter les régimes de propriété intellectuelle, y compris,
par exemple, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles par le biais de la
politique et du droit de la concurrence.
Nous avons
décidé très tôt de ne pas nous borner à essayer de suggérer des compromis entre
les différents groupes d'intérêt, mais de travailler autant que possible sur la
base d'éléments probants. Cela n'a pas été facile, car ces informations sont
souvent limitées ou peu concluantes. Toutefois, grâce au travail de notre
secrétariat, aux consultations approfondies et aux documents préparés à notre
demande, il nous a été possible d’identifier les éléments probants disponibles,
que nous avons ensuite évalués avec soin.
Très vite nous avons compris qu'il importait d'établir une distinction entre
les pays (à revenu intermédiaire ou faible), selon qu'ils ont ou non des
capacités scientifiques et technologiques importantes. Nous avons cherché à
savoir quelles sont les incidences réelles de la propriété intellectuelle, tant
positives que négatives, dans ces deux catégories de pays. Nous avons toutefois
choisi de concentrer nos efforts sur les préoccupations des populations les
plus pauvres, qu’elles se trouvent dans les pays à faible revenu ou à revenu
intermédiaire.
Tous les
membres de la Commission adhèrent à ce rapport. Notre objectif est de trouver
des solutions pratiques et équilibrées. Dans certains cas, nous avons adopté
des suggestions présentées par d'autres, mais nous sommes seuls responsables
des conclusions. Nous espérons avoir rempli la mission qui nous a été confiée.
Nous espérons également que ce rapport sera utile à tous ceux qui participent
au débat sur la manière dont les droits de propriété intellectuelle pourraient
mieux contribuer au développement et à la réduction de la pauvreté.
Enfin,
j’aimerais remercier Madame Clare Short et le ministère britannique du
Développement international (DFID) d'avoir fait preuve de prévoyance en créant
la Commission des droits de propriété intellectuelle. J'ai eu l'honneur de la
présider, ce qui fut pour moi une expérience extraordinaire. Il en a été de
même pour tous les membres de cette Commission. La tâche qui nous a été confiée
était stimulante et nous avons été heureux de pouvoir tant apprendre les uns
des autres et en particulier de ceux qui ont contribué à nos travaux.
JOHN BARTON
Président
AVANT-PROPOS
Parmi ceux qui
travaillent dans le secteur de la propriété intellectuelle (PI), peu liront le
présent rapport sans trouver au moins un aspect dérangeant. C'est là le plus
grand compliment qu'on puisse faire au professeur Barton et à son équipe de
commissaires. Et rien ne révèle mieux les qualités de prévoyance et de courage
dont a fait preuve Madame Clare Short, ministre britannique du Développement
international, en créant la Commission et en fixant son mandat.
Peut-être
l'époque où nous vivons encourage-t-elle l’adhésion aveugle aux dogmes, ce qui
a une influence sur les horizons les plus divers, et certainement sur tous les
aspects des droits de propriété intellectuelle (DPI). Il existe en effet d’un
côté, celui des pays du monde développé, le lobby puissant de ceux qui croient
que tous les DPI sont bons pour les affaires, avantageux pour le grand public
et catalyseurs du progrès technique. Ils pensent et affirment que si les DPI
sont une bonne chose, plus il y en aura, mieux cela vaudra. Mais de l’autre
côté, celui des pays du monde en développement, s'élèvent de fortes
revendications présentées par ceux qui croient que les DPI risquent de
paralyser le développement des industries et des technologies locales, de nuire
à la population locale et de ne bénéficier qu’au monde développé. Ils pensent
et affirment que si les DPI sont une mauvaise chose, moins il y en aura, mieux
cela vaudra. La mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC n'est pas parvenue à
réduire l'écart entre ces deux visions des choses, mais a plutôt servi à
renforcer les opinions régnantes. Les personnes souhaitant devantage de DPI et
la mise en place de règles de jeu égales pour tous saluent l'Accord sur les
ADPIC comme un instrument utile pour parvenir à leurs objectifs. Par contre,
les personnes qui considèrent les DPI comme nuisibles aux pays en développement
estiment que, déjà avant l'Accord sur les ADPIC, les règles du jeu n’étaient
pas égales pour tous dans le domaine économique et que son introduction a
renforcé les inégalités. Ces opinions sont si profondément ancrées dans les
esprits que parfois on avait l’impression d'un dialogue de sourds où personne
ne voulait écouter l’autre. Persuader, non, contraindre, oui !
Que les DPI
soient une bonne ou mauvaise chose, il a bien fallu que le monde développé s'en
accommode avec le temps. Même les inconvénients des DPI l’emportent parfois sur
leurs avantages, la grande majorité des pays développés disposent de la
puissance économique et des mécanismes juridiques leur permettant de surmonter
les problèmes. Dans la mesure où les avantages l'emportent sur les
inconvénients, les pays développés ont la richesse et les infrastructures
nécessaires pour tirer parti des possibilités offertes. On ne peut
vraisemblablement pas en dire de même pour les pays en développement et les pays
les moins avancés.
C'est dans ce
contexte que la ministre a décidé de créer la Commission pour examiner entre
autres choses comment concevoir les régimes nationaux de DPI de telle sorte
qu'ils bénéficient aux pays en développement. Ce mandat repose sur la
reconnaissance du fait que les DPI peuvent contribuer à favoriser ou à entraver
le développement des économies les plus fragiles. Les membres de la Commission
eux-mêmes représentent un éventail de connaissances spécialisées aussi vaste
qu'on pourrait le souhaiter. Ils ont effectué de nombreuses consultations. Ce
rapport en est le résultat et il est tout à fait impressionnant.
Bien que son
mandat l’ait chargée de se pencher en particulier sur les intérêts des pays en
développement, la Commission y est parvenue sans laisser de côté les intérêts
et les arguments des autres pays. Ainsi qu'elle le déclare, on ne peut pas
exiger des pays en développement qu’ils appliquent des normes de PI plus
rigoureuses sans procéder à une évaluation approfondie et objective de leurs
incidences sur le développement. La Commission a fait tout son possible pour
effectuer une telle évaluation. Il en est résulté un rapport qui présente des
propositions judicieuses conçues pour répondre à la plupart des exigences
raisonnables émanant des deux côtés.
Toutefois,
présenter une série de propositions pratiques n’est pas en soi suffisant. Ce
qui est nécessaire, c'est leur acceptation et la volonté de les mettre en
œuvre. Dans ce domaine aussi, la Commission joue un rôle majeur. Ce rapport
n'est pas celui d'un groupe de pression. La Commission a été créée pour offrir
des conseils aussi impartiaux que possible. Son origine et sa composition
devraient encourager tous ceux à qui le rapport s'adresse à prendre ses
recommandations au sérieux.
Pendant
trop longtemps, les DPI ont été considérés comme bons pour les pays riches et
mauvais pour les pays pauvres. J'espère que le présent rapport montrera que la
réalité n'est pas aussi simple que cela. Les pays pauvres pourraient trouver
les DPI utiles à condition de les adapter aux conditions locales. La Commission
estime que le régime approprié à chaque pays en développement doit être décidé
sur la base de ce qui est le plus propice à son
développement et que la communauté internationale et les gouvernements
de tous les pays doivent s’en souvenir lorsqu'ils prennent leurs décisions.
J'espère très sincèrement que ce rapport les encouragera à agir ainsi.
SIR HUGH
LADDIE
`Juge du Tribunal des
brevets, Haute Cour du Royaume-Uni
TABLE DES MATIERES
LES COMMISSAIRES ii
PREFACE iii
AVANT-PROPOS v
VUE D'ENSEMBLE 1
INTRODUCTION 1
CONTEXTE 2
NOTRE TACHE 7
Chapitre 1 : PROPRIETE
INTELLECTUELLE ET DEVELOPPEMENT 15
INTRODUCTION 15
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA PI 18
Introduction
Brevets
Droit d'auteur
HISTOIRE 23
DONNEES FACTUELLES AU SUJET DES INCIDENCES DE LA PI 27
Contexte
Effet de
redistribution
Croissance et innovation
Commerce et investissement
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 33
Chapitre 2 :
SANTE 39
INTRODUCTION 39
La question
Contexte
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 43
Incitations à la recherche
ACCES DES PAUVRES AUX MEDICAMENTS 47
Fréquence de la délivrance des
brevets
Brevets et prix
Autres facteurs ayant un impact
sur l'accès aux médicaments
CONSEQUENCES EN MATIERE DE
POLITIQUE GENERALE 54
Options de politique nationale
Octroi de licences obligatoires
pour les pays ayant des capacités de
fabrication insuffisantes
Législation dans les pays en
développement
Prorogation Doha pour les pays
les moins avancés
Chapitre 3 : AGRICULTURE
ET RESSOURCES GENETIQUES 76
INTRODUCTION 76
Contexte
Droits de propriété
intellectuelle en agriculture
LES VEGETAUX ET LA PROTECTION DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE 78
Introduction
Recherche et développement
Impact de la protection des
variétés végétales
Impact des brevets
Conclusion
ACCES AUX RESSOURCES PHYTOGENETIQUES ET DROITS DES
AGRICULTEURS 89
Introduction
Droits des agriculteurs
Système multilatéral
Chapitre 4 : SAVOIRS
TRADITIONNELS
ET
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 96
INTRODUCTION 96
SAVOIRS
TRADITIONNELS 97
Contexte
Nature des savoirs traditionnels
et objectif de la protection
Gestion du débat sur les savoirs
traditionnels
Utilisation du système de PI
existant pour protéger et promouvoir les
savoirs traditionnels
Protection sui generis des savoirs traditionnels
Appropriation illicite des
savoirs traditionnels
ACCES ET PARTAGE DES AVANTAGES
109
Contexte
Convention sur la diversité
biologique (CDB)
Divulgation de l'origine
géographique des ressources génétiques dans
les demandes de brevets
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 114
Contexte
Indications
géographiques et Accord sur les ADPIC
Registre multilatéral des
indications géographiques
Impact
économique des indications géographiques
Chapitre 5 : DROIT
D'AUTEUR, LOGICIELS ET INTERNET 122
INTRODUCTION 122
LE DROIT D'AUTEUR EN TANT QUE STIMULANT DE LA CREATION 124
Sociétés de perception
LES REGLES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR PERMETTRONT-ELLES
AUX
PAYS EN DEVELOPPEMENT DE REDUIRE L'ECART DU SAVOIR ? 127
INDUSTRIES DU DROIT D'AUTEUR ET REPRODUCTION D'ŒUVRES
PROTEGEES
129
DROIT D'AUTEUR ET ACCES 132
Matériel éducatif
Bibliothèques
DROIT D'AUTEUR ET LOGICIELS INFORMATIQUES 135
REALISER LE POTENTIEL DE L'INTERNET POUR LE
DEVELOPPEMENT 136
Restrictions technologiques
Chapitre 6 : REFORME
DU BREVET 144
INTRODUCTION 144
ELABORATION DE SYSTEMES DE BREVETS
DANS LES PAYS EN
DEVELOPPEMENT 147
Introduction
Champ des brevets
Normes de brevetabilité
Exceptions aux droits de brevet
Prévision de garde-fous dans la
politique en matière de brevets
Encourager l'innovation nationale
Conclusions
UTILISATION DU SYSTEME DES BREVETS DANS LA RECHERCHE
PUBLIQUE 160
Introduction
Eléments probants des Etats-Unis
Eléments probants des pays en
développement
COMMENT LE SYSTEME DES BREVETS POURRAIT ENTRAVER LA
RECHERCHE ET L'INNOVATION
164
Les questions dans les pays
développés
Intérêt pour les pays en
développement
HARMONISATION INTERNATIONALE DES BREVETS 171
Contexte
Traité de l'OMPI sur le droit
matériel des brevets
Chapitre 7 : CAPACITES
INSTITUTIONNELLES 178
INTRODUCTION 178
ELABORATION DE POLITIQUES ET LEGISLATIONS EN MATIERE DE
PI 178
Elaboration de politiques
intégrées
ADMINISTRATION DES DPI ET INSTITUTIONS COMPETENTES EN LA
MATIERE 182
Introduction
Ressources humaines
Technologies de l'information
EXAMEN, SYTEMES D'ENREGISTREMENT ET ACCORDS DE
COOPERATION
185
Coopération régionale ou
internationale
COUTS ET RECETTES 188
Le coût d'un système de PI
Financer les coûts
SANCTION 190
Sanction dans les pays en
développement
Sanction dans les pays développés
REGLEMENTATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
193
ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 195
Programmes actuels
Evaluer l'impact de l'assistance
technique
Financement supplémentaire de
l'assistance technique
Veiller à l'exécution efficace de
l'assistance technique
Chapitre 8 : L'ARCHITECTURE
INTERNATIONALE 201
INTRODUCTION 201
FIXATION DES NORMES INTERNATIONALES : OMPI ET OMC 202
ACCORD SUR LES ADPIC 206
Aider les pays en développement à
mettre en œuvre l'accord sur les ADPIC
Calendrier de mise en œuvre de
l'Accord sur les ADPIC
LA PI ET LES ACCORDS BILATERAUX ET REGIONAUX 210
PARTICIPATION DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 212
Représentation permanente à
Genève
Délégations d'experts
ROLE DE LA SOCIETE CIVILE
215
FAIRE MIEUX COMPRENDRE LA PI ET LE DEVELOPPEMENT 216
SIGLES 221
GLOSSAIRE 222
REMERCIEMENTS 226
VUE D’ENSEMBLE
INTRODUCTION
Les Objectifs
de développement du millénaire soulignent combien il importe de faire diminuer
la pauvreté et la faim, d’améliorer la santé et l’éducation et d’assurer la
pérennité de l’environnement. C’est pourquoi la communauté internationale s’est
engagée à réduire de moitié le nombre des pauvres d’ici 2015 et s’est également
fixé d’autres objectifs spécifiques associés tels que l’amélioration de la
santé et de l’éducation et la pérennité de l’environnement.
On estime qu’en
1999 près de 1,2 milliard de personnes vivaient avec moins de 1 dollar par jour
et près de 2,8 milliards avec moins de 2 dollars par jour.[1] Environ 65 % de ces
personnes se trouvent en Asie du Sud et de l’Est, et 25 % en Afrique
subsaharienne. On estime que 3 millions de personnes sont décédées à cause du
VIH/SIDA en 2001, 2,3 millions d’entre elles se trouvant en Afrique
subsaharienne.[2]
La tuberculose est responsable de la mort de près de 1,7 million de personnes
dans le monde.[3] Si les tendances actuelles persistent, il y
aura 10,2 millions de nouveaux cas en 2005.[4] Plus de 1 million de décès par an sont en
outre dus au paludisme.[5] En 1999, il y avait encore 120 millions
d’enfants qui n’allaient pas à l’école primaire. C’est en Afrique subsaharienne
que le taux d’inscription (60 %)[6] est actuellement le plus
bas.
Notre tâche
consiste à voir dans quels cas et de quelle manière les droits de propriété
intellectuelle (DPI) pourraient apporter une contribution à l’action entreprise
par la communauté internationale pour atteindre ces objectifs, en particulier
réduire la pauvreté, lutter contre la maladie, améliorer la santé de la mère et
de l’enfant, élargir l’accès à l’éducation et contribuer au développement
durable. Notre tâche consiste également à examiner si ces droits constituent
des obstacles à la réalisation de ces objectifs et, en ce cas, comment il
serait possible de les surmonter.
Certains
soutiennent énergiquement que les DPI sont nécessaires pour stimuler la
croissance économique qui, à son tour, permettra de réduire la pauvreté. En
encourageant l’invention et les nouvelles technologies, ils feront augmenter la
production agricole ou industrielle, encourageront les investissements
intérieurs et extérieurs, faciliteront les transferts de technologie et
amélioreront la disponibilité des médicaments nécessaires pour lutter contre la
maladie. Il n’y a aucune raison, à leur avis, pour qu’un système qui réussit
dans les pays développés ne puisse pas réussir également dans les pays en
développement.
D’autres
avancent l'argument opposé avec la même véhémence. Selon eux, les DPI ne
stimulent guère l’invention dans les pays en développement, en raison,
peut-être, de l'absence des capacités humaines et techniques nécessaires. Ils
ne favorisent pas les travaux de recherche susceptibles de bénéficier aux
populations pauvres, parce que ces dernières n’auront pas les moyens de payer
les produits, si même ils étaient mis au point. Les DPI limitent l’option de
l’apprentissage technologique par imitation. Ils permettent aux sociétés
étrangères de chasser la concurrence intérieure en obtenant une protection par
brevet, et d’approvisionner les marchés par des importations, plutôt que par
des produits de fabrication intérieure. De plus, ils augmentent le coût des
médicaments essentiels et des intrants agricoles, ce qui a des répercussions
particulièrement négatives sur les pauvres et les agriculteurs.
Lorsqu’on
évalue les mérites respectifs de ces arguments opposés, il est important de se
souvenir de l’écart technologique qui sépare les pays développés et les pays en
développement considérés en tant que groupe. Les pays en développement à faible
revenu et à revenu intermédiaire représentent environ 21 % du PIB mondial,[7]
mais moins de 10 % des dépenses mondiales de recherche et développement
(R&D).[8]
Les pays de l’OCDE dépensent beaucoup plus en R&D que le revenu national
total de l’Inde.[9]
Presque sans exception, les pays en développement sont des importateurs nets de
technologie.
Il faut
absolument tenir compte du fait que les pays en développement sont très
différents les uns des autres, pour ce qui est des conditions sociales et
économiques et des capacités technologiques. Plus de 60 % des pauvres du monde
vivent dans des pays disposant de capacités scientifiques et technologiques
importantes, et la grande majorité d’entre eux vivent en Chine et en Inde. On
trouve dans ces deux pays, ainsi que dans d’autres pays en développement plus
petits, des capacités de rang mondial dans certains domaines scientifiques et
technologiques, tels que l’espace, l’énergie nucléaire, l’informatique, les
biotechnologies, les produits pharmaceutiques, l’élaboration de logiciels et
l’aviation.[10] Par contre, 25 % des pauvres vivent en
Afrique subsaharienne (Afrique du Sud non comprise), principalement dans des
pays dotés de capacités techniques relativement faibles.[11]
On estime qu’en 1994 la Chine, l’Inde et l’Amérique latine ont représenté
ensemble près de 9 % des dépenses mondiales consacrées à la recherche, contre
0,5 % seulement pour l’Afrique subsaharienne et quelque 4 % pour les pays en
développement autres que l’Inde et la Chine.[12]
Ainsi, les
pays en développement sont loin de former un tout homogène, fait qui pour être
évident n’en est pas moins souvent oublié. Non seulement leurs capacités
scientifiques et techniques varient, mais aussi leurs structures sociales et
économiques et leurs inégalités de revenu et de richesse. Les causes de la
pauvreté, et par conséquent les politiques pertinentes à mettre en œuvre pour
s'y attaquer, varient donc d'un pays à l'autre. Il en est de même pour les
politiques concernant les DPI. Les politiques nécessaires dans les pays
disposant de capacités technologiques relativement avancées, où vivent la
plupart des pauvres, en Inde ou en Chine par exemple, pourront être différentes
de celles requises dans les pays où ces capacités sont faibles, comme dans la
plus grande partie de l’Afrique subsaharienne. L’impact des politiques en
matière de PI sur les populations pauvres variera également selon les
circonstances socio-économiques. Ce qui réussit bien en Inde ne réussira pas
forcément au Brésil ou au Botswana.
CONTEXTE
Au cours de ces vingt dernières
années environ, on a constaté une augmentation sans précédent du niveau, de la
portée, de l’étendue territoriale et du rôle de la protection des DPI ,[13]
ce qui s’est manifesté par :
·
La délivrance de brevets sur les
organismes vivants et les matières vivantes trouvés dans la nature, par
opposition aux produits et procédés issus de l’activité humaine plus facilement
reconnaissables en tant qu’inventions par le non‑initié
·
La modification, afin de prendre en
compte les nouvelles technologies (notamment les biotechnologies et les
technologies de l’information), des régimes de protection tels que la directive
de l’UE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques[14]
ou la loi du millénaire sur le droit d'auteur numérique (Digital Millennium Copyright Act - DMCA) aux Etats-Unis
·
L’extension de la protection à de
nouveaux domaines comme les logiciels et les méthodes commerciales, et
l’adoption dans certains pays de nouveaux régimes sui generis pour les semi-conducteurs et les bases de données
·
Une nouvelle importance accordée à la
protection des nouveaux savoirs et des nouvelles technologies issues du secteur
public
·
L’intérêt porté aux liens entre la
protection de la PI et les savoirs traditionnels,[15]
le folklore et les ressources génétiques
·
L’extension géographique des normes
minimales de protection de la PI par l’intermédiaire de l’Accord sur les ADPIC
(voir Encadré O.1) et des normes plus élevées par le biais des accords
bilatéraux et régionaux sur le commerce et l’investissement
·
L’élargissement des droits exclusifs,
l’extension de la durée de la protection et le renforcement des mécanismes
d’application.
Encadré O.1 L’Organisation mondiale du
commerce et l’Accord sur les ADPIC
L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)[16] est issu du cycle
d’Uruguay de négociations commerciales qui s’est achevé en 1994. L’acte final
de ces négociations a créé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et fixé
des règles – les Accords de l’OMC, y
compris l’Accord sur les ADPIC – que les membres de l’OMC doivent appliquer. Le
système de règlement des différends a également été réorganisé afin de résoudre
les différends en matière de commerce entre membres de l’OMC. Depuis le mois de
janvier de cette année, l’OMC se compose de 144 membres, lesquels effectuent
plus de 90 % des échanges mondiaux. Plus de 30 autres pays négocient
actuellement leur adhésion.
L’Accord sur les ADPIC stipule que tous les membres de l'OMC
doivent prévoir des normes minimales de protection pour une large gamme de DPI,
notamment le droit d’auteur, les brevets, les marques de fabrique ou de
commerce, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques,
les topographies de semi-conducteurs et les renseignements non divulgués. Pour
y parvenir, l’Accord sur les ADPIC incorpore des dispositions figurant dans de
nombreux accords internationaux pertinents en matière de PI, comme les
Conventions de Paris et de Berne gérées par l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI). Toutefois, cet Accord institue plusieurs
obligations nouvelles, notamment en ce qui concerne les indications
géographiques, les brevets, les secrets d’affaires et les mesures relatives aux
moyens de faire respecter les DPI.
Un organisme spécial, le Conseil des aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (habituellement appelé
Conseil des ADPIC) auquel tous les membres de l’OMC sont représentés, a été
créé pour gérer le fonctionnement de l'Accord sur les ADPIC. Le Conseil des
ADPIC est responsable du réexamen de divers aspects de l'Accord sur les ADPIC,
conformément à la mission qui lui est confiée par l'Accord lui-même et aux
instructions de la Conférence ministérielle biennale de l'OMC.
Les questions posées par l'Accord sur les ADPIC qui ont
provoqué les débats les plus nombreux sont notamment :
·
la
question de savoir s’il est possible d’atteindre l’objectif de l’article 7, aux
termes duquel les DPI devraient contribuer au transfert de technologie, en
particulier en ce qui concerne les pays en développement membres de
l’OMC ;
·
les
tensions perçues entre l’article 8, qui permet aux pays d’adopter les mesures
nécessaires à la protection de la santé publique et à la prévention de l'usage
abusif des DPI, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions
de l’Accord sur les ADPIC, et d’autres prescriptions de l’Accord. Il s’agit
notamment de celles qui portent sur la fourniture d’une protection par brevet
des produits pharmaceutiques, sur les limites apportées aux conditions d'octroi
de licences obligatoires (article 31) et sur la portée des dispositions
concernant des exceptions aux droits conférés par des brevets (article
30) ;
·
la
prescription concernant la protection des données résultant d’essais contre
« l’exploitation déloyale dans le commerce » de l’article
39 ;
·
la
justification concernant la fourniture d’une protection additionnelle des
indications géographiques pour les vins et les spiritueux, (article 23) et la
question de savoir si cette protection additionnelle devrait également être
étendue à d’autres ou à toutes les indications géographiques ;
·
dans quelle mesure des brevets devraient être octroyés
pour des inventions relatives à des organismes vivants, par exemple les
micro-organismes (article 27.3 b)), et la prescription relative à la fourniture
d’une protection de la PI pour les végétaux. La question de la compatibilité de
l’Accord sur les ADPIC avec des accords comme la Convention sur la diversité
biologique (CDB) a été abordée dans ce contexte ;
·
le
coût que représente pour de nombreux pays en développement et pays les moins
avancés membres de l’OMC la mise en œuvre des prescriptions de l’Accord sur les
ADPIC pour ce qui est de l’administration des DPI et des moyens nécessaires à
leur respect effectif.
L’Accord sur les ADPIC est entré en vigueur le 1er
janvier 1995. Les membres de l’OMC considérés comme pays développés avaient
devant eux une année pour s'y conformer, alors que les pays en développement et
les économies en transition avaient jusqu’au 1er janvier 2000, sauf
en ce qui concerne les pays en développement ayant besoin d’étendre la
protection par brevet à des produits dans de nouveaux domaines comme les
produits pharmaceutiques, qui ont bénéficié de cinq années supplémentaires pour
l’introduction d’une telle protection. Les pays les moins avancés (PMA)[17] devraient pouvoir
appliquer les dispositions de l’Accord sur les ADPIC d’ici 2006, bien que la
Déclaration ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé
publique leur ait donné dix années supplémentaires pour les produits
pharmaceutiques.
Lorsque certains différends surgissent à propos de
l’interprétation des dispositions de l’Accord sur les ADPIC et leur mise en
œuvre dans la législation nationale, les membres peuvent saisir l’Organe de
règlement des différends (ORD) de l’OMC pour trouver une solution. Jusqu’à
présent, il y a eu 24 affaires concernant les ADPIC pour lesquelles il a été
nécessaire d’entamer une procédure de règlement des différends. Vingt-trois cas
ont été déférés par des pays développés et une affaire par le Brésil. Seize
différends impliquaient des pays développés, sept ont été déférés par des pays
développés contre des pays en développement, et une affaire a été déférée par le
Brésil contre les Etats-Unis. Dix des affaires sur vingt-quatre ont été réglées
par accord mutuel, sept ont été jugées par des groupes spéciaux créés dans le
cadre de la procédure, et sept attendent d’être jugées.
Les inquiétudes provoquées par le
fonctionnement du système de propriété intellectuelle et par l’extension des
DPI ne se limitent pas à leur mise en œuvre par les pays en développement. Deux
enquêtes majeures sur cette question importante se déroulent actuellement aux
Etats-Unis, l’une effectuée par les Académies nationales de la science et
l’autre par le ministère de la Justice et la Commission fédérale du commerce.[18]
Ces inquiétudes sont suscitées par l’augmentation rapide des demandes de
brevets aux Etats-Unis au cours de ces dernières années (de plus de 50 % au
cours des cinq dernières années) et par l'impression qu’à l’heure actuelle sont
délivrés bien davantage de brevets de « moindre qualité » et de portée
plus large. On craint généralement qu’un trop grand nombre de brevets aient été
et continuent à être délivrés au titre d’évolutions d’importance mineure. Par
exemple, dans l’industrie pharmaceutique, cela peut entraîner une prolongation
des monopoles concernant d’importantes thérapies. Des brevets peuvent également
être délivrés dans certains domaines de compétence pour des matières
biologiques parce qu’elles ont été isolées de la nature, si une fonction ou
utilisation possible peut être identifiée. Ce qui est préoccupant, et fait
l’objet d’un débat approfondi à l’heure actuelle, c’est de savoir dans quelle
mesure ces pratiques ont un effet sur la concurrence en rendant plus difficile
la vente de produits concurrents par les inventeurs rivaux, ou en augmentant le
prix du produit pour le consommateur. De même, on examine attentivement leur effet
sur la recherche, en particulier dans le domaine des logiciels et des
biotechnologies, là où les brevets déposés et délivrés à un stade très précoce
du processus de recherche peuvent entraver les travaux de recherche effectués
en aval et la commercialisation ultérieure.
Dans un article riche en idées
nouvelles, le biologiste Garrett Hardin[19]
a inventé l’expression « tragédie des communs » pour expliquer
comment les ressources communes tendaient à être trop utilisées en l’absence de
règles applicables à leur utilisation. La prolifération des DPI, notamment dans
des domaines comme la recherche biomédicale, laisse entrevoir la possibilité
d’une « tragédie différente, celle des « anti-communs », dans
lesquels une population sous‑utilise des ressources rares parce qu’un
trop grand nombre de propriétaires peuvent se gêner les uns les autres … une
augmentation des droits de propriété intellectuelle peut conduire de manière
paradoxale à réduire le nombre des produits utiles à l’amélioration de la santé
humaine ».[20]
Maintenant, les entreprises peuvent avoir à faire face à un coût considérable
en temps et en argent pour décider comment entreprendre des recherches sans
porter atteinte aux droits de brevet d'autres entreprises, ou pour défendre
leurs propres droits de brevet contre d’autres entreprises. Il faut alors se
demander si les coûts élevés de la recherche, de l’analyse et des procédures
judiciaires en matière de brevets représentent le prix à payer pour obtenir les
avantages qu’offre le système des brevets, ou bien s’il existe des moyens de
réduire ces coûts.
Ces questions ne se posent pas
simplement pour les brevets. Aux Etats-Unis, la durée du droit d’auteur a été
prolongée au cours du siècle dernier de 28 ans (renouvelable pour 28 années
supplémentaires), en vertu de la loi de 1909 sur le droit d’auteur, à 70 ans
après la mort de l’auteur, ou 95 ans à partir de la publication (ce qui
correspond à la pratique européenne). Il s’agit de savoir ici si cette
extension de la protection peut en toute crédibilité être considérée comme
renforçant les incitations à la création future, ou si elle servira plutôt à
accroître la valeur des créations existantes. En 1998, le Congrès a adopté la
loi du millénaire sur le droit d’auteur numérique (DMCA) qui interdit notamment
le contournement de dispositifs de protection technologique (cryptage, par
exemple). En Europe, la directive sur
les bases de données prévoit que tous les Etats membres doivent fournir une
protection sui generis à toute
compilation de données organisées de manière systématique, que les données
elles-mêmes soient originales ou non. Jusqu’à présent, les Etats-Unis n’ont pas
adopté cette règle. Mais de plus en plus, on se demande si, sous l’influence de
pressions commerciales tenant compte de manière insuffisante des considérations
d’intérêt général, la protection n’est pas accordée dans le but de protéger la
valeur des investissements plutôt que de stimuler l’invention ou la création.
Ces
préoccupations quant à l'impact de la PI aux Etats-Unis et dans d’autres pays
développés sont, à notre avis, également importantes pour les pays en
développement. Toutefois, nous estimons que le coût de la mise en place du
« mauvais » système de PI sera probablement beaucoup plus élevé dans
un pays en développement que dans les pays développés. Ces derniers disposent
pour la plupart de systèmes complexes de réglementation de la concurrence
permettant de veiller à ce que les abus de tout droit de monopole ne puissent
avoir de trop fortes répercussions sur l’intérêt général. Aux Etats-Unis et
dans l’UE par exemple, ces régimes sont particulièrement solides et bien
établis. C’est loin d’être le cas dans la plupart des pays en développement,
qui sont par conséquent particulièrement à la merci de systèmes de PI
inadéquats. Nous estimons que les pays en développement peuvent essayer de
tirer des enseignements de l’expérience des pays développés lorsqu’ils
élaborent leur propre système de PI adapté à leur système juridique et à leur
situation économique.
En
plus des incidences que peuvent avoir les règles de PI locales à l’intérieur
d’un pays en développement, il en existe d’autres, indirectes celles-là, qui
proviennent du système de PI des pays développés. A l’ère numérique, les
restrictions à l’accès aux documents et aux données sur l’Internet affectent
tout le monde. Il est possible que les scientifiques des pays en développement,
par exemple, soient empêchés d’avoir accès à des données protégées ou ne
disposent pas de ressources suffisantes pour le faire. La recherche sur des maladies
importantes ou de nouvelles cultures intéressant directement les pays en
développement, mais entreprise dans les pays développés, peut être entravée ou
stimulée par le système de PI. Le régime de PI des pays développés peut fournir
des incitations puissantes pour entamer des travaux de recherche spécifiques
susceptibles de procurer des avantages principalement aux populations des pays
développés, détournant ainsi certaines ressources intellectuelles de travaux
qui porteraient sur des problèmes d’importance mondiale. Il est possible en
pratique dans les pays développés de délivrer des brevets pour des savoirs ou
des ressources génétiques provenant de pays en développement sans que soient
prises au préalable des dispositions concernant le partage des avantages tirés
de leur commercialisation. Dans certains cas, il existe des restrictions aux
exportations des pays en développement vers les pays développés découlant d’une
telle protection.
Pour les pays
en développement, la tendance à l’harmonisation mondiale de la protection de la
PI est également importante. Le mouvement vers cette harmonisation n’est pas
nouveau ; il existe depuis plus de 100 ans. Toutefois, l’Accord sur les ADPIC,
entré en vigueur en 1995 sous réserve de périodes de transition spécifiques
(voir Encadré O.1), a rendu obligatoire pour les membres de l’OMC
l’instauration de normes minimales de protection de la PI. Mais il ne constitue
qu’un élément de cette harmonisation internationale. Les discussions se
poursuivent au sein de l’OMPI pour harmoniser plus encore le système des
brevets, ce qui pourrait même supplanter l’Accord sur les ADPIC. De plus, des
accords bilatéraux ou régionaux sur le commerce et l’investissement conclus
entre pays développés et pays en développement comportent souvent des
engagements mutuels concernant la mise en œuvre de régimes de PI qui vont
au-delà des normes minimales prévues par l’Accord sur les ADPIC. Par
conséquent, une pression continue est exercée sur les pays en développement
pour qu'ils renforcent la protection de la PI dans leur propre régime en
suivant les normes en vigueur dans les pays développés.
Nous avons
également été frappés par la nature peu satisfaisante et discutable d’une
grande partie des travaux de recherche économique visant à élucider les
incidences des DPI, même en ce qui concerne le monde développé. Les
incertitudes sont nombreuses et, étant donné la nature du sujet, elles risquent
de le rester. Les incidences des DPI dépendent très souvent de circonstances et
de contextes particuliers. C’est pourquoi de nombreux observateurs
universitaires prennent grand soin de rester dans l’ambivalence lorsqu’il
s’agit de déterminer si les avantages sociaux des DPI l’emportent sur leurs
coûts. Un exemple typique est la réflexion suivante :
« Il est presque impossible
d’imaginer une institution sociale existante quelconque {le système des
brevets} qui soit aussi défectueuse dans autant de domaines. Elle survit
uniquement parce qu’il n’y a pas de meilleure alternative. »[21]
Dans le cas
des pays en développement, plusieurs rapports récents émanant d’institutions
internationales ont présenté des réflexions sur les incidences probables d’une
mondialisation de la protection de la PI sur les pays en développement.[22]
Tous ces rapports font état à des degrés divers d’une inquiétude concernant
l’importance des frais éventuels à encourir, tout en soulignant que, pour de
nombreux pays, les avantages sont beaucoup moins faciles à identifier.
NOTRE TACHE
La création de notre Commission
montre à nos yeux que le gouvernement britannique est sensible à ces
préoccupations. Notre tâche fondamentale consiste donc à examiner si les règles
et institutions de protection de la PI, telles qu’elles ont évolué jusqu’à
présent, peuvent contribuer au développement et à la réduction de la pauvreté
dans les pays en développement.
Nous sommes partis de l’idée
qu’une certaine protection de la PI conviendra probablement à un certain stade
aux pays en développement, comme cela est arrivé dans le passé pour les pays
développés. Il n’y a aucun doute que cette protection peut apporter beaucoup à
la recherche et à l’innovation dans les pays développés, notamment en ce qui
concerne les industries pharmaceutique et chimique. Ce système fournit aux
personnes et aux entreprises des incitations à l’innovation et à la mise au
point de nouvelles technologies susceptibles de servir les intérêts de la
société. Mais ces incitations opèrent différemment selon que la capacité d’y
répondre existe ou n’existe pas. Et le fait de conférer des droits exclusifs
impose des coûts aux consommateurs et autres utilisateurs de technologies
protégées. Dans certains cas, protéger signifie que des consommateurs ou
utilisateurs éventuels, dans l’incapacité de payer le prix demandé par les
titulaires des DPI, sont privés de l’accès aux innovations que le système de PI
vise à mettre à la disposition de tous. L’équilibrage entre les coûts et les
avantages variera selon les modalités d’application des droits et selon les
circonstances économiques et sociales. Les normes de protection de la PI
susceptibles de convenir aux pays développés peuvent entraîner des coûts
supérieurs aux avantages lorsqu’elles sont appliquées dans des pays en
développement qui doivent faire en grande partie appel à des connaissances ou à
des produits utilisant des savoirs créés ailleurs pour répondre à leurs besoins
fondamentaux et pour favoriser leur développement.
Nature
des droits de propriété intellectuelle
Certains considèrent que les DPI
sont principalement des droits économiques ou commerciaux, alors que d’autres
pensent qu’ils se rapprochent plutôt des droits politiques ou des droits de
l’homme. L’Accord sur les ADPIC leur attribue ce premier sens tout en
reconnaissant qu’il est nécessaire de trouver un équilibre entre les droits des
inventeurs et des créateurs à une protection, et les droits des utilisateurs de
la technologie (article 7 de l’Accord sur les ADPIC). La Déclaration
universelle des droits de l’homme présente une définition plus large
reconnaissant que « chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l’auteur », ceci étant
contrebalancé par le « droit ... de participer au progrès scientifique et
aux bienfaits qui en résultent ».[23]
La question principale consiste à concilier un intérêt général, celui qui
consiste à avoir accès au nouveau savoir et au produit de ce nouveau savoir,
avec un autre intérêt général, celui qui consiste à stimuler l’invention et la
création dont proviennent les nouveaux savoirs et les nouveaux produits dont
dépendent les progrès matériel et culturel.
La difficulté provient de ce que
le système de PI cherche à concilier ces deux intérêts en conférant un droit
privé et des avantages matériels privés. Ainsi, le droit (humain) à la
protection des « intérêts moraux et matériels » des
« auteurs » est inexorablement lié au droit de « participer aux
bienfaits » matériels privés qui résultent de cette protection. Et
l’avantage privé que retire le créateur ou l’inventeur est acquis aux dépens du
consommateur. Lorsque le consommateur est pauvre en particulier, ceci peut
entrer en conflit avec certains droits de l’homme fondamentaux, par exemple le
droit à la vie. Et le système de PI, tel qu’il est présenté dans l’Accord sur
les ADPIC, ne permet pas de faire de distinction, sauf dans des cas extrêmement
limités, entre les biens essentiels à la vie ou à l’éducation, et d’autres
biens, tels que les films ou la restauration rapide.
C’est pourquoi nous estimons que
les DPI devraient être considérés comme l’un des moyens permettant aux pays et
aux sociétés d'aider à promouvoir la réalisation des droits économiques et
sociaux. En particulier, en aucune circonstance, les droits de l’homme les plus
fondamentaux ne doivent être subordonnés aux exigences de la protection de la
PI. Les DPI sont accordés par les Etats pour des périodes limitées (tout au
moins dans le cas des brevets et du droit d’auteur), alors que les droits de
l’homme sont inaliénables et universels.[24]
Généralement,
les DPI sont considérés aujourd'hui comme des droits économiques et
commerciaux, comme c’est le cas dans l’Accord sur les ADPIC, et sont détenus
plus souvent par des entreprises que par des inventeurs particuliers. Mais le
fait de les décrire comme des « droits » ne devrait pas occulter les
réels dilemmes de leur application dans les pays en développement, là où les
coûts supplémentaires qu’ils engendrent peuvent mobiliser certains fonds au
détriment du financement des éléments essentiels à la vie des populations
pauvres.
Indépendamment du terme utilisé,
nous préférons considérer que les DPI sont des instruments de politique
publique qui confèrent des privilèges
économiques à des personnes ou à des institutions dans le seul but d’accroître
le bien-être général. Ce privilège
est par conséquent un moyen en vue d’un objectif, et non pas un objectif en
soi.
Par conséquent, pour apprécier la
valeur de la protection de la PI, on pourrait la comparer à la fiscalité.
Pratiquement personne n’affirme que plus il y a d’impôts, mieux cela vaut.
Toutefois, certains ont tendance à considérer que l’extension de la protection
de la PI est une bonne chose qui va de soi. Une augmentation de la fiscalité
pourrait être souhaitable si elle permettait d’assurer des services auxquels la
société attache plus d'importance que le coût direct et indirect de la
fiscalité. Mais moins d’impôts peut également être bénéfique, par exemple si
une fiscalité excessive nuit à la croissance économique. En outre, les
économistes et les hommes politiques passent de longs moments à examiner si la
structure de la fiscalité est optimale. Les prélèvements de sécurité sociale
élevés nuisent-ils à l’emploi ? Certains allégements fiscaux
atteignent-ils leur objectif, ou ne sont-ils qu’un moyen de subventionner leurs
bénéficiaires pour continuer à faire ce qu’ils font déjà ? L’effet de la
fiscalité sur la répartition des revenus est-il souhaitable du point de vue
social ?
Nous pensons que l’on pourrait
poser des questions très analogues pour la propriété intellectuelle. Quelle est
son ampleur optimale ? Comment doit-elle être structurée ? Comment cette
structure optimale doit-elle varier selon les secteurs et les niveaux de
développement ? De plus, même si nous arrivons au bon niveau et à la bonne
structure de protection, il nous faudra, pour trouver le bon équilibre entre
les incitations à l’invention et à la création, et les coûts que cela
représente pour la société, nous préoccuper de la répartition des avantages.
Partage
équitable des avantages et des coûts
La protection de la propriété
intellectuelle a pour immédiate conséquence d’apporter un avantage financier à
ceux qui détiennent le savoir et le pouvoir d’inventer, et d’augmenter les
coûts de l’accès pour ceux qui en sont dépourvus. Ceci a par conséquent une
importance lorsqu’il s’agit de répartir les avantages entre les sociétés
développées et les sociétés en développement. Même si une extension de la
protection entraîne des avantages de nature économique pour le monde dans son
ensemble, ce qui n’est pas admis par tout le monde, il est possible que les
répercussions sur la répartition des revenus ne soient pas conformes à notre
sens de l’équité. La majorité des pays en développement, possédant des
infrastructures scientifiques et techniques faibles, ne gagnera pas grand-chose
en matière d’encouragement à l’innovation intérieure, mais elle devra néanmoins
assumer le coût de la protection de technologies (principalement étrangères).
Par conséquent, il est fort possible que les coûts et les avantages du système
dans son ensemble ne soient pas équitablement répartis.
Bien que la plupart des pays en
développement n'aient pas de base technologique solide susceptible de tirer
parti d’une protection de la PI, ils disposent de ressources génétiques et de
savoirs traditionnels qui ont une valeur pour eux-mêmes et pour tout le monde.
Il ne s’agit pas nécessairement de ressources de PI dans le sens où on l’entend
dans les pays développés, mais ce sont certainement des ressources sur la base desquelles
il est possible d’instaurer une protection de la propriété intellectuelle, ce
qui a été fait dans le passé. Il se pose alors un certain nombre de questions
difficiles : ces ressources devraient-elles interagir avec le système
« moderne » de PI, et vice-versa, et comment ? Quelle valeur ce
système devrait-il leur accorder ? Dans quelle mesure ces ressources et
ces savoirs nécessitent-ils une protection (pas seulement sous l'angle de la
PI) ? Comment partager équitablement les avantages commerciaux tirés de
ces ressources ?
L’Internet
offre également d’énormes possibilités d’accès à l’information nécessaire aux
pays en développement, notamment aux scientifiques et aux chercheurs, qui,
peut-être par manque de ressources, n’ont pas accès aux médias imprimés. Mais
on se demande si certaines formes de cryptage (ou « gestion des droits
numériques »), conçues pour empêcher la réalisation de copies à grande
échelle, ne vont pas rendre ce matériel moins accessible que ne le sont
actuellement les médias imprimés. De telles tendances mettent en danger le
concept d'« utilisation équitable »[25] (et autres doctrines
similaires), tel qu’il est appliqué actuellement aux œuvres imprimées, et
pourraient, poussées à l’extrême, fournir l’équivalent d’une protection
perpétuelle du droit d’auteur, par des moyens technologiques plutôt que
juridiques.
Comment mettre au point une politique en matière
de propriété intellectuelle ?
Etant donné l’incertitude et les
controverses considérables qui entourent les incidences mondiales des DPI, nous
pensons qu’il appartient aux décideurs d’examiner les éléments probants
disponibles, même s'ils sont imparfaits, avant d’accroître plus encore la
portée ou l’étendue territoriale de ces droits.
Trop souvent,
l'évolution de la politique en matière de PI est dominée par les intérêts des
« producteurs », tandis que ceux des consommateurs ne sont ni
entendus, ni pris en compte. Il s'ensuit que la politique tend à être
déterminée davantage par les intérêts des utilisateurs commerciaux du système
plutôt que par une conception impartiale du meilleur intérêt général. Dans les
débats concernant les DPI entre les pays développés et en développement, le
même déséquilibre existe. Les ministères du commerce des pays développés sont
principalement influencés par les intérêts des producteurs qui voient les
avantages qu’ils peuvent retirer d’une meilleure protection de la PI dans les
marchés d’exportation, alors que les pays consommateurs, c’est-à-dire
principalement les pays en développement, ne peuvent pas aussi facilement
identifier et défendre leurs propres intérêts contre ceux des pays développés.
Nous
reconnaissons par conséquent que les règles et les pratiques en matière de PI,
et la manière dont elles évoluent, sont issues de l’économie politique. Les
pays en développement, et en particulier les consommateurs pauvres de produits
susceptibles d’être protégés par des DPI, négocient depuis une position de
relative faiblesse. On constate une asymétrie fondamentale dans les rapports
entre pays développés et en développement, fondée finalement sur leurs
puissances économiques relatives.
Les négociations sur l’Accord sur les ADPIC dans
le cadre du Cycle d’Uruguay en sont un excellent exemple. Les pays en
développement ont accepté l’Accord sur les ADPIC non pas parce qu’à ce moment‑là
l’adoption d’une protection de la propriété intellectuelle était en tête de
leur liste de priorités, mais en partie parce qu’ils pensaient que l’ensemble
des mesures offertes serait avantageux, y compris la réduction du
protectionnisme commercial des pays développés. A l’heure actuelle, une grande
partie d’entre eux ont le sentiment que les engagements pris par les pays
développés pour libéraliser l’agriculture et les textiles et réduire les droits
de douane n’ont pas été honorés, et ils ont dû supporter le poids de l’Accord
sur les ADPIC. L’accord qui s’est fait l’année dernière à Doha à propos d’un
nouveau cycle de « développement » OMC reconnaît que cette
négociation entre pays développés et pays en développement doit être rendue
plus explicite et plus constructive.
Ici, les pays en développement
sont confrontés à une difficulté en ce sens qu'ils sont de « nouveaux arrivants
» dans un monde qui a été façonné par les « premiers arrivés », et ce
monde est très différent de celui dans lequel les « premiers
arrivés » ont mis au point leur politique. C’est un lieu commun de répéter
que nous vivons à l’ère de la mondialisation, impliquant une économie de plus
en plus intégrée. Pour la communauté internationale, c’est un article de foi de
considérer qu’une intégration respectant certaines conditions dans l’économie
mondiale est un impératif pour le développement. La question est, à notre avis,
de savoir quelles sont les conditions qui conviennent à cette intégration dans
le domaine des DPI. De même que les pays maintenant développés ont façonné un
régime de PI adapté à leurs circonstances économiques, sociales et
technologiques particulières, de même les pays en développement devraient en
principe être maintenant en mesure de faire pareillement.
Nous concluons par conséquent
qu’une attention plus poussée doit être apportée aux besoins des pays en
développement lors de l’élaboration d’une politique internationale de PI.
Conformément aux décisions récentes prises par la communauté internationale à
Doha et à Monterrey, les objectifs de développement doivent être intégrés à
l’élaboration des règles et des pratiques en matière de PI. A Monterrey en mars
2002, les gouvernements ont salué « les décisions de l’Organisation mondiale du
commerce de placer les besoins et les intérêts des pays en développement au
centre de son programme de travail ». Ils ont également admis les
préoccupations des pays en développement, notamment :
« la non‑reconnaissance des droits de
la propriété intellectuelle en vue de la protection du patrimoine et du
folklore traditionnels ; le transfert des connaissances et des technologies ;
l’application et l’interprétation de l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce de manière conforme aux
intérêts de la santé publique… »[26]
Nous pensons qu’il s’agit là d’un
programme satisfaisant mais partiel. Il faut réfléchir beaucoup plus loin et
agir davantage lorsque l’on étudie les incidences du système actuel sur les pays
en développement. Nous pensons que les systèmes de propriété intellectuelle
peuvent, si nous n’y prêtons pas attention, introduire des distorsions qui
nuisent aux intérêts des pays en développement. Il est possible que des normes
de protection très « élevées » soient favorables à l’intérêt général dans les
pays développés dotés d’infrastructures scientifiques et technologiques très
complexes (bien que nous fassions remarquer, comme plus haut, que c’est une
question discutable sous plusieurs aspects), mais ceci ne signifie pas que les
mêmes normes conviennent à tous les pays en développement. En fait, nous
estimons que les pays développés devraient se soucier davantage de concilier
leurs propres intérêts commerciaux, tels qu’ils les perçoivent, avec leur propre
intérêt dans le domaine de la réduction de la pauvreté dans les pays en
développement.
Pour parvenir à cet objectif, les
pays en développement ne devraient, autant que possible, pas être privés de la
souplesse nécessaire à l’élaboration des systèmes de PI dont les pays
développés ont bénéficié aux premiers stades de leur développement. Il ne faut
pas leur imposer un relèvement du niveau des normes de PI sans effectuer une
évaluation approfondie et objective des incidences de ces dernières sur le développement.
Nous devons nous assurer que les systèmes mondiaux de PI évoluent de manière à
contribuer au développement des pays en développement, en stimulant les
innovations et les transferts de technologie qui leur sont utiles, tout en
mettant à leur disposition les produits issus de ces technologies aux prix les
plus compétitifs possibles. Nous devons faire en sorte que le système de PI
facilite, au lieu de gêner, l’application des progrès rapides réalisés en
science et en technologie, afin qu’ils servent les intérêts des pays en
développement.
Nous espérons que notre rapport
contribuera à l'élaboration d’un agenda visant à ce que le système mondial des
DPI, et les institutions au sein de ce système, donnent de meilleurs résultats
pour les populations pauvres et les pays en développement.
Nous avons dégagé un certain
nombre de problèmes clés pour les pays en développement que nous allons aborder
dans les chapitres suivants :
·
Que nous enseignent les données
factuelles économiques et empiriques sur les incidences de la PI dans les pays
en développement ? L’expérience acquise dans le passé par les pays développés
contient-elle des enseignements aujourd’hui pour les pays en développement?
Comment le transfert de technologie vers les pays en développement peut-il être
facilité ? (Chapitre 1)
·
Comment le système de PI favorise-t-il
la mise au point des médicaments qui sont nécessaires aux populations pauvres ?
Quel est son impact sur l’accès des pauvres aux médicaments et sur leur
disponibilité ? Qu’est-ce que cela implique pour les règles et les pratiques en
matière de PI ? (Chapitre 2)
·
La protection de la PI sur les végétaux
et les ressources génétiques peut-elle avantager les pays en développement et
les populations pauvres ? Quels systèmes les pays en développement
devraient-ils envisager pour protéger les variétés végétales tout en
sauvegardant les droits des agriculteurs ? (Chapitre 3)
·
Comment le système de PI pourrait-il
contribuer aux principes d’accès et de partage des avantages qui sont consacrés
dans la Convention sur la diversité biologique (CDB) ? Peut-il aider à protéger
ou à promouvoir les savoirs traditionnels, la biodiversité et les expressions
culturelles ? L’extension des indications géographiques[27]
(IG) peut-elle profiter aux pays en développement ? (Chapitre 4)
·
De quelle manière la protection du
droit d’auteur influe-t-elle sur l’accès des pays en développement au savoir,
aux technologies et aux informations dont ils ont besoin ? La PI ou la
protection technologique auront-elles un effet sur l’accès à l’Internet ?
Comment le droit d’auteur peut-il être utilisé pour apporter un soutien aux
industries créatives des pays en développement ? (Chapitre 5)
·
Comment
les pays en développement devraient-ils élaborer leur législation et leur
pratique en matière de brevets ? Les pays en développement peuvent-ils formuler
leur législation de manière à éviter certains des problèmes qui se sont posés
dans les pays développés ? Quelle serait la meilleure position pour les pays en
développement s’agissant de l’harmonisation des brevets ? (Chapitre 6)
·
De
quelles institutions les pays en développement ont-ils besoin pour gérer, faire
respecter et réglementer efficacement la PI et comment peut-on les créer ?
Quelles sont les politiques et institutions supplémentaires nécessaires,
notamment en ce qui concerne la concurrence ? (Chapitre 7)
·
Les
institutions internationales et nationales concernées par les DPI
réussissent-elles véritablement à servir les intérêts des pays en développement
autant qu’elles le pourraient ?
(Chapitre 8)
La propriété intellectuelle est
une forme de savoir sur lequel les sociétés ont décidé qu’il était possible
d’attribuer certains droits de propriété. Ces droits ressemblent dans une
certaine mesure aux droits de propriété qui existent pour les biens corporels
ou la terre. Mais le savoir va bien au‑delà de la propriété
intellectuelle. Le savoir est détenu par des personnes, des institutions et de
nouvelles technologies selon des modalités depuis longtemps considérées comme
un moteur essentiel de la croissance économique.[28]
Alfred Marshall, « père » de l’économie moderne, pensait de cette
manière au XIXe siècle.[29]
Avec les récents progrès scientifiques et techniques, notamment en
biotechnologie et en technologies de l’information et de la communication
(TIC), le savoir est devenu plus que jamais auparavant la principale source
d’avantages compétitifs pour les entreprises tout autant que pour les pays. Les
échanges de biens et de services de haute technologie à forte intensité de
savoir, là où la protection de la PI est la plus courante, ont tendance à
constituer la branche la plus dynamique des échanges internationaux.[30]
Dans les pays développés, les
preuves ne manquent pas que la propriété intellectuelle joue, et a joué, un
rôle important dans la promotion de l'invention dans certains secteurs
industriels, bien que les données concernant son importance relative selon les
différents secteurs soient contrastées. Par exemple, les données factuelles des
années 80 indiquent que les industries pharmaceutique, chimique et pétrolière
ont été parmi les premières à reconnaître que le système des brevets était
indispensable à l’innovation.[31]
Aujourd’hui, il faudrait ajouter la biotechnologie et certains éléments des
technologies de l’information. Le droit d’auteur s’est également révélé
essentiel dans le monde de la musique, du film et de l’édition.
Pour les pays en développement,
comme pour les pays développés avant eux, la mise en place de capacités
technologiques locales s’est avérée un élément déterminant de la croissance
économique et de la réduction de la pauvreté. Ces capacités déterminent dans
quelle mesure ces pays peuvent assimiler et appliquer les technologies
étrangères. De nombreuses études ont conclu que le facteur le plus important
pour déterminer la réussite du transfert de technologie est l’apparition rapide
de capacités technologiques locales.[32]
Mais les infrastructures
scientifiques et techniques des pays en développement varient considérablement
en qualité et en capacité. Un indicateur habituellement utilisé pour mesurer
les capacités technologiques est l’importance de l’activité de délivrance de
brevets aux Etats-Unis et par l’intermédiaire des demandes internationales
déposées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).[33]
En 2001, moins de 1 % des brevets américains ont été octroyés à des demandeurs
de pays en développement, près de 60 % d’entre eux provenant de sept des pays
en développement les plus avancés du point de vue technologique.[34]
Dans le cadre du PCT, les pays en développement représentaient moins de 2 % des
demandes déposées en 1999-2001, plus de 95 % de ces demandes émanant de cinq
pays seulement : Chine, Inde, Afrique du Sud, Brésil et Mexique.[35]
Dans ces pays, le nombre des demandes de brevets, bien que peu élevé, augmente
plus rapidement que l’ensemble des demandes déposées au titre du PCT. Les
demandes au titre du PCT ont augmenté de près de 23 % entre 1999 et 2001, mais la part de ces pays
dans le total n’a augmenté que de 1 % en 1999 à 2,6 % en 2001. Comme nous
l’avons vu, les dépenses de R&D sont fortement concentrées dans les pays
développés et dans quelques pays en développement plus avancés du point de vue
technologique. Peu de pays en développement ont été en mesure de mettre en
place de solides capacités technologiques locales. Ceci signifie qu’il leur est
difficile soit de mettre au point leurs propres technologies, soit d’assimiler
celles des pays développés.
La question cruciale est de
savoir si l'extension des régimes de PI facilite ou non l'accès des pays en
développement à ces technologies et si la protection des DPI peut contribuer au
développement social et économique et à la réduction de la pauvreté dans ces
pays, et de quelle manière. Dans le présent chapitre, nous examinons :
·
Les arguments en faveur de la
protection de la PI
·
Son utilisation historique dans les
pays développés et en développement
·
Les données factuelles disponibles
concernant les incidences de la PI dans les pays en développement
·
Le rôle joué par la PI dans la
facilitation du transfert de technologie vers les pays en développement.
Encadré
1.1 Définition des droits de propriété
intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont des droits
conférés par la société à des particuliers ou à des organisations
principalement au titre d’œuvres créatives : inventions, œuvres littéraires et
artistiques, et symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le
commerce. Ils donnent aux créateurs le droit d’empêcher des tiers d’utiliser
sans autorisation l’objet du droit de propriété pendant une période limitée. La
PI se répartit en propriété industrielle
(innovations commerciales fonctionnelles) et en propriété artistique et littéraire (créations culturelles).
L’évolution actuelle de la technologie estompe dans une certaine mesure ces
distinctions, et certains systèmes sui
generis hybrides font apparition.
Propriété
industrielle
Brevets : un brevet est un droit exclusif
conféré à un inventeur en vue d’empêcher des tiers de fabriquer, vendre,
distribuer, importer ou utiliser son invention, sans concession de licence ou
autorisation, pour une durée fixée (l’Accord sur les ADPIC précise une durée de
20 ans au minimum à partir de la date de dépôt). En échange, la société exige
que le demandeur de brevet divulgue l’invention d’une manière qui permette aux
tiers de la mettre en pratique. Ceci augmente l’ensemble des connaissances
disponibles pour des recherches ultérieures. Outre la divulgation suffisante de
l’invention, trois critères déterminent la brevetabilité d’une invention (bien
que les détails puissent varier d’un pays à l’autre) : nouveauté
(caractéristiques nouvelles qui ne font pas partie de « l'état de la
technique »)[36],
non‑évidence (activité inventive non évidente pour un homme du métier),
et utilité (ainsi qu’on le dit aux Etats-Unis) ou applicabilité industrielle
(comme on le dit au Royaume-Uni). Les modèles d’utilité sont semblables aux
brevets, mais dans certains pays confèrent des droits d’une durée plus courte
pour certaines catégories d’innovations petites ou progressives.
Dessins et modèles
industriels : les dessins et modèles industriels protègent
les aspects esthétiques (forme, texture, structure, couleur) d’un objet, plutôt
que ses caractéristiques techniques. En vertu de l’Accord sur les ADPIC, un
dessin ou modèle original doit bénéficier d’une protection contre une
utilisation sans autorisation par des tiers pendant au moins 10 ans.
Marques : les marques de fabrique ou de commerce
confèrent des droits exclusifs pour utiliser des signes distinctifs, tels que
symboles, couleurs, lettres, formes ou noms en vue d’identifier le producteur
d’un produit, et de protéger la réputation qui y est associée. Afin de pouvoir
avoir droit à la protection, une marque doit être particulière au propriétaire
de sorte qu’elle serve à identifier les biens ou services de ce propriétaire. L’objectif principal d’une marque est d’empêcher les
clients d’être induits en erreur ou trompés. La durée de la protection varie,
mais une marque peut être renouvelée indéfiniment. De plus, nombre de
pays confèrent une protection contre la concurrence déloyale, parfois en
empêchant toute déclaration inexacte concernant l’origine commerciale, indépendamment
de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce.
Indications
géographiques : les indications géographiques (IG)
identifient l’origine géographique spécifique d’un produit, et les qualités, la
réputation et autres caractéristiques qui y sont associées. Habituellement, il
s’agit du nom du lieu d’origine. Par exemple, les produits alimentaires ont
parfois des qualités qui proviennent de leur lieu de production et d’éléments
caractéristiques de l’environnement local. L’indication géographique empêche
les tiers non autorisés à utiliser une IG protégée pour des produits ne
provenant pas de la région en question, ou encore d’induire le public en erreur
en ce qui concerne la véritable origine du produit.
Secrets d’affaires : les secrets d’affaires sont constitués
par des informations commercialement précieuses concernant les méthodes de
production, les plans commerciaux, la clientèle, etc. Ils sont protégés dans la
mesure où ils restent secrets grâce à des lois qui empêchent leur acquisition par
des moyens commercialement déloyaux ou par divulgation sans autorisation.
Propriété artistique
et littéraire
Droit d’auteur : le droit d’auteur confère des droits exclusifs
aux créateurs d'œuvres originales littéraires, scientifiques et artistiques. Il
n’empêche que la copie, et non pas un ouvrage qui en
est dérivé de manière indépendante. La protection du droit d’auteur commence,
sans formalité, au moment de la création
de l’œuvre et sa durée est (en règle générale) égale à la vie du créateur plus
50 ans (70 ans aux Etats-Unis et dans l’UE). Ce droit empêche la
reproduction, la représentation publique, l’enregistrement, la diffusion, la
traduction ou l’adaptation sans autorisation, et permet la perception de
redevances pour tout usage autorisé. Les programmes
d'ordinateur sont protégés par le droit d’auteur, étant donné que la source et
le code du logiciel ont été définis comme expression littéraire.
Systèmes sui generis
Circuits intégrés
pour ordinateur : forme
spécifique sui generis de protection
pour la conception des circuits intégrés pour ordinateur. Comme l’activité
inventive est souvent minime et l’originalité la seule exigence, la période
minimale de protection au titre de l’Accord sur les ADPIC est de 10 ans.
Droits d'obtention
végétale : des droits
d'obtention végétale (DOV) sont conférés aux obtenteurs de variétés qui sont
nouvelles, distinctes, homogènes et stables. Ils offrent normalement une
protection pour au moins quinze ans (à compter du moment où ils sont conférés).
La plupart des pays concèdent des exceptions aux agriculteurs pour conserver et
replanter leurs semences, et pour l’utilisation de matériel protégé pour
sélection ultérieure.
Protection des bases
de données : l’UE a adopté
une législation visant à fournir une protection sui generis en ce qui concerne les bases de données, pour empêcher
toute utilisation sans autorisation des compilations de données, même si elles
ne sont pas originales. Des droits exclusifs sont octroyés pour l’extraction ou
l’utilisation de tout ou partie du contenu des bases de données protégées.
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA PI
Introduction
La propriété intellectuelle crée
un moyen juridique pour s’approprier le savoir. Une caractéristique du savoir,
c’est que l’utilisation qui en est faite par une personne ne diminue en rien
l’utilisation par une autre (par exemple, la lecture du présent rapport). De
plus, le coût supplémentaire requis pour permettre l'extension de cette
utilisation à une autre personne est souvent très faible, sinon nul (par
exemple, prêter un livre ou copier un dossier électronique). Du point de vue de
la société, plus les utilisateurs du savoir sont nombreux, mieux c’est, car
chaque utilisateur peut retirer quelque chose de ce savoir pour un coût faible
ou nul, et la société s’en trouve dans un certain sens plus riche. Les
économistes disent par conséquent que le savoir a la caractéristique d’un produit public sans rival.[37]
L’autre aspect du savoir, ou des
produits contenant un savoir, c’est le problème, souvent intrinsèque, qui
consiste à empêcher les autres d’utiliser ou de copier ce savoir. Une grande
partie des produits qui incorporent un nouveau savoir peuvent être copiés
facilement. Il est probable que la plupart des produits peuvent, au prix d’un
effort suffisant, être copiés pour une fraction (bien qu’elle ne soit pas
nécessairement faible) du coût de leur invention ou de leur commercialisation.
Pour les économistes, cette dernière caractéristique est un des éléments qui
contribuent à la défaillance du marché.
Si un produit exige des efforts, de l’ingéniosité et des recherches
considérables, mais peut être copié facilement, l’incitation financière ne sera
probablement pas suffisante du point de vue de la société pour consacrer des
ressources à l’invention.
Brevets
Le brevet
constitue un moyen de trouver remède à cette défaillance du marché. En
conférant des exclusivités commerciales temporaires, les brevets permettent aux
producteurs de récupérer les dépenses d’investissement et de R&D et
d’engranger un gain, en échange de la divulgation au public du savoir sur
lequel l’invention est fondée. Toutefois, aucune personne ne peut utiliser ce
savoir à des fins éventuellement commerciales sans l’autorisation du titulaire
du brevet. Les coûts d'investissement en R&D et le retour sur cet
investissement sont compensés par la possibilité de demander au consommateur un
prix tel qu’il permet d’exclure la concurrence.
Par conséquent, la protection est
une transaction conclue par la société, en partant du principe qu’en son
absence, il n’y aurait pas suffisamment d’inventions ni d’innovations. On
présume qu’à long terme les consommateurs s’en trouveront mieux, malgré les
coûts plus élevés résultant de la fixation du prix de monopole, parce que les
pertes à court terme subies par les consommateurs sont plus que compensées par
la valeur pour eux des nouvelles inventions créées par une R&D
supplémentaire. Les économistes estiment que le système des brevets améliore
l’efficacité dynamique (en stimulant le progrès technique) aux dépens d’une
efficacité statique (découlant des coûts associés au monopole).
Les justifications de la
protection par brevet sont relativement faciles à comprendre, mais elles
dépendent d’un certain nombre d’hypothèses de simplification qui peuvent dans
la pratique ne pas se vérifier. Par exemple, le niveau optimal de protection
par brevet ne peut pas être défini avec précision. Si la protection est trop
faible, le développement de la technologie peut être entravé par l’insuffisance
des incitations à entreprendre des travaux de R&D. Si la protection
conférée est trop forte, les consommateurs n’en profiteront pas, même à long
terme, et les titulaires des brevets pourront obtenir des bénéfices qui
dépassent de beaucoup les dépenses globales de R&D. De plus, toute
innovation ultérieure fondée sur la technologie protégée peut être paralysée,
par exemple parce que la durée du brevet est trop longue ou que la portée de la
protection accordée est trop large.
La durée du monopole octroyé
constitue l’un des facteurs déterminant la vigueur de la protection par brevet.
Un autre est la portée du brevet. Un brevet large est celui qui confère un
droit qui va bien au-delà de l’invention revendiquée elle-même. Par exemple, un
brevet qui revendique un gène est susceptible de ne préciser qu’une utilisation
de ce gène. Mais, selon certaines conceptions de la portée de la protection, le
titulaire du brevet peut aussi avoir les droits relatifs à des utilisations de
l’information génétique autres que celles qui sont divulguées dans le brevet, y
compris celles qui seront découvertes plus tard par quelqu’un d’autre. Les
brevets de portée large ont tendance à décourager les innovations ultérieures
d’autres chercheurs dans le secteur dont fait partie le brevet. Par contre, des
revendications étroites encourageront d’autres à « travailler
autour » du brevet et ne constitueront pas autant de restrictions lors des
recherches connexes entreprises par d’autres. Elles peuvent également créer des
droits plus forts qui seront moins susceptibles d’être contestés devant les
tribunaux.[38] La
politique menée par le titulaire du brevet en matière de licence aura également
un important impact sur la diffusion des nouvelles technologies et sur la
mesure dans laquelle la recherche future sera influencée par les droits
octroyés.
Le niveau
optimal de protection (lorsque les avantages pour la société sont jugés
supérieurs aux coûts sociaux) variera également fortement selon les produits et
les secteurs et sera lié aux variations de la demande, aux structures du
marché, aux coûts de R&D et à la nature du procédé innovateur. Dans la
pratique, les régimes de DPI ne peuvent pas être adaptés aussi précisément et
par conséquent le niveau de protection est nécessairement un compromis. Conclure
un mauvais compromis, que ce soit par excès ou par défaut, sera coûteux pour la
société, surtout à long terme.
Une autre hypothèse sous-jacente
est qu’il existe une offre latente de capacité innovante dans le secteur privé
attendant d’être libérée par l’octroi de la protection que fournit le système
de PI. C’est peut-être le cas dans les pays où existent des capacités de
recherche importantes. Mais dans la majorité des pays en développement, on
constate une faiblesse des systèmes locaux d’innovation (tout au moins du type
de ceux qui existent dans les pays développés). Et même là où de tels systèmes
sont plus solides, les capacités sont souvent plus importantes dans le secteur
public que dans le secteur privé.[39]
Par conséquent, dans ces contextes, les avantages dynamiques découlant de la
protection de la PI sont incertains. Le système des brevets peut fournir un
encouragement, mais il est possible qu’il n’y ait pas suffisamment de capacités
locales pour l’utiliser. Même lorsque des technologies sont mises au point, les
entreprises des pays en développement peuvent rarement acquitter les frais de
l’acquisition et de la conservation des droits et, surtout, de contentieux si
des litiges surgissent.
Les économistes sont actuellement
très conscients de ce qu’ils appellent les frais
de transaction. La création de l’infrastructure d’un régime de DPI et des
mécanismes nécessaires pour faire respecter ces droits est coûteuse à la fois
pour le gouvernement et pour les parties prenantes privées. Dans les pays en
développement, où les ressources humaines et financières sont rares et où les
systèmes juridiques ne sont pas très développés, les coûts d’opportunité d’un
fonctionnement efficace du système sont élevés. Ces coûts comprennent les frais
d’une étude de la validité des revendications des droits de brevet (à la fois
au stade de la demande et devant les tribunaux) et des jugements à prononcer
dans les actions en contrefaçon. Les incertitudes inhérentes à la procédure
judiciaire entraînent des coûts considérables qui doivent être mis en balance
avec les avantages découlant du système de PI.
Ainsi, la valeur du système des
brevets doit être appréciée de manière équilibrée, en reconnaissant qu’il a à
la fois des avantages et des coûts et que l’équilibrage entre les deux risque
de varier considérablement selon les circonstances.
Les
universitaires, notamment les économistes, ont généralement une vue critique
des DPI. Ces droits impliquent nécessairement des restrictions à la concurrence
susceptibles de nuire au consommateur et à la liberté des échanges, et on peut
se demander si les avantages découlant des incitations à la recherche et à
l'invention l'emportent sur ces coûts. Les citations de l’Encadré 1.2
ci-dessous montrent bien l’ambivalence concernant les effets du système de PI
dans les pays développés et son impact dans les pays en développement. Cette
ambivalence tend à se renforcer à mesure que le système de PI englobe de
nouvelles technologies.
Encadré
1.2 Conclusions sur la valeur du système
de PI
Edith Penrose dans son ouvrage «The Economics of the
International Patent System » (1951) (L’économie du système international des
brevets) :
« Un pays quel qu’il soit sera perdant s’il confère des
privilèges de monopole sur le marché intérieur qui ne permettent ni d’améliorer
ni de faire diminuer le prix des biens disponibles, qui ne développent pas ses
propres capacités productives ni n’obtiennent pour ses producteurs des
privilèges tout au moins équivalents sur d’autres marchés. Parler très souvent
de « l’unité économique du monde » ne peut cacher le fait que
certains pays n’ayant que peu d’échanges d’exportation de biens industriels et
peu, si elles existent, d’inventions à vendre, n’ont rien à gagner à octroyer
des brevets pour des inventions mises au point et brevetées à l’étranger, sauf
à éviter des représailles étrangères désagréables dans d’autres directions. On
trouve dans cette catégorie les pays agricoles et ceux qui s’efforcent de
s’industrialiser, mais qui n’exportent que des matières premières …quels que
soient les avantages que cela puisse constituer pour ces pays, ces derniers ne
comprennent pas ceux qui sont liés à leur propre gain économique tiré de
l’octroi ou de l’obtention de brevets d’invention. »[40]
Fritz Machlup, après avoir étudié le système de brevets
américain, a conclu en 1958 :
« Lorsque l’on ne sait pas si un système … est bon ou
mauvais, la conclusion de politique générale la plus sûre consiste à s’en
sortir vaille que vaille, soit avec ce système, si l’on vit depuis longtemps
avec, ou sans lui, si l’on a vécu jusqu’à présent sans lui. Si nous n’avions
pas de système de brevets, il serait irresponsable, compte tenu de ce que nous
savons actuellement sur ses conséquences économiques, de recommander sa
création. Mais étant donné que nous avons un système de brevets
depuis longtemps, il serait irresponsable, d’après ce que
nous savons, de recommander son abolition. Cette dernière affirmation se réfère
à un pays comme les Etats-Unis, et non pas à un petit pays et ni à un pays à
prédominance non industrielle, où des arguments pourraient être trouvés pour
suggérer une autre conclusion. »[41]
Un autre économiste éminent, Lester Thurow, a écrit en 1997
:
« Dans une économie mondiale, on a besoin d’un système
mondial de droits de propriété intellectuelle. Il faut un système qui reflète
les besoins à la fois des pays qui sont en développement et de ceux qui se sont
déjà développés. Le problème est semblable à la question de savoir quelles
catégories de savoirs devraient se trouver dans le domaine public dans le monde
développé. Mais dans le tiers monde, le besoin d’obtenir des produits
pharmaceutiques à faible coût n’est pas équivalent à celui d’obtenir des CD bon
marché. Tout système qui aborde ces deux besoins de la même manière, comme le
fait notre système actuel, est un système qui n’est ni bon ni viable. »[42]
Un juriste universitaire éminent, Larry Lessig, a dit à
propos des Etats-Unis en 1999 :
« Sans aucun doute, notre situation est plus favorable
avec un système de brevets que sans. Une grande partie de la recherche et des
inventions ne se produirait pas sans la protection du gouvernement. Mais ce
n’est pas parce qu’un certain niveau de protection est bon qu’un niveau
supplémentaire serait nécessairement mieux…Les intellectuels se demandent de
plus en plus si les monopoles imposés par les Etats sont favorables à un marché
en évolution rapide comme l’Internet… Les économistes se demandent à l’heure actuelle si une protection
par brevet élargie aura un effet salutaire. Certainement, elle pourra enrichir
considérablement certains, mais cela ne veut pas dire que le marché va
s’améliorer... Plutôt qu’une protection sans limite, notre tradition nous
enseigne l’équilibre et nous montre les dangers inhérents à des régimes de
propriété intellectuelle trop rigoureux. Mais, en fait, il semble
qu’actuellement toute attitude équilibrée en ce qui concerne la PI ne soit plus
de mise. Une sorte de frénésie s’est emparée de tous, et pas seulement dans le
domaine des brevets, mais pour tous les aspects de la propriété
intellectuelle… »[43]
Et Jeffrey Sachs,
économiste éminent, a déclaré en 2002 :
« … nous avons la possibilité de revoir le régime des
droits de propriété intellectuelle du système des échanges mondiaux vis-à-vis
des pays les plus pauvres. Pendant les négociations du Cycle d'Uruguay,
l’industrie pharmaceutique internationale a exercé de fortes pressions pour
obtenir une couverture universelle de la protection par brevet sans prendre en
considération les répercussions sur les pays les plus pauvres. Il y a peu de
doute que les nouvelles dispositions en matière de DPI peuvent durcir l’accès
des consommateurs des pays les plus pauvres aux technologies clés, comme on l’a
bien vu dans le cas des médicaments essentiels. Les pays négociant le nouveau
cycle de Doha se sont déjà engagés à réexaminer la question des DPI à la
lumière des priorités de santé publique, et c’est une attitude sage. Il se
pourrait très bien que le renforcement des DPI ralentisse la diffusion des
technologies vers les pays les plus pauvres, qui s’est traditionnellement
effectuée par copie et par ingénierie inverse. Les chemins sacrés de la
diffusion technologique subissent un ralentissement croissant et cela pourrait
avoir sur les pays les plus pauvres des effets indûment préjudiciables. C’est
un domaine qui doit faire l’objet d’une observation très précise et d’une
recherche continue et retenir toute l’attention des pouvoirs publics. »[44]
Droit d’auteur
Les arguments en faveur de la
protection du droit d’auteur ne sont pas très différents de ceux qui sont
invoqués pour les brevets, bien que depuis toujours on ait insisté sur les
droits des artistes créateurs à recevoir une rémunération équitable pour leurs
œuvres plutôt que sur les motivations ainsi suscitées. Le droit d’auteur
protège la forme sous laquelle des idées sont exprimées, pas les idées
elles-mêmes. Hier comme aujourd’hui, le droit d’auteur a toujours été à
l’origine du fait que la publication des œuvres littéraires et artistiques
constitue une proposition économique puisqu’il empêche la copie. A la
différence des brevets, la protection du droit d’auteur n’exige ni
enregistrement, ni autres formalités (bien que cela n’ait pas toujours été le
cas).
Comme dans le
cas des brevets, il s’agit pour la société d’un compromis entre la motivation
offerte aux créateurs d’œuvres littéraires et artistiques et les restrictions
que cela constitue quant à la libre circulation des œuvres protégées. Mais à la
différence des brevets, le droit d’auteur protège en principe l’expression des
idées, mais non pas les idées en tant que telles qui peuvent être utilisées par
d’autres. Et il n'empêche que la copie de cette expression, et non pas ce que
l’on peut en tirer de manière indépendante. Le problème essentiel pour les pays
en développement provient du coût de l’accès aux présentations physiques ou
numériques des œuvres protégées, et des démarches entreprises pour mettre en
œuvre la protection du droit d’auteur.
A l'instar des
brevets, il existe normalement des exceptions précisées dans la loi limitant
les droits des titulaires au nom de l’intérêt général, que l’on nomme dans
certains pays « fair use » (par exemple aux Etats-Unis), et
« fair dealing » dans la tradition britannique, et des exceptions au
droit de reproduction dans la tradition européenne.[45] Ce qui est
particulièrement important pour les pays en développement c’est le coût de
l’accès, et l’interprétation de l’expression « fair use »
(utilisation équitable), notamment en raison de l’extension du droit d’auteur
aux matériel électronique et aux logiciels.
Le droit
d’auteur protège les œuvres pendant une durée beaucoup plus longue que les
brevets, mais ne protège pas contre les produits indépendants dérivés de
l’œuvre en question. En vertu de l’Accord sur les ADPIC, le droit d’auteur
protège pendant cinquante ans après le décès de l’auteur au minimum, mais dans
la plupart des pays développés et plusieurs pays en développement, cette durée
est portée à 70 ans ou plus. Bien que la principale raison pour l’extension du
droit d’auteur ait été les pressions exercées par les industries du droit
d’auteur (notamment l’industrie cinématographique aux Etats-Unis), il n’y a
guère de justification économique réelle à ce que la protection du droit
d’auteur soit tellement plus longue que la protection offerte par les brevets.
D’ailleurs, le rythme du progrès technique a conduit dans plusieurs industries
à raccourcir la vie effective d’un produit (par exemple, pour les éditions
successives des progiciels), ce qui indique qu’une protection du droit d’auteur
plus longue est inutile. Les augmentations successives de la durée de
protection du droit d’auteur ont suscité des inquiétudes dans certains
secteurs. Cette année, la Cour suprême des Etats-Unis entendra une affaire qui
remet en question la loi de 1998 sur la prolongation de la durée du droit
d’auteur (1998 Copyright Term Extension
Act) au motif qu’elle viole la Constitution qui précise que toute
protection doit être pour « un temps limité ». De plus, il est avancé
dans cette affaire qu’une extension de la protection accordée pour une œuvre
qui existe déjà n’a aucun effet motivant et qu’elle viole également l’exigence
de contrepartie inscrite dans la Constitution selon laquelle les droits de
monopole sont conférés en échange d’avantages d’ordre général.[46]
Comme dans le
cas des brevets, il est essentiel pour les pays en développement que les
avantages découlant des incitations fournies par le droit d’auteur l’emportent
sur l’augmentation des coûts associée aux restrictions d’utilisation dues au
droit d’auteur. Bien que certaines exceptions existent, comme l’industrie
indienne du cinéma ou du logiciel, la plupart des pays en développement sont
des importateurs nets de produits protégés par le droit d’auteur, de même
qu’ils sont des importateurs nets de technologie. Etant donné que le droit
d’auteur n’a pas besoin d’être enregistré ni de faire l'objet d’autres
formalités, lorsqu’un pays a mis en place une législation en matière de droit
d’auteur, l’impact du droit d’auteur est plus généralisé que dans le cas des
brevets. Les logiciels, les manuels et les revues universitaires sont des
articles clés dont le prix et l’accès sont déterminés en partie par le droit
d’auteur, et qui sont également des éléments essentiels dans l’enseignement et
dans d’autres domaines indispensables au processus de développement. Par
exemple, une sélection raisonnable de revues scientifiques est hors de portée
du budget des bibliothèques universitaires dans la plupart des pays en
développement, et également de plus en plus dans les pays développés.
L’interaction
de l’Internet et du droit d’auteur est une question de plus en plus pressante
pour les pays en développement. Avec les médias imprimés, il existe des
dispositions relatives à une « utilisation équitable » dans le cadre
de la législation sur le droit d’auteur, et la nature du support tend elle-même
à une utilisation multiple soit officiellement par l’intermédiaire de
bibliothèques, soit de manière non officielle en empruntant ou en regardant
(comme cela peut se faire dans une librairie avant de décider d’acheter). En ce
qui concerne le matériel accessible par l’Internet, la technologie permet le
cryptage et d’autres moyens pour empêcher les utilisateurs potentiels même
d’explorer s’ils n’ont pas acquitté le prix approprié. Alors que la
« philosophie » de l’Internet recommande jusqu’à présent un accès
gratuit, des sites de plus en plus nombreux contenant un matériel de valeur
s’orientent vers la facturation d’une utilisation ou vers la limitation de
l’accès de toute autre manière. De plus la DMCA, aux Etats-Unis, et la
directive sur les bases de données, en Europe, ont des dispositions qui vont
bien au-delà de ce qui est exigé en vertu de l’Accord sur les ADPIC et sont
considérées par de nombreux utilisateurs comme ayant fait basculer la
protection trop loin en faveur des investisseurs et de ceux qui ont compilé les
données.
Ainsi, comme
dans le cas des brevets, il est nécessaire de trouver un équilibre. Une trop
grande protection par le droit d’auteur, par d’autres formes de protection de
la PI ou par la technologie peut limiter la libre circulation des idées sur la
base desquelles repose tout progrès futur dans le domaine des idées et de la
technologie. Pour les pays en développement, des règles de droit d’auteur
indûment rigoureuses peuvent avoir des conséquences sur les possibilités
d’accès à des œuvres qui sont essentielles pour le développement, comme le
matériel éducatif et les savoirs scientifiques et techniques.
Plusieurs enseignements peuvent
être tirés de l’histoire, notamment de l’expérience des pays développés, au XIXe
siècle, et des économies émergentes de l’Asie de l’Est, au cours du siècle
dernier.
Premièrement,
les régimes de PI ont été utilisés par les pays tout au long de leur histoire
pour protéger ce qu’ils considèrent comme leurs propres intérêts économiques.
Certains pays ont modifié leurs régimes à différents stades du développement
économique à mesure que cette perception (et que leur statut économique)
changeait. Par exemple, entre 1790 et 1836, en tant qu’importateurs nets de
technologie, les Etats-Unis ont restreint la délivrance de brevets à leurs
propres citoyens et résidents. Même en 1836, les taxes sur les brevets pour les
étrangers étaient fixées à un taux dix fois plus élevé que celui demandé pour
les citoyens américains (avec majoration des deux tiers s’il s’agissait d’un
Britannique !). Ce n’est qu’en 1861 que les étrangers ont été traités (presque)
sans discrimination. Dans son rapport annuel de 1858, le Commissaire américain
des brevets a noté :
« C’est un fait, aussi significatif que déplorable, que
sur les 10 359 inventions montrées comme ayant été réalisées à l’étranger
au cours des douze derniers mois, seulement quarante-deux aient été brevetées
aux Etats-Unis. Les taxes exorbitantes exigées de l’étranger, et la sévérité de
la discrimination offensive créée à son encontre, constituent une explication
suffisante de ce résultat … on pourrait donc bien en conclure que le
gouvernement de ce pays considère qu’une invention réalisée au-delà des mers
est quelque chose d’intrinsèquement dangereux, sinon nuisible. Il est donc
juste, du point de vue moral, et sage, du point de vue politique, de grever son
introduction par des impôts de même que vous taxeriez l’importation de quelque
médicament étranger empoisonné. Il existe une vision plus élevée de cette
question, qui semble mieux en harmonie avec l’esprit progressif de l’époque,
une vision qui salue les fruits du travail d’un génie inventif, quel que soit
le climat où il se soit développé, comme étant un bien commun au monde entier,
et les accueille comme des bienfaits communs de la race à l’amélioration de
laquelle ils sont consacrés. »[47]
Jusqu’en 1891, la protection
du droit d’auteur aux Etats-Unis était limitée aux citoyens américains, mais diverses
restrictions aux droits d’auteur étrangers restèrent en vigueur (par exemple,
l’impression devait être faite sur des linotypes américains), ce empêcha
l’adhésion des Etats-Unis à la Convention de Berne sur le droit d’auteur
jusqu’en 1989, soit plus de 100 ans plus tard que le Royaume-Uni. C’est pour
cette raison que certains lecteurs peuvent se souvenir d’avoir acheté des
livres sur la couverture desquels il était inscrit les mots suivants : « For copyright reasons this edition is not
for sale in the U.S.A. » (Pour des raisons de droit d’auteur, cette édition
ne peut être vendue aux Etats-Unis.)
Jusqu’à
l’adoption de la Convention de Paris (pour la protection de la propriété
industrielle) en 1883 et de la Convention de Berne de 1886 (pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques), les pays avaient toute liberté
d’adapter la nature de leurs régimes à leurs propres circonstances. Même alors,
les règles de ces conventions faisaient preuve d’une souplesse considérable. La
Convention de Paris permettait aux pays d’exclure de la protection certains
domaines technologiques et de déterminer la durée de la protection conférée en
vertu des brevets. Elle permettait également la révocation des brevets et les
licences obligatoires[48] pour corriger les abus.
Deuxièmement, de nombreux pays
ont à un certain moment exempté de la protection par brevet différentes
catégories d’inventions dans certains secteurs de l’industrie. Souvent, la
législation a restreint la portée des brevets sur les produits, ne conférant
une protection qu’aux procédés nécessaires à leur production. En général, ces
secteurs étaient l’alimentation et les produits pharmaceutiques et chimiques,
en partant du principe qu’aucun monopole ne devait être conféré pour des biens
essentiels et qu’il y avait davantage à gagner si on facilitait le libre accès
aux technologies étrangères que si on encourageait potentiellement les
inventions au sein de l’industrie nationale. Cette démarche a été adoptée au
XIXe siècle par de nombreux pays aujourd'hui développés, et par
certains d'entre eux jusque vers la fin du XXe siècle, ainsi que
dans les pays de l’Asie de l’Est (comme Taïwan
et la Corée) jusqu’à une époque relativement récente. Toutefois,
l’Accord sur les ADPIC interdit maintenant, lors de l’octroi d’une protection
par brevet, toute discrimination s’agissant de différents domaines
technologiques.
Troisièmement, la propriété
intellectuelle, et les brevets en particulier, ont souvent suscité des
objections d’ordre politique. Entre 1850 et 1875, une controverse a fait rage
en Europe, à la fois dans les milieux universitaires et politiques, sur la
question de savoir si le système des brevets était une insulte au principe du
libre-échange ou le meilleur moyen pratique d’encourager les inventions. John Stuart
Mill a opté pour cette dernière opinion :
« … un privilège exclusif, d’une durée temporaire est
préférable [comme moyen de stimuler l’invention] ; parce qu’il ne laisse rien à
la discrétion de quiconque ; parce que la récompense qu’il confère dépend de
l’utilité décelée dans l’invention, et plus elle sera utile, plus grande sera
la récompense ; et parce qu’il est à la charge de ceux mêmes à qui le service
est rendu, les consommateurs du produit. »[49]
Essentiellement, c’est toujours
le cas pour le système actuel : un moyen relativement peu coûteux (tout au
moins pour les Etats, dans la mesure où ils n’achètent pas les produits) de
fournir une motivation pour l’invention, assortie d’une récompense
proportionnelle à l’utilisation qui en est faite ultérieurement.[50]
L’opposition à la protection par
brevet reposait sur diverses raisons, mais elle a été résumée par les mots de
l’Economist en 1851 :
« Les privilèges accordés aux inventeurs par la loi sur
les brevets sont des interdictions pour les autres hommes, et l’histoire des
inventions par conséquent regorge de récits concernant des améliorations
insignifiantes brevetées, qui ont interdit, pendant une longue période, toute
autre amélioration semblable ou même bien plus considérable… Ces privilèges ont
étouffé davantage d’inventions qu’il n’en ont encouragé… Chaque brevet
constitue une interdiction dirigée contre des améliorations dans une direction
particulière, sauf si elles sont entreprises par le titulaire du brevet,
pendant un certain nombre d’années ; et quel que soit l’avantage obtenu par un
particulier du fait de ce privilège, la communauté ne peut pas en profiter…
Pour tous les inventeurs, cela constitue essentiellement une interdiction
d'exercer leurs facultés ; et dans la mesure où ils sont plus nombreux qu’une
seule personne, c’est une entrave au progrès général… »[51]
Ceci illustre parfaitement une
fois encore un thème qui revient dans les discussions actuelles. Si le système
protège un ensemble d’inventions, peut-il éviter de décourager ceux qui
cherchent à apporter des améliorations à ces premières inventions ?
Annonçant les débats concernant
l’Accord sur les ADPIC, la querelle portait aussi au XIXe siècle sur
la controverse du libre‑échange, car le système des brevets, en conférant
des monopoles, était considéré par certains comme contrevenant aux principes du
libre‑échange. De plus, certains intérêts personnels entraient en jeu. En
Suisse dans les années 1880, les industriels ne souhaitaient pas de législation
en matière de brevets parce qu’ils voulaient continuer à utiliser les
inventions des concurrents étrangers. Cette opposition s’est maintenue en dépit
du fait que les Suisses étaient des titulaires de brevets enthousiastes dans
d’autres pays. Et comme la Suisse avait des tarifs douaniers peu élevés, les
Suisses craignaient que les concurrents étrangers viennent déposer des brevets
en Suisse et éliminent la concurrence suisse grâce à cette protection.
La Suisse a fini par adopter une
loi sur les brevets, avec diverses exclusions et garanties, non pas parce que
la plupart des Suisses pensaient qu’ils pouvaient retirer un avantage net en
permettant les brevets étrangers, mais parce que la Suisse subissait d’intenses
pressions, notamment de la part de l’Allemagne, pour adopter cette loi, et
qu’elle ne souhaitait pas susciter des mesures de représailles de la part
d’autres pays.[52] Les
garanties adoptées comprenaient des dispositions pour l’exploitation
obligatoire[53] et
les licences obligatoires qui permettaient aux pouvoirs publics d’obliger à produire
en Suisse d’une manière ou d’une autre, s'ils le souhaitaient. En outre, les
produits chimiques et les colorants textiles étaient exclus de la protection
par brevet. Ailleurs en Europe, les partisans du système des brevets l’ont
également emporté, juste au moment où le mouvement du libre‑échange
disparaissait progressivement face à la grande dépression qui sévit en Europe.
Uniquement en Hollande, le mouvement contre les brevets a totalement réussi, et
de 1869 à 1912 aucun brevet n’y a été délivré.[54]
Quatrièmement, les meilleurs
exemples de l’histoire récente du développement se trouvent dans les pays
d’Asie de l’Est qui ont utilisé des formes atténuées de protection de la PI
adaptées aux circonstances particulières de leur stade de développement. Entre
1960 et 1980, pendant toute la phase critique de croissance rapide qui a
transformé leur économie, Taïwan et la Corée ont souligné l’importance de
l’imitation et de l’ingénierie inverse[55]
comme éléments essentiels permettant de mettre en place leurs capacités
technologiques et innovatrices locales. La Corée a adopté une loi en matière de
brevets en 1961, mais la portée des brevets excluait les denrées alimentaires
et les produits chimiques et pharmaceutiques. La durée du brevet n’était que de
12 ans. Ce n’est qu’au milieu des années 80, à la suite en particulier de
l’action des Etats-Unis en vertu de la section 301 de leur loi de 1974 sur le
commerce (1974 Trade Act), que les
lois sur les brevets ont été révisées, bien qu’elles n’aient pas encore atteint
les normes qui devaient être fixées par l’Accord sur les ADPIC. Un processus
semblable a eu lieu à Taïwan. En Inde, l’affaiblissement de la protection de la
PI pour les produits pharmaceutiques dans sa loi de 1970 sur les brevets (1970 Patent Act)[56]
est considéré en général comme ayant fortement contribué à la croissance
ultérieure rapide de l’industrie pharmaceutique, en tant que producteur et
exportateur de médicaments génériques à faible coût[57]
et d’intermédiaires en vrac.[58]
L’histoire nous enseigne que les
pays ont été capables d’adapter leur régime de DPI pour faciliter
l’apprentissage technologique et encourager la réalisation de leurs propres
objectifs de politique industrielle. Etant donné que les politiques menées dans
un pays peuvent avoir des résultats négatifs sur les intérêts des autres pays,
les débats concernant la PI ont toujours comporté une dimension internationale.
Les Conventions de Paris et de Berne reconnaissent cette dimension et aussi
qu’il est nécessaire de parvenir à une réciprocité, tout en prévoyant une
souplesse considérable dans la conception des régimes de PI. L’Accord sur les
ADPIC a supprimé une grande partie de cette souplesse. Les pays ne peuvent plus
suivre la route choisie par la Suisse, la Corée ou Taïwan pour leur propre
développement. Le processus d’apprentissage technologique et le passage de
l’imitation et de l’ingénierie inverse à la mise en place de capacités
innovantes authentiquement locales doivent être dorénavant envisagés sous un
angle différent.
L’analyse des données factuelles
dont on dispose sur les incidences des régimes de DPI dans les pays développés
et en développement est une tâche complexe. Comme indiqué plus haut, nous ne
souhaitons pas concentrer notre attention sur les DPI en eux-mêmes, mais sur la
manière dont ils peuvent contribuer au développement et à la réduction de la
pauvreté. Nous estimons que la condition préalable à un développement durable
dans un pays quelconque est la mise en place de capacités technologiques et
scientifiques locales. Elles sont nécessaires pour permettre aux pays de mettre
au point leurs propres processus d’innovation technologique, et d’absorber de
manière efficace les technologies mises au point à l’étranger. Il est évident
que la mise en place de ces capacités dépend d’un grand nombre
d’éléments : il faut un système d’enseignement efficace, notamment au
niveau tertiaire, et un réseau d’institutions de soutien et de structures
juridiques ; il faut aussi disposer de ressources financières, tant
publiques que privées, spécialement consacrées au développement technologique.
De nombreux autres facteurs peuvent également contribuer à ce qu’on appelle
souvent des « systèmes nationaux d’innovation ».
Considérés sous cet angle, les
DPI peuvent-ils contribuer à la mise en place de systèmes nationaux efficaces
d’innovation en principe et, comme
les capacités technologiques et scientifiques locales varient considérablement,
comment peuvent-ils y parvenir effectivement dans la pratique, compte tenu des circonstances particulières à
chaque pays ? De plus, comme nous ne nous intéressons pas simplement à
l’effet dynamique des DPI sur l’innovation, mais aussi aux coûts que la
protection de la PI impose à la société, notamment aux pauvres, il nous faut
tenir compte de ces coûts lorsque nous examinons les données factuelles et la
valeur d’un système de PI donné.
Une grande partie des données
concernant les DPI sont soit indirectes, soit fondées sur des mesures
indirectes. Nous ne pouvons pas mesurer directement la capacité d’innovation
d’un pays (par exemple, il nous est souvent possible d’utiliser comme mesure
indirecte les dépenses de R&D ou celles qui sont liées aux innovations).
Nous ne pouvons pas non plus mesurer directement l’ampleur d’une protection par
brevet dans un pays (bien que des indices aient été mis au point en utilisant
un mélange de mesures indirectes). L’utilisation de l’économétrie, qui tente
d’isoler l’effet indépendant des DPI sur des variables économiques, est souvent
contestée, notamment lorsqu’il s’agit de savoir si elle démontre une
association plutôt qu’une relation de cause à effet. Par exemple, certaines
autorités avancent que l’absence de protection de la PI encourage le transfert
de technologie et l’apprentissage technologique (grâce à la copie et à
l’imitation). D’autres estiment que la protection de la PI est un mécanisme qui
encourage le transfert de technologie de l’étranger par l’investissement direct
ou la concession de licences et que les effets indirects sont un moyen efficace
d’apprentissage technologique. Savoir où se situe la réalité peut être
difficile pour les responsables politiques.
Les pays en développement sont,
en tant que groupe, des importateurs nets de technologie, dont la plus grande
partie est fournie par les pays développés. Les organisations situées dans les
pays développés possèdent une proportion écrasante des droits de brevet dans le
monde. Des modèles économétriques ont été élaborés pour estimer les incidences
qu’aurait dans le monde l’application des dispositions de l’Accord sur les
ADPIC (c’est-à-dire la mondialisation des normes minimales de protection de la
PI). Selon la dernière estimation de la Banque mondiale, la plupart des pays
développés seraient les principaux bénéficiaires de l’application de ces
dispositions qui renforcerait la valeur de leurs brevets, le gain pour les
Etats-Unis étant estimé à 19 milliards de dollars par an.[59]
Les pays en développement et quelques pays développés seraient des perdants
nets. Dans cette étude, la Banque mondiale montre que le pays qui subirait la
perte la plus importante serait la Corée (15 milliards de dollars). Il ne faut
pas tirer de conclusions trop hâtives de la valeur exacte de ces chiffres, qui
dépendent de plusieurs hypothèses discutables, mais on peut certainement
affirmer que l’application des droits de brevet dans le monde procurerait un
avantage considérable aux titulaires de droits de brevet, principalement dans
les pays développés, aux dépens des utilisateurs de technologies et de biens
protégés des pays en développement. Entre 1991 et 2001, l’excédent net
américain des redevances et droits (principalement liés à des transactions de
PI) est passé de 14 milliards de dollars à plus de 22 milliards de dollars.[60] En 1999, les chiffres cités par la Banque
mondiale indiquent pour les pays en développement un déficit qui se chiffrerait
à 7,5 milliards de dollars pour les redevances et les droits de licence.[61]
Il n’est pas surprenant que les
DPI tendent à avantager les pays développés et cela explique pourquoi
l’industrie a exercé des pressions dans les pays développés pour l’adoption de
l’Accord sur les ADPIC. Mais les calculs ci-dessus prennent uniquement en
compte l’élément coût de l’équation des DPI pour les pays en développement.
Pour que ces pays puissent retirer des avantages des DPI, il faudra que ces
avantages résultent de la promotion de l’invention et de l’innovation
technologique, et consolident ainsi la croissance.
Peu de travaux de recherche
économique sur les pays en développement établissent un lien direct entre le
régime de DPI, d’une part, et l’innovation et le développement au niveau
national, d’autre part. Une démarche commune à l’Allemagne et aux pays de
l’Asie de l'Est (y compris la Chine) a
été l’introduction de modèles d’utilité (ou petits brevets) faciles à obtenir,
qui associaient une norme inférieure d’activité inventive à un enregistrement
plutôt qu’un examen et à une durée de protection plus courte.[62]
Lors de leur introduction en Allemagne en 1891, ils fournissaient une
protection de trois ans (renouvelable pour trois autres années) et vers les
années 30, il était délivré deux fois plus de modèles d’utilité que de brevets
examinés.[63] Les
études relatives au système des brevets japonais portant sur la période
1960-1993 laissent penser que les modèles d’utilité ont joué un rôle plus
important que les brevets dans l’augmentation de la productivité.[64]
Certaines données factuelles permettent également d’établir un lien entre
l’innovation observée dans certains secteurs au Brésil et aux Philippines et la
disponibilité de ces modèles d’utilité.[65]
Au Japon, les données montrent qu’un système de protection légère fondée sur
les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels a facilité
l’innovation progressive par les petites entreprises, ainsi que l’absorption et
la diffusion de la technologie. Ceci a été associé, comme à Taïwan et en Corée,
à l’absence de la protection par brevet concernant les produits pharmaceutiques
et chimiques. Le Japon n’a introduit de protection pour ces derniers produits
qu’en 1976.[66]
On possède plus
de données sur l'incidence de la protection par brevet dans les pays
développés. Il semblerait que les grandes entreprises accordent une très grande
importance à la protection par brevet dans certains secteurs (les produits
pharmaceutiques, par exemple), mais que dans de nombreux secteurs, les brevets
ne soient pas considérés comme d'importants éléments déterminants de l'innovation.[67] De plus, les brevets
semblent n’être guère utilisés par les petites et moyennes entreprises de la
plupart des secteurs de nombreux pays développés comme moyen de promouvoir leur
innovation ou comme source d’informations techniques utiles. Importante
exception cependant, le secteur biopharmaceutique, car les laboratoires
considèrent leur portefeuille de brevets comme leur atout commercial le plus
précieux.[68]
Une grande étude entreprise récemment au Royaume-Uni a conclu que « les
régimes de PI conventionnels ne sont applicables qu’à une petite proportion de
l’activité économique, comme les grandes industries manufacturières ».
D’autres méthodes non conventionnelles de protection, et permettant d’obtenir
des informations techniques, étaient en général considérées comme plus
efficaces pour les PME.[69]
De notre point de vue, la
question essentielle est de savoir dans quelle mesure les DPI encouragent la
croissance. Les données factuelles que nous avons examinées ne permettent pas
de déceler dans les pays en développement d’effets directs considérables sur la
croissance économique.[70]
Une étude récente a montré que plus une économie est ouverte (aux échanges),
plus les droits de brevet vont vraisemblablement avoir un effet sur la
croissance. Selon les calculs effectués, dans une économie ouverte, des droits
de brevet plus forts pourraient augmenter les taux de croissance de 0,66 % par
an.[71] Mais on peut se poser la question des
relations de cause à effet car l’ouverture aux échanges et la vigueur du régime
de DPI tendent en tout cas à augmenter avec le revenu par habitant.
D’autres faits
semblent indiquer que l’intensité de la protection par brevet augmente avec le
développement économique, mais ceci ne se produit pas avant de parvenir à de
hauts niveaux de revenu par habitant. D’ailleurs, avant le renforcement mondial
récent des législations en matière de PI, on avait observé un rapport
relativement constant entre l’intensité des droits de PI et le revenu par
habitant. Lorsque les niveaux de revenu sont faibles, la protection est assez
élevée (ce qui reflète les influences coloniales passées), mais ensuite elle
baisse à un point bas, indiquant une protection faible, lorsque le revenu
atteint environ 2 000 dollars (aux prix de 1985) par habitant. Ce point
bas est maintenu jusqu’à ce que le revenu par habitant arrive à près de
8 000 dollars, moment où la protection recommence à augmenter. Cette
relation n’est pas nécessairement de cause à effet, mais elle indique qu’avant
de parvenir à des niveaux relativement élevés de revenu par habitant, la
protection de DPI n’est pas une forte priorité dans la politique d’un pays en
développement.[72]
Peut‑être les données
factuelles les plus simples pour indiquer l’impact du système de PI se
trouvent-elles dans son degré d’utilisation, notamment par les ressortissants
d’un pays. La propension à déposer des demandes de brevets traduira dans une
certaine mesure la perception de leurs avantages, même s’il s’agit d’avantages
privés plutôt que d’avantages pour la société. En 1998, l’Afrique subsaharienne
(à l’exception de l’Afrique du Sud) a délivré 35 brevets à des résidents contre
741 à des non‑résidents. Par contre en Corée, 35 900 brevets ont été
délivrés à des résidents contre 16 990 à des non‑résidents. Aux Etats‑Unis,
les chiffres correspondants étaient respectivement de 80 292 et
67 228.[73]
La principale
conclusion semble être que pour les pays en développement qui ont acquis
d’importantes capacités technologiques et innovatrices, on a pu constater
généralement un lien entre les formes faibles plutôt que vigoureuses de
protection de la PI dans la période formatrice de leur développement
économique. Par conséquent, nous pouvons conclure que dans la plupart des pays
à faible revenu, dont l’infrastructure scientifique et technologique est
limitée, la protection de la PI aux niveaux prévus dans l’Accord sur les ADPIC
n’est pas un important facteur de renforcement de la croissance. Au contraire,
une croissance rapide est plus souvent associée à une protection de la PI plus
faible. Dans les pays en développement avancés du point de vue technologique,
on peut constater que la protection de la PI devient importante à un certain
stade de développement, mais ce stade n’est pas atteint tant qu’un pays n’est
pas bien installé dans la catégorie des pays en développement à revenu
intermédiaire supérieur.[74]
Bien que les incidences directes
sur la croissance soient difficiles à discerner, de gros efforts ont été
consacrés à l’évaluation de l’impact d’un changement des DPI sur le commerce et
l’investissement étranger. Certains de ces travaux ne sont pas très utiles pour
notre étude. Ils ne portent pas principalement sur les incidences des DPI dans
les pays en développement, car ils cherchent plutôt à établir quel effet un
renforcement de ces droits dans les pays en développement pourrait avoir sur
les exportations et les investissements des pays développés. Ces deux approches
sont différentes.
Par exemple, certaines études
montrent qu’un renforcement des droits de brevet dans les pays en développement
augmenterait de manière significative les importations provenant des pays
développés (ou même d’autres pays en développement).[75] La raison en est que certaines importations
constituent une forme de transfert de technologie (par exemple, les
importations de machines de haute technologie ont un impact indépendant sur la
productivité). Mais le renforcement des DPI peut surtout entraîner une
augmentation des importations d’articles de consommation de faible contenu
technologique et est associé au déclin des industries locales fondées sur
l’imitation,[76] ce
qui pour un pays en développement constitue bien évidemment un bienfait tout
relatif. L’accès aux importations de technologie de pointe, auparavant
inaccessibles par manque de protection de la PI, pourrait en être facilité,
mais le coût serait probablement très important, du fait des pertes
enregistrées au niveau de la production et de l’emploi, ou même d’un
ralentissement de la croissance. Cette question est maintenant tout à fait
d’actualité dans des pays comme la Chine. Ces études impliquent également que
dans les pays où les capacités technologiques sont faibles, les importations
pourraient diminuer car les lois en matière de brevets provoquent une
augmentation du prix moyen des importations et, par conséquent, réduisent la
capacité d’importation. Dans le passé, les pays se sont protégés contre les
effets éventuellement négatifs d’une augmentation des importations sur
l’industrie nationale en prenant des dispositions relatives à l’exploitation
obligatoire des brevets, comme la Suisse l’a fait au XIXe siècle.
En ce qui
concerne les analyses de l’impact sur l’investissement étranger, nous avons des
réserves du même ordre. De nombreuses études examinent les incidences d’un
renforcement des DPI sur l’investissement étranger, le comportement en matière
de concession de licences et le transfert de technologie. Une grande partie de
ces ouvrages ne parviennent qu’à des conclusions provisoires, en raison de la
faiblesse des données ou de la méthodologie.[77] Sur la base des ensembles de données dont elles disposent,
ces études recherchent surtout les répercussions d’un renforcement des droits
de brevet dans les pays en développement sur l’investissement, la production et
la concession de licences des multinationales américaines dans ces pays. Voici
par exemple l’une des conclusions auxquelles est parvenue une étude récente,
mais tout à fait représentative de celles auxquelles sont parvenues d’autres
études reposant sur des ensembles de données similaires :
« … ces résultats montrent que si un pays en
développement moyen renforçait son indice de dépôts de brevets d’une unité, les
ventes locales des filiales américaines augmenteraient … d’environ 2 % de la
moyenne des ventes annuelles … une augmentation d’une unité dans l’indice de
dépôts de brevets d’une économie en développement moyenne augmenterait le stock
d’éléments d’actifs des filiales multinationales américaines de ... quelque 16
% du stock moyen d’éléments d’actifs. »[78]
Pour les
responsables politiques d’un pays en développement, le cadre et les questions
pourraient être bien différents. Le responsable politique souhaitera savoir si
un renforcement des DPI aurait des répercussions sur la croissance économique,
l’emploi, l’investissement et la R&D dans le secteur privé, l’accès à la
technologie étrangère, le processus d’innovation au niveau national et les
exportations (ainsi que sur les importations). Très peu d’études abordent
directement ces questions d’importance cruciale pour les responsables
politiques des pays en développement, et moins encore parviennent à des
conclusions précises sur l’impact des DPI.
Ce qui se
dégage très clairement de toutes les études effectuées sur la question, c’est
que des DPI forts ne sont à eux seuls ni nécessaires ni suffisants pour inciter
les entreprises à investir dans certains pays. S’il en était ainsi, certains
grands pays où le taux de croissance est élevé, mais le régime de DPI faible,
n’auraient alors pas bénéficié, ni hier, ni aujourd’hui, des grands courants de
l’investissement étranger. C’est le cas d’une grande partie des économies de
l’Asie de l'Est et de l’Amérique latine qui ont été l’objet de la majorité de
ces entrées de capitaux.[79] Si l’on cherche à savoir
quels sont les principaux facteurs qui déterminent les investissements
étrangers, très souvent les DPI sont complètement omis. Dans leurs rapports
récents sur les flux d’investissement, certaines institutions et certains
organismes internationaux ne citent pratiquement jamais les DPI. Voir par
exemple le rapport de la Banque mondiale sur le financement du développement
dans le monde 2002,[80] et le rapport Zedillo sur
le financement du développement.[81] De même, un récent projet
de rapport de la Banque mondiale concernant l’amélioration du climat de
l’investissement en Inde ne fait aucune allusion au rôle des DPI. [82]
Comme nous
l’avons fait remarquer, certaines données indiquent que pour certaines
industries (comme la chimie) et activités (comme la R&D), les DPI peuvent
jouer un rôle important lorsque les entreprises décident d’investir.[83] Mais les décisions
d’investissement dépendent de nombreux facteurs. Pour la plupart des industries
à faible technologie, comme celles que les pays en développement
technologiquement moins avancés vont probablement attirer, il est vraisemblable
que les DPI n’entreront pas pour beaucoup dans la décision d’investir. Lorsque
les technologies sont plus évoluées, tout en étant relativement faciles à
copier, les DPI pourraient être, mais pas nécessairement, un facteur important
dans la décision d’investir, à condition toutefois qu’un pays dispose à la fois
de la capacité scientifique de copier et d’un marché suffisamment important
pour justifier le coût de la délivrance du brevet et des mesures nécessaires à
son respect, et que d’autres facteurs pertinents soient également favorables.
Dans d’autres cas cependant, l’introduction de la protection de la PI est
associée, comme on l’a noté plus haut, à une augmentation des importations
plutôt qu’à un investissement dirigé vers la production locale. Finalement,
dans les industries de pointe et pour les pays ayant des capacités
technologiques avancées, les propriétaires d’une technologie peuvent décider de
concéder des licences pour leurs technologies, protégées par le régime de PI,
plutôt que d’investir directement dans la production. Ainsi, des droits
rigoureux peuvent dissuader les flux d’investissement, mais faciliter le
transfert de technologie par l'octroi de licences, sujet sur lequel nous
reviendrons dans la prochaine section.
Voici ce que
nous pourrons donc conclure des études existantes :
·
Il
semble bien que les flux commerciaux en direction des pays en développement
soient influencés par l’ampleur de la protection de la PI, notamment en ce qui
concerne les industries (souvent de pointe) qui dépendent des DPI (par exemple,
les produits chimiques et pharmaceutiques), mais les données factuelles sont
loin d’être claires.
·
Ces
flux peuvent contribuer à créer une capacité productive. Mais ils peuvent
également avoir lieu aux dépens de la production nationale et des emplois liés
au « copiage » local et dans d’autres industries. Les pays en
développement n’ayant que peu, ou pas, d’infrastructures technologiques, vont
subir les effets préjudiciables des prix plus élevés dus à l’importation de
biens protégés par la PI.
·
Il
n’existe aucune preuve que l’investissement étranger soit positivement associé
à une protection de la PI dans la plupart des pays en développement.
·
En ce
qui concerne les pays en développement plus avancés du point de vue
technologique, les DPI pourraient contribuer à faciliter l’accès aux
technologies de pointe protégées, en ayant recours aux investissements
étrangers ou à l'octroi de licences.
·
Un
équilibrage sera peut-être difficile pour certains pays comme l’Inde ou la
Chine où certaines industries ont les moyens de tirer avantage d’une protection
de la PI, mais les coûts associés pour les industries qui ont été créées dans
un régime de PI peu rigoureux ainsi que pour les consommateurs pourraient être
élevés.
·
La
plupart des données factuelles relatives au rôle de la PI dans le commerce et
l’investissement portent sur les pays en développement qui sont plus avancés du
point de vue technologique. Pour les autres, nous concluons qu'il n'est guère
probable que les effets bénéfiques sur le commerce et l’investissement
l'emporteront sur les coûts, tout au moins à court ou moyen terme.
Dans un certain
sens, la question essentielle en ce qui concerne la PI n’est pas de savoir si
elle encourage le commerce ou l’investissement étranger, mais dans quelle
mesure elle facilite ou entrave l'accès des pays en développement aux
technologies nécessaires à leur développement. Si un fournisseur de technologie
étrangère concède une licence de production à une entreprise nationale, plutôt
que d’établir lui-même une fabrication locale, un investissement étranger
moindre aura été attiré. Toutefois, le résultat d’ensemble peut être plus
favorable à l’économie nationale en raison de la contribution indirecte aux
capacités technologiques nationales. Si les importations de technologie de
pointe augmentent du fait du renforcement des régimes de PI, un transfert de
technologie peut être obtenu (concrétisé par exemple par des biens d’équipement),
mais il n’est nullement garanti que l’économie nationale sera capable
d’absorber cette technologie pour servir de base à des innovations ultérieures.
Par conséquent, le transfert de technologie peut très bien ne pas être durable.
Au contraire, comme nous l’avons vu, certains pays peuvent utiliser des régimes
de PI atténuée comme moyen d’accéder aux technologies étrangères et de les
développer grâce à l’ingénierie inverse, renforçant ainsi les capacités
technologiques nationales. La possibilité pour les pays en développement de
suivre cette voie est maintenant limitée par la mise en œuvre de l’Accord sur
les ADPIC.
Mais les
facteurs qui déterminent l’efficacité d’un transfert de technologie sont
nombreux et variés. Il est également absolument indispensable que les pays
puissent absorber les connaissances venant d’ailleurs et en faire usage après
les avoir adaptées à leurs propres objectifs. Cette capacité dépendra du
développement des compétences locales par l’enseignement, la R&D et la mise
en place des institutions appropriées sans lesquelles même le transfert de
technologie effectué aux conditions les plus avantageuses ne constituera pas
une réussite. Pour être efficace, le transfert de technologie exige aussi
souvent le transfert d’un savoir « tacite » difficilement codifiable
(comme, par exemple, dans des divulgations de brevet ou des manuels
d’instruction). C’est pourquoi même les programmes les mieux conçus pour
encourager les compétences nationales dans le domaine de la recherche, qui sont
financés par des bailleurs de fonds, n’ont pas toujours abouti à d’excellents
résultats. Etant donné que de nombreuses technologies présentant un intérêt
pour les pays en développement sont produites par des organisations situées
dans les pays développés, il faut pour acquérir des technologies être capable
de négocier de manière efficace en ayant une bonne compréhension du secteur
technologique particulier. Pour cela, le bénéficiaire de cette technologie doit
être bien décidé à acquérir les ressources humaines nécessaires et à mettre en
place les institutions appropriées. Des pays comme la Corée ont commencé à un
niveau d'expertise technologique très bas il y a quarante ans, comparable à
celui de nombreux pays à faible revenu, mais sont maintenant devenus de
véritables innovateurs.
Cet aspect du
transfert de technologie dépend dans une large mesure des pays en développement
eux-mêmes. Mais cela ne veut pas dire que les pays développés, ou plus
généralement les politiques internationales, ne peuvent pas faciliter ou
entraver le processus. L’Accord sur les ADPIC reconnaît dans son article 7
que les DPI devraient contribuer « au transfert et à la diffusion de la
technologie » mais également, dans son article 8, que des mesures
pourront être nécessaires afin d’éviter l’usage abusif des DPI, notamment le
recours à des pratiques qui « sont préjudiciables au transfert
international de technologie ». L’article 40 comporte des
dispositions visant à prévenir l’insertion de pratiques anticoncurrentielles
dans les licences contractuelles. L’article 66.2 oblige les pays développés à
offrir des incitations aux entreprises et aux institutions sur leur territoire
en vue de promouvoir et d’encourager le transfert de technologie vers les pays
les moins avancés (PMA) pour « leur permettre de se doter d’une base
technologique solide et viable ». Ces dispositions de l’Accord sur les
ADPIC reflètent certaines des dispositions du projet de Code international de
conduite pour le transfert de technologie, à propos duquel les négociations
entre pays développés et en développement ont échoué dans les années 80.[84]
Depuis lors,
l’économie mondiale a changé. Il faut noter que dans le monde, les politiques
économiques ne reposent plus maintenant sur la substitution des importations et
l’industrialisation dirigée protégée par des barrières tarifaires élevées, mais
s’orientent vers des politiques de marché ouvert qui insistent sur les
avantages des tarifs douaniers peu élevés, de la concurrence mondiale et d’un
rôle moins directif du secteur public dans le développement économique. La
croissance des industries, qu’il est convenu d’appeler fondées sur le savoir,
et des échanges de produits de haute technologie augmente simultanément.
L’importance de la R&D s’est accrue et les cycles de vie des produits se
sont raccourcis. Dans cet environnement libéralisé et concurrentiel, les
entreprises des pays en développement ne peuvent plus entrer en concurrence en
recourant à l'importation de technologies « bien maîtrisées » en
provenance des pays développés pour les produire à l'abri de barrières
tarifaires. Et les entreprises elles-mêmes ne sont plus aussi enthousiastes à
l'idée de transférer des technologies susceptibles d’augmenter la concurrence à
laquelle elles doivent faire face.
Par conséquent,
il ne s'agit plus tant d’obtenir des technologies plus ou moins bien maîtrisées
à des conditions justes et équitables, mais plutôt d’avoir accès aux
technologies de pointe nécessaires pour être compétitif dans l’économie
mondiale d’aujourd’hui. L’Accord sur les ADPIC a renforcé la protection
mondiale offerte aux fournisseurs de technologie, mais aucun cadre
international ne permet de veiller à ce que le transfert de technologie se
déroule dans un cadre concurrentiel capable de minimiser les pratiques restrictives
de concession de licences de technologie, qui faisaient l’objet du Code.
Nous hésitons
sur le meilleur moyen de combler cette lacune du cadre international. Reprendre
les discussions en vue d’un Code de conduite n’est pas une option viable dans
le nouvel environnement. Mais nous estimons qu’encourager et aider les pays en
développement à élaborer leurs propres systèmes législatifs en matière de
concurrence permettraient de mieux servir leurs intérêts. L’élaboration d’un
cadre de politique internationale de la concurrence est examiné depuis quelque
temps au sein de l’OMC. Nous comprenons bien que les pays en développement
n’aient guère envie de s’embarquer dans cette voie, mais l’élaboration de lois
nationales en matière de concurrence et l’existence d’une coopération
internationale efficace pourraient permettre de faire contrepoids à certains
aspects de l’Accord sur les ADPIC qui ont pour effet de limiter la concurrence
à l’échelon mondial et d’entraver le transfert de technologie dans certaines circonstances.
Pour ce qui
concerne l’Accord sur les ADPIC, les données factuelles indiquent que les
dispositions de l’article 66.2 n’ont pas été efficaces. Les pays développés ne
semblent pas avoir pris de mesures supplémentaires pour encourager leurs entreprises
et leurs institutions à transférer leurs technologies. De plus, le fait que cet
article s’applique uniquement aux PMA semble être indûment restrictif. Comme
nous l’avons indiqué ci-dessus, ces pays sont probablement ceux qui, pour la
plupart, ont les capacités d’absorption les plus faibles. Nous ne pensons pas
par conséquent que l’article 66.2 soit la meilleure manière d’aborder toute la
question du transfert de technologie vers les pays en développement. De plus,
certaines des dispositions concernant les DPI, utilisées jusqu’à présent pour
faciliter le transfert de technologie, telles que l’utilisation de
l’exploitation obligatoire, ont été considérablement atténuées par l’Accord sur
les ADPIC. Etant donné que la plupart des technologies se trouvent entre des
mains privées et que l’Accord sur les ADPIC se préoccupe surtout de la
protection des DPI, plutôt que du transfert de technologie, nous ne sommes pas
certains que le point de convergence pour une discussion sur le transfert de
technologie soit l’Accord sur les ADPIC, plutôt que l’OMC en général.
Nous nous
félicitons par conséquent de la création du Groupe de travail du commerce et du
transfert de technologie qui fera rapport à la Conférence ministérielle de
l’OMC l’année prochaine.[85] Nous proposons qu’il
examine notamment la question de savoir si l’Accord sur les ADPIC ne pourrait
pas être amélioré dans son rôle de mécanisme visant à encourager le transfert
de technologie, et si certaines mesures ne seraient pas souhaitables pour
veiller à ce que le système des DPI encourage le transfert de technologie et
n’y fasse pas obstacle. Toutefois, nous estimons que la gamme des mesures
complémentaires nécessaires pour encourager le transfert de technologie est
tout aussi importante.
Bien que la
majorité de la technologie appliquée se trouve entre des mains privées, il est
important de se souvenir que les dépenses publiques consacrées à la recherche
fondamentale et appliquée jouent un certain rôle dans le financement du
développement technologique. Les fonds publics consacrés à la recherche dans
les pays développés ont actuellement pour objectif déclaré de renforcer la
compétitivité internationale et, de plus en plus, les résultats de cette
recherche peuvent être brevetés, comme nous l’examinons au chapitre 6. Non
seulement le financement de la recherche est souvent lié aux citoyens d’un
pays, ce qui est peut-être compréhensible, mais les avantages de cette
recherche risquent de ne bénéficier qu’aux citoyens de ce pays. Par exemple, la
loi américaine limite la plupart des concessions de licences de technologies
financées par le secteur public aux ressortissants américains, politique dont
la logique scientifique et économique est moins claire.[86]
Une grande partie de l'agenda en matière de
transfert de technologie va bien au-delà de notre mandat, mais nous estimons
que les mesures suivantes doivent être examinées avec soin :
·
Il faudrait envisager d'adopter dans les
pays développés des politiques d’incitation appropriées pour encourager les
transferts de technologie, par exemple des allégements fiscaux pour les
entreprises qui concèdent des licences aux pays en développement.
·
Il faudrait instaurer des politiques
efficaces en matière de concurrence dans les pays en développement.
·
Davantage de financements publics
devraient être disponibles pour renforcer les capacités scientifiques et
technologiques locales dans les pays en développement grâce à la coopération
scientifique et technologique. Par exemple, le projet d’Alliance mondiale de la
recherche (Global Research Alliance)[87]
entre les institutions de recherche des pays développés et des pays en
développement mérite d'être soutenu.
·
Des engagements devraient être souscrits
pour garantir que les avantages tirés des recherches financées par les fonds
publics sont à la disposition de tous.
·
Des engagements devraient être souscrits
pour garantir un libre accès aux bases de données scientifiques.
Chapitre 2
SANTE
INTRODUCTION
La question
Les incidences des règles et
pratiques en matière de PI sur la santé des pauvres des pays en développement
ont suscité une controverse importante au cours de ces dernières années. Bien
que cette controverse ait existé avant la conclusion de l’Accord sur les ADPIC[88]
et qu’elle ait figuré en bonne place dans les négociations sur cet Accord,
l’élan a été renforcé par l’entrée en vigueur de l’Accord sur les ADPIC et
l’augmentation spectaculaire de l’incidence du VIH/SIDA, notamment dans les
pays en développement. Pour les pays développés, l’industrie pharmaceutique a
été l’un des principaux défenseurs de l’extension mondiale des droits de PI.[89]
Pour les pays en développement, le souci principal était de savoir quelle
influence l’adoption de régimes de PI aurait sur leurs efforts visant à
améliorer la santé publique et sur le développement économique et technologique
en général, notamment si l’introduction d’une protection par brevet avait pour
conséquence d’augmenter le prix et de réduire le choix des sources de
provenance des produits pharmaceutiques.
Nous sommes conscients de l’importance
d’une protection par brevet efficace pour l’industrie la plus directement
impliquée dans la découverte et la mise au point de nouveaux produits
pharmaceutiques. D’ailleurs, sans l’incitation fournie par les brevets, il est
peu probable que le secteur privé eût investi autant d'argent pour découvrir ou
mettre au point des médicaments, dont un grand nombre est actuellement utilisé
dans les pays tant développés qu’en développement. Dans les pays développés,
l’industrie pharmaceutique dépend plus fortement du système des brevets que la
plupart des autres secteurs industriels pour récupérer le coût de la R&D
antérieure, créer des bénéfices et financer la R&D pour la mise au point de
futurs produits. De nombreuses études ont montré que les entreprises pharmaceutiques,
plus que tout autre secteur, estiment que la protection par brevet est très
importante pour la continuité de leurs dépenses de R&D et de l’innovation
technologique.[90]
L’industrie se penche donc avec beaucoup d’intérêt sur la mise en place des DPI
dans le monde et s’oppose en général à l’affirmation qu’ils constituent un
obstacle majeur à l’accès ou ont un effet dissuasif s’agissant du développement
des pays en développement. Par exemple, Sir Richard Sykes, ancien président de
GSK, a déclaré en mars de cette année
:
« Rares sont ceux qui s’élèveraient contre la nécessité
d’une protection de la PI dans le monde développé, mais certains se demandent
s’il faut vraiment étendre sa couverture au monde en développement, ce que
l’Accord sur les ADPIC est en train de faire progressivement. Comme je vous
l’ai dit, ce n’est pas à cause de la protection de la PI que les pays en
développement sont privés actuellement de l’accès aux médicaments. A Doha en
novembre dernier, les membres de l’OMC ont convenu de repousser la mise en
œuvre de l’Accord sur les ADPIC pour les pays les moins avancés jusqu’à 2016.
Je ne pense pas que l’Accord sur les ADPIC empêchera d’autres pays en
développement comme le Brésil et l’Inde d’avoir accès aux médicaments dont ils ont
besoin. Par contre, je pense sincèrement que ces pays ont les capacités
nécessaires pour créer leurs propres industries pharmaceutiques fondées sur la
recherche, ainsi que d’autres industries innovantes, mais que ceci ne se
produira que lorsqu’ils offriront la protection de la PI prévue par l’Accord
sur les ADPIC. Cet Accord doit être reconnu comme un instrument de
développement industriel important pour les pays en développement. »[91]
Ceci dit, nous
sommes aussi tout à fait conscients des préoccupations qui ont été exprimées
par les pays en développement et en leur nom sur les incidences éventuelles de
ces droits dans ces pays, notamment sur le prix des produits pharmaceutiques.
Si les prix sont augmentés, ce sont surtout les pauvres qui en pâtiront, notamment
en l’absence de la fourniture généralisée de services de santé publique, comme
c’est le cas dans la plupart des pays développés. C’est pourquoi d’autres
représentants de nombreux pays en développement et de la communauté des ONG ont
avancé des arguments contraires :
« Pourquoi les pays en développement s’opposent-ils si
fortement à l’Accord sur les ADPIC ? Son défaut essentiel est d’obliger tous
les pays, riches et pauvres, à conférer une protection par brevet d’une durée
d’au moins 20 ans aux nouveaux médicaments, ce qui retarde la production de
substituts génériques moins coûteux dont dépendent les services de santé des
pays en développement et les populations pauvres. Et il n’y a pas d’aspect
positif : les augmentations de bénéfices obtenues par les entreprises
pharmaceutiques internationales sur les marchés du monde en développement ne
seront pas réinjectées dans des travaux de recherche supplémentaires sur les
maladies concernant les populations pauvres, ce que certaines entreprises
admettent en privé. »[92]
Notre point de départ dans cette
analyse, c’est que les considérations de soins de santé doivent être le
principal objectif lorsque l’on détermine quelle sorte de régime de PI devrait
être appliqué aux produits de soins de santé. Les DPI ne sont pas conférés pour
accorder des bénéfices à l’industrie, sauf dans la mesure où ils sont utilisés
pour permettre d’améliorer à long terme les soins de santé. Il faut par
conséquent surveiller de très près ces droits de façon à ce qu’ils fassent
réellement progresser les objectifs de soins de santé et, surtout, qu’ils ne
constituent pas un obstacle à la prestation de soins de santé aux populations
pauvres des pays en développement.
Contexte
La pandémie du VIH/SIDA a relancé
une grande partie du débat récent, bien que la question de l’accès aux
médicaments dans les pays en développement ait une plus grande portée. Il faut
absolument empêcher que le débat dans ce domaine soit indûment influencé par
l’expérience du VIH/SIDA, bien qu’elle soit dramatique. Hormis le VIH/SIDA, qui
est la cause la plus importante de mortalité dans les pays en développement, la
tuberculose et le paludisme font presque autant de victimes. A elles trois, ces
maladies ont causé près de six millions de morts l’année dernière et entraîné
des maladies débilitantes pour des millions de personnes.[93]
De plus, il existe plusieurs maladies moins courantes importantes du point de
vue collectif, notamment la rougeole, la maladie du sommeil, la leishmaniose et
la maladie de Chagas.[94]
Chaque groupe de maladies
présente des problèmes différents quant à l’élaboration de remèdes et
traitements et à l’économie du processus de R&D. Pour les maladies
répandues dans les pays développés et en développement, comme le VIH/SIDA, le
cancer ou le diabète, la recherche menée dans le secteur privé ou public du
monde développé peut produire des traitements qui conviennent également au
monde en développement. Pour ces maladies, on peut s’attendre à ce que la
promesse d’une bonne protection de la PI dans le monde développé soit une
incitation majeure à investir dans la R&D. Mais il convient de signaler que
certaines souches de VIH/SIDA en Afrique, par exemple, sont différentes de
celles que l’on trouve dans les pays développés et qu'il faudra par conséquent
peut-être mettre au point des traitements différents.
Là où il existe déjà des
traitements appropriés, ils ne sont accessibles que si leur prix est abordable
et si l’on dispose de l’infrastructure de services sanitaires capables
d’assurer leur prestation. Nous estimons que le coût des produits
pharmaceutiques est une préoccupation importante dans les pays en
développement, parce que la plupart des pauvres dans ces pays doivent payer
leurs propres médicaments et que la fourniture de médicaments par l’Etat est habituellement
sélective et limitée par les ressources disponibles. Ce n’est généralement pas
le cas dans le monde développé où les dépenses sont principalement couvertes
par l’Etat ou par des caisses d’assurance. Mais même dans ce cas, le coût des
médicaments est une question politique controversée dans les pays développés,
pour les pouvoirs publics et pour les malades qui ne sont pas couverts par des
régimes d’assurance privée ou publique efficaces.[95]
Dans les pays en développement, l’insuffisance des infrastructures est un
problème grave qui peut aboutir même à ce que des médicaments bon marché ne
soient pas utilisés, ou qu’ils soient mal utilisés et contribuent à l’émergence
d’un virus ou de pathogènes pharmacorésistants.
Le VIH/SIDA illustre bien ici
aussi ce genre de problèmes. Le traitement du VIH par les antirétroviraux
(ARV), ou médicaments traitant les infections opportunistes associées à la
maladie, pose de manière aiguë la question de l’accessibilité économique. Les
coûts annuels minimaux des thérapies ARV, même à des prix fortement réduits ou
génériques qui ne couvrent pas les frais de R&D, dépassent de beaucoup les
dépenses sanitaires annuelles par habitant de la plupart des pays en
développement. Les dépenses sanitaires actuelles par habitant dans les pays en
développement à faible revenu sont d’environ 23 dollars par an, mais les
trithérapies ARV les moins chères coûtent actuellement un peu plus de 200
dollars par an.[96] Donc, si aucun financement supplémentaire
n’est consacré aux médicaments et aux services de prestation de soins de santé,
le traitement de tous ceux qui en ont besoin restera inaccessible même aux prix
génériques les plus bas. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que
moins de 5 % de ceux qui ont besoin d’un traitement pour le VIH/SIDA reçoivent
des ARV. Seulement environ 230 000 personnes sur les 6 millions dont
on estime qu’elles ont besoin d’un tel traitement dans le monde en
développement le reçoivent en réalité et près de la moitié d’entre elles vivent
au Brésil.[97]
Des questions semblables
concernant l'accessibilité économique se posent pour le traitement d'autres
maladies. Par exemple, la tuberculose et le paludisme sévissent principalement
dans les pays en développement, bien que l'on constate une reprise de la tuberculose
dans le monde développé. Il faut également se souvenir que la tuberculose est
la principale cause de décès chez les personnes infectées par le VIH et
qu'environ un tiers d'entre elles ont une co-infection par la tuberculose.[98]
Pour ces maladies, et celles qui touchent exclusivement les pays en
développement, on se demande comment mobiliser les ressources pour la R&D
menée dans les secteurs privé et public pour les nouveaux médicaments et, après
qu'ils ont été mis au point, comment garantir l'accès à ceux qui en ont
besoin.
Ce dernier point est l'une des
questions les plus importantes concernant les soins de santé dans les pays en
développement. Comment trouver les ressources nécessaires à la mise au point de
nouveaux médicaments et vaccins pour des maladies qui sévissent principalement
dans les pays en développement, et non pas dans les pays développés, alors que
la possibilité de les payer est si limitée ? Même lorsqu'il existe un marché
dans un pays développé qui permette de récupérer les ressources ainsi engagées
grâce à des prix élevés, comment l'accessibilité économique de ces médicaments
dans les pays en développement peut-elle être assurée ? Comment peut-on
résoudre l’opposition entre ces deux objectifs : couvrir les coûts de
R&D et minimiser les coûts pour le consommateur ? Comme dans le cas du
développement technologique en général, le système de PI a-t-il un rôle à jouer
pour ce qui est d'encourager la capacité des pays en développement à mettre au
point et à produire eux-mêmes les médicaments dont eux-mêmes ou d'autres pays
en développement ont besoin ?
Tel est donc le contexte dans
lequel nous devons examiner le rôle que peuvent jouer les DPI lorsqu'il s'agit
résoudre ces dilemmes. Il ne nous appartient pas d'examiner dans le détail l'ensemble
des facteurs qui ont une influence sur la santé des populations pauvres ou sur
la qualité des services de santé dans les pays en développement. Ces thèmes ont
été abordés en détail dans le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé
(CMH)[99]
de l'OMS. Cette Commission a conclu que pour faire face aux besoins sanitaires
des pays en développement, il était nécessaire d'injecter une forte proportion
de fonds publics supplémentaires dans les services de santé et dans les
infrastructures et la recherche en matière de santé. Elle a estimé que la
protection par brevet n'offrait guère de motivation pour la recherche sur les
maladies des pays en développement, en l'absence d'un marché suffisamment
important.[100] En
ce qui concerne l'accès aux médicaments, elle était favorable à une action
coordonnée de manière à créer un système de prix différenciés[101]
en faveur des pays en développement, renforcé si nécessaire par le recours
accru aux licences obligatoires.[102]
Ces conclusions sont tout à fait
appropriées à notre travail actuel. Notre rôle consiste à indiquer avec de plus
amples détails comment les modifications des règles et pratiques en matière de
PI pourraient contribuer à améliorer la santé des populations pauvres, tout en
étant pleinement conscients que ces changements doivent s'accompagner de la
gamme d'actions proposée par la CMH.
A cette fin, nous examinerons
trois questions principales :
·
Comment le système de propriété
intellectuelle contribue-t-il à la mise au point des médicaments et des vaccins
nécessaires aux populations pauvres ?
·
Quelle influence le système de
propriété intellectuelle a-t-il sur l'accès des populations pauvres aux
médicaments et sur leur disponibilité ?
·
Quelles en sont les conséquences pour
les règles et pratiques en matière de propriété intellectuelle ?
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Incitations
à la recherche
On estime que moins de 5 % des fonds consacrés
dans le monde à la R&D pharmaceutique concernent des maladies qui sévissent
principalement dans les pays en développement.[103] La recherche pharmaceutique du secteur privé
est déterminée par des considérations d'ordre commercial et si la demande
effective en termes de marché est réduite, même pour des maladies les plus
communes comme la tuberculose et le paludisme, il est souvent peu intéressant
d'un point de vue commercial de consacrer des ressources importantes à ces
besoins. En 2002, le marché pharmaceutique mondial est évalué à 406 milliards
de dollars, la part du monde en développement étant de 20 %, et celle des pays
en développement à faible revenu bien inférieure encore.[104]
Dans de nombreuses entreprises pharmaceutiques, les objectifs de recherche sont
fixés en se référant à des rendements seuils. Nous avons cru comprendre que les
grandes entreprises pharmaceutiques ne sont pas disposées à s'engager dans une
recherche à moins que les résultats potentiels soient un produit dont les
ventes annuelles atteignent environ 1 milliard de dollars. Etant donné que les
entreprises privées sont principalement responsables devant leurs actionnaires,
il en résulte nécessairement un programme de recherche orienté vers la demande
des marchés du monde développé, plutôt que vers les besoins des populations
pauvres du monde en développement, et par conséquent axé principalement sur les
maladies non transmissibles.
Indépendamment du régime de PI qui prévaut dans
les pays en développement, il n'existe guère en réalité pour le secteur privé
d’incitation commerciale à entreprendre des recherches qui intéressent plus
particulièrement la majorité des pauvres vivant dans les pays à faible revenu.
C'est pourquoi le secteur privé n'entreprend guère ce genre de travaux.
L’ensemble de la R&D pharmaceutique du secteur privé a plus que doublé au
cours de la dernière décennie pour atteindre un chiffre estimé à 44 milliards
de dollars en 2000.[105]
Il est difficile de déterminer quelle proportion exacte de ce chiffre est
consacrée aux maladies touchant principalement les pays en développement.
Toutefois, on a estimé que sur les 1 393 médicaments approuvés entre 1975 et
1999, 13 seulement étaient plus particulièrement indiqués pour les maladies
tropicales.[106]
Lorsque les maladies sont communes à la fois aux pays développés et aux pays en
développement, le tableau est complètement différent. Ainsi, il existe une R&D importante dans
le secteur privé pour le VIH/SIDA. Par contre, les travaux concernant la
tuberculose et le paludisme sont très limités, et il n’y en a pratiquement
aucun pour des maladies comme la maladie du sommeil.[107]
En ce qui concerne le VIH/SIDA, il existe actuellement 64 médicaments approuvés
aux Etats-Unis pour le traitement de cette maladie et des infections
opportunistes, et 103 en cours de mise au point.[108]
Dans le cas du secteur public, comme dans les
Instituts nationaux de la santé (National
Institutes of Health - NIH) aux Etats-Unis ou les Conseils de la recherche
médicale dans d'autres pays développés, la situation n'est guère différente car
les priorités de recherche sont principalement déterminées par des
considérations d'ordre intérieur. Les dépenses du secteur public pour la
recherche en matière de santé ont été estimées à 37 milliards de dollars en
1998, dont 2,5 milliards ont été dépensés dans les pays en développement à
faible revenu et à revenu intermédiaire.[109]
En 2001, les Instituts nationaux de la santé américains ont représenté à eux
seuls plus de 20 milliards de dollars. De plus, les fondations philanthropiques
ont dépensé environ 6 milliards de dollars.[110] Le Programme spécial de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales (TDR) de l’OMS reçoit seulement
environ 30 millions de dollars par an. La proportion exacte des financements du
secteur public destinés aux maladies intéressant directement les pays en
développement n'a pas été estimée de manière officielle, mais il semble peu
probable qu'elle dépasse 10 %.[111]
On se penche actuellement sur cette situation à l'OMS, au Forum mondial de la
recherche en santé, et grâce à l'initiative de Médecins Sans Frontières (MSF)
sur les médicaments relatifs aux maladies négligées, au financement
supplémentaire des fondations et à la création de plusieurs partenariats
public-privé orientés vers certaines maladies particulières.[112] Mais le niveau global de financement de tous
ces nouveaux efforts est toujours très modeste étant donné l'ampleur du
problème et les dépenses de R&D mondiales qui atteignent environ 75
milliards de dollars, et les résultats sont incertains.
Par conséquent, quel rôle la protection de la PI
joue-t-elle pour ce qui est d'encourager la R&D sur les maladies répandues
dans les pays en développement ? Toutes les données factuelles que nous avons
examinées montrent qu'elle ne joue pratiquement aucun rôle, sauf pour les
maladies pour lesquelles il existe également un marché important dans le monde
développé (le diabète ou les cardiopathies, par exemple). Certaines données
indiquent qu'il y aurait une augmentation des indicateurs d'activité de
recherche pour le paludisme depuis que l'Accord sur les ADPIC a été conclu,
mais il n'y a pas de relations claires de cause à effet.[113]
Le cœur du problème, c'est que la demande du marché n’est pas suffisante pour
pousser le secteur privé à engager des ressources dans la R&D. Par
conséquent, nous pensons que la présence ou l'absence d'une protection de la PI
dans les pays en développement est, au mieux, d'importance secondaire en tant
qu’incitation à la recherche sur des maladies répandues dans les pays en
développement.
Cette recherche pourrait donc ne pas suffire en
raison d'une demande inadéquate émanant des pays en développement où la maladie
est concentrée. De plus, il pourrait être nécessaire que la recherche,
notamment sur les vaccins, ait à se concentrer sur certaines caractéristiques
des maladies spécifiques aux pays en développement, alors que la solution
apportée pour le monde développé ne convient pas aux problèmes à résoudre dans
le monde en développement. Par exemple, la majorité des vaccins contre le VIH
sont mis au point pour des profils génétiques du sous-type B, qui sont
fréquents dans la population des pays développés, mais la plupart des malades
du SIDA dans les pays en développement sont de types A et C. La recherche sur
les vaccins contre le VIH est en outre particulièrement difficile du point de
vue scientifique en raison de la manière dont le virus échappe aux réponses immunitaires
naturelles de l'organisme et à cause de ses mutations.[114]
Les travaux de recherche sur les vaccins contre le paludisme posent également
de multiples problèmes en raison de la taille et de la diversité du parasite du
paludisme, et de la complexité de ses mutations.[115]
Par conséquent, pour le secteur privé, la recherche sur les vaccins est un
investissement à haut risque et à faible rendement, notamment en ce qui
concerne les types de maladies qui sont les plus répandus dans les pays en
développement. Le marché tend à sous‑évaluer les avantages que la société
peut retirer des vaccins, souvent supérieurs à ceux des traitements.[116]
Dans le cas du paludisme, la demande du marché porte surtout sur les mesures de
prophylaxie à prendre par les voyageurs venant des pays développés, plutôt que
sur les vaccins qui, eux, seraient beaucoup plus utiles aux malades dans le
monde en développement.
En ce qui concerne la tuberculose, même si on
estime que huit millions de personnes sont atteintes de cette maladie dans les
pays en développement, aucune nouvelle catégorie de médicaments antituberculeux
n'a été élaborée depuis plus de 30 ans. Les traitements actuels demandent des
cures de 6 mois ou plus. Un médicament produisant le même effet en deux mois
pourrait aider de manière spectaculaire à lutter contre cette maladie dans le
monde. Les caractéristiques de la maladie constituent un défi scientifique
important pour la production d'un tel médicament.[117]
Un rapport récent de l'Alliance mondiale pour la mise au point de médicaments
antituberculeux a estimé qu'en se fondant sur la demande du marché (à la fois
privé et public, y compris dans les pays développés), il pourrait y avoir un
taux de rendement financier respectable pour le coût estimé de la mise au point
d'un nouveau produit amélioré. Néanmoins, on persiste à ne pas penser que la
protection de la PI et des aspects économiques favorables encourageront
l'investissement sans participation importante du secteur public.[118]
Le modèle commercial actuel des entreprises pharmaceutiques fondées sur la
recherche est tel que les dépenses de recherche et la création de bénéfices
dépendent de la vente de nouveaux produits à grand succès (normalement avec des
ventes supérieures à 1 milliard de dollars par an), qui aide au financement
d'un haut pourcentage d'échecs dans le processus de R&D.[119] Mais ces entreprises sont libres de
poursuivre des voies plus prometteuses quel qu'en soit le but (par exemple, le
traitement d'une maladie ou d'une affection non envisagée précédemment). Les
aspects économiques de la recherche pour un traitement spécifique d'une maladie
particulière doivent être très favorables pour induire un effort de recherche
significatif.
Certaines personnes, comme Sir Richard Sykes, déjà
cité, ont avancé que fournir une protection de la PI dans les pays en
développement possédant déjà des compétences techniques et scientifiques
importantes aidera à augmenter le volume de la recherche consacrée aux maladies
répandues dans les pays en développement. On ne dispose guère d’éléments de
preuve à ce sujet parce que la plupart des pays intéressés viennent tout juste
d'introduire des législations conformes aux dispositions de l’Accord sur les
ADPIC ou ne l’ont pas encore fait. Mais nous ne voyons pas pourquoi les
entreprises ayant des capacités de recherche dans les pays en développement
réagiraient à la propriété intellectuelle mondiale et aux incitations du marché
de manière véritablement différente des entreprises des pays développés. Dans
une certaine mesure, on peut voir ce comportement de la part d'entreprises se
trouvant dans des pays comme l'Inde.[120]
En réalité, les entreprises privées consacreront des ressources au domaine où
un rendement optimal peut être obtenu. De plus, des dispositions prises dans le
monde entier pour créer des prix différenciés réduiraient les marges destinées
à récompenser la R&D dans les pays en développement, ce qui porterait un
nouveau coup à toute motivation de recherche supplémentaire sur les maladies
des pays en développement.
Bref, nous ne pensons pas que la mondialisation de
la protection de la PI contribuera de manière significative à l'augmentation
des dépenses de R&D du secteur privé consacrées au traitement des maladies
qui touchent plus particulièrement les pays en développement. Pour y parvenir,
la seule manière serait d'augmenter la quantité de fonds d'aide internationale
consacrés à une telle R&D. La CMH a recommandé d’augmenter de 3 milliards
de dollars par an le financement de la R&D par l'intermédiaire d'un nouveau
Fonds mondial de la recherche en santé, des mécanismes existants et des
partenariats public-privé.[121]
Il faut examiner avec soin la manière dont la
recherche financée par des fonds publics devrait être orientée. Il ne faut pas
qu'il s'agisse d'une forme de subvention accordée à l'industrie pharmaceutique
actuelle, bien que l'industrie ait certainement un rôle important à jouer. Il
faudrait saisir cette occasion pour renforcer la capacité des pays en
développement à entreprendre eux-mêmes des travaux de R&D sur les traitements
des maladies qui les touchent tout particulièrement. Dans les pays en
développement technologiquement plus avancés, une telle recherche pourrait être
hautement rentable. Par exemple, General Electric a créé son deuxième centre
mondial de R&D en Inde, employant environ 1 000 diplômés du niveau
doctorat, et 27 autres entreprises mondiales ont créé des centres de R&D en
Inde entre 1997 et 1999.[122] Par conséquent la recherche pourrait être
entreprise avec la participation active de certains instituts de recherche et
de certaines entreprises des pays en développement, en tirant parti des
ressources humaines disponibles dans ces pays et des coûts inférieurs de
R&D. La structure institutionnelle d'un tel financement mérite également
réflexion. Le réseau d'instituts de recherche agricole du GCRAI[123]
(que nous examinons au Chapitre 3) est un modèle possible. Ce qui serait encore
plus prometteur dans ce contexte pourrait être un réseau de partenariats
public-privé dans les pays en développement, pour tirer parti de la concentration
des ressources consacrées à la recherche dans les instituts du secteur public,
mais aussi de la possibilité de créer une capacité de recherche au sein du
secteur privé. Les dispositions prises pour la propriété intellectuelle
provenant d'une telle recherche doivent être de telle nature que l'accès des
populations pauvres aux produits de la recherche est assuré dans toute la
mesure du possible.
Il faudrait augmenter le financement public de la
recherche relative aux problèmes sanitaires des pays en développement. Ce
financement supplémentaire devrait viser à exploiter et à développer les
capacités existant dans les pays en développement pour ce genre de recherche,
et encourager la création de nouvelles capacités dans les secteurs public et
privé.
Bien que la PI n'ait peut-être pas un grand rôle à
jouer dans l'accroissement des travaux de recherche présentant de l'intérêt
pour les populations pauvres, il évident pour nous que les répercussions du
système des brevets posent d’importants problèmes en ce qui concerne le
processus de recherche. Même si la protection par brevet encourage la R&D,
le fait d’octroyer des brevets sur les technologies intermédiaires (notamment
celles qui sont fondées sur les gènes) nécessaires pour le déroulement de la
recherche pourrait en réalité avoir un effet dissuasif pour les chercheurs
lorsqu’ils veulent accéder aux technologies dont ils ont besoin, ou bien parce
qu’ils pourraient risquer de porter atteinte à de tels brevets.[124]
C'est un domaine où le recours aux brevets dans le monde développé peut
empiéter directement sur le genre de recherche qui est entreprise pour les
populations du monde en développement, ce qui a des répercussions sur le genre
de régime de brevets qu’adopteront les pays en développement. Les dispositions
en matière de PI dans les partenariats public-privé soulèvent également
d'importantes difficultés en ce qui concerne la gestion de la PI en vue
d'avantager les pauvres. Nous examinerons ces questions au Chapitre 6.
ACCES DES PAUVRES AUX MEDICAMENTS
Comme nous l'avons déjà noté, le brevet a pour but
d’octroyer un monopole temporaire aux titulaires des droits pour encourager les
inventions et leur commercialisation. Toutefois, il faut également noter que ce
droit de monopole fourni par un brevet ne fait normalement qu’empêcher la
fabrication, l'utilisation ou la vente de cette invention particulière par des
tiers. Il n'empêche pas la concurrence des autres médicaments, brevetés ou non,
qui concernent les mêmes pathologies. Toutefois, toutes choses égales par
ailleurs, on suppose que le producteur d'un produit breveté tentera, du fait
qu'il est capable d'exclure les copies, de gagner un bénéfice de monopole et
qu'il établira des prix plus élevés qu'il n'aurait été possible autrement. Ceci
est bien sûr la base du système. Le marché passé avec la société est
précisément que les avantages créés pour la société par la nouvelle innovation
induite (par exemple, un médicament capable de sauver des vies pourrait ne pas
exister s'il n'y avait pas eu le système des brevets) doivent être supérieurs
au coût supplémentaire de ce produit.
Etant donné que dans les pays en développement, la
population est pauvre dans son ensemble et que la protection par brevet peut
augmenter les prix, il est nécessaire d'examiner avec un soin tout particulier
les arguments avancés par certains selon lesquels les brevets dans les pays en
développement ne vont pas de manière significative avoir un effet sur l'accès
aux produits pharmaceutiques protégés par des brevets. Il existe deux raisons
sur lesquelles ces arguments sont fondés. Tout d'abord, comme les brevets ne
sont pas toujours demandés dans certains pays en développement, en particulier
les plus petits, ils ne peuvent pas créer de problème particulier en matière
d'accès aux médicaments. Deuxièmement, même s'ils sont demandés, ou bien il ne
s'agit pas là d'un facteur déterminant dans l’établissement du prix, ou bien
d'autres facteurs plus importants empêchent l'accès des pauvres aux
médicaments.
Fréquence de la délivrance des brevets
Bien sûr, même si la protection par brevet des
produits pharmaceutiques est disponible dans la plupart des pays en
développement, les multinationales n'ont pas breveté leurs produits dans tous
ces pays. C'est généralement le cas pour les pays dont les marchés sont
limités, et les capacités technologiques réduites. Les multinationales peuvent
penser qu'il est inutile de dépenser des sommes pour obtenir et maintenir la
protection lorsque le marché potentiel est réduit, et le risque de contrefaçons
faible. Par exemple, une étude récente effectuée dans 53 pays africains a mis
en évidence que la délivrance de brevets pour 15 médicaments antirétroviraux
importants était de 21,6 % du total possible.[125]
Aucun brevet n’avait été octroyé dans 13 pays pour ces médicaments. On peut
conclure que, comme le taux de délivrance de brevets était aussi faible, les
brevets « ne semblent pas, en général, être un obstacle important au ...
traitement dans l'Afrique d'aujourd'hui », bien que l'on ait reconnu que cela
puisse devenir un problème lorsque l’Accord sur les ADPIC entrera en vigueur
pour tous les membres de l'OMC.[126]
Bien que la fréquence totale des brevets constatée
dans l'étude soit relativement faible dans l'ensemble, il est surprenant
qu'elle ne le soit pas encore plus, étant donné les taux de traitement très
bas, la taille limitée des marchés et le fait que peu de pays sont capables de
produire des copies génériques. Les brevets sont beaucoup plus fréquents dans
les pays où il existe des débouchés importants et des capacités technologiques.
Ainsi, en Afrique du Sud (qui représente à elle seule plus de 17 % des cas de
VIH en Afrique), 13 médicaments sur 15 sont brevetés. Il existe 6 à 8 brevets
pour ces médicaments au Botswana, en Gambie, au Ghana, au Kenya, au Malawi, en Ouganda, au Soudan,
au Swaziland, en Zambie et au Zimbabwe qui, pris tous ensemble, représentent 31
% de tous les cas de VIH dans l'Afrique subsaharienne.[127]
L'industrie souligne que la
fréquence de la délivrance de brevets est bien inférieure, ou nulle, pour un
grand nombre de médicaments qui traitent d'autres maladies. Jusqu'à la dernière
révision de cette année, moins de 5 % des médicaments figurant sur la Liste des
médicaments essentiels de l'OMS étaient brevetés.[128]
Une enquête menée par l'industrie a indiqué que 94 % des pays étudiés n'avaient
pas délivré de brevet pour des médicaments contre la tuberculose et le
paludisme, et qu’aucun n'avait de brevet concernant tous les médicaments
relatifs à ces maladies. Il n'existait absolument aucun brevet pour les
médicaments relatifs à la trypanosomiase ou aux maladies diarrhéiques.[129]
La thèse avancée par l'industrie est que, même lorsqu'il n'y a pas de
protection par brevet, les médicaments ne sont pas disponibles.[130]
Par exemple, même lorsque des vaccins sont disponibles pour diverses maladies
courantes et sont bon marché (par exemple, moins de 1 dollar pour un vaccin
polyvalent), le Programme élargi de vaccination (PEV) de l'OMS n'arrive pas, en
dépit de réussites indubitables, à atteindre une grande partie des enfants
susceptibles d’en profiter.
Cela est bien sûr vrai, mais ne veut pas dire que
le système des brevets n'a aucun effet négatif. Même si aucun brevet n'existe
pour des produits ou des pays particuliers, le système des brevets peut
néanmoins avoir un effet sur l'accès aux médicaments. La plupart des pays en
développement à faible revenu doivent pour s’approvisionner compter sur les
importations. L'existence de brevets dans les pays fournisseurs éventuels peut
permettre aux titulaires des brevets d'empêcher les produits d'être exportés
vers un autre pays, en particulier en faisant intervenir le contrôle des
circuits de distribution. C'est une autre raison pour laquelle les entreprises
sont susceptibles de rechercher sélectivement des brevets dans des pays comme
l'Afrique du Sud, parce que c'est un fournisseur potentiel pour ses voisins
plus pauvres du reste de l'Afrique australe (ou même d'ailleurs). A l'heure
actuelle, les pays importateurs où il n'existe aucune protection par brevet ont
la possibilité d'importer des produits génériques, principalement d'Inde, car
dans ce pays la protection des produits pharmaceutiques ne doit pas être
instaurée avant 2005. Mais plus tard, en vertu des dispositions de l’Accord sur
les ADPIC, les nouveaux médicaments et ceux pour lesquels des demandes de
brevets ont été déposées après 1994 seront brevetables, et la possibilité
d'effectuer ces importations diminuera par conséquent avec le temps. Toutefois,
il faut noter que tous les médicaments actuels produits en tant que génériques
en Inde ou ailleurs continueront à être disponibles pour l'exportation à
condition bien sûr qu'ils ne soient pas brevetés dans le pays d'importation.
Nous reviendrons sur cette question ci-après lorsque nous aborderons la
question des options de politique.
Brevets et
prix
L'importance
des prix des médicaments pour les consommateurs pauvres des pays en
développement est peut-être évidente. Mais il est utile de souligner que si un
malade doit payer plus pour un produit pharmaceutique à cause du brevet, il
aura par conséquent moins d'argent à dépenser pour d'autres biens essentiels à
la vie, comme la nourriture ou le
logement. D'un autre côté, ne pas prendre de médicament parce qu'il est
indisponible ou trop cher peut entraîner à long terme la maladie ou la mort.
C'est pourquoi il est essentiel d'examiner l'impact de l'introduction d'un
régime de PI sur les prix, tout en reconnaissant que les prix dépendent de
nombreux facteurs : pouvoir d'achat, concurrence et structure des marchés,
réactivité de la demande au prix, et contrôle et réglementation des prix par le
gouvernement.
Il est particulièrement difficile
d'observer directement et d'isoler l'impact de l’introduction des brevets dans
les marchés des pays en développement. Nous devons compter pour partie sur des
modèles économétriques pour simuler l'impact de l'introduction d'une protection
par brevet, et pour partie sur l'expérience des pays développés où les
fabricants de produits génériques entrent en concurrence avec ceux qui sont
fondés sur la recherche.
Pays développés
Il existe de nombreuses preuves
dans les pays développés que les prix des médicaments baissent considérablement
à l'expiration du brevet, en supposant qu'il existe des produits génériques
concurrents. L'importance de la baisse des prix semble dépendre du nombre de
génériques concurrents sur le marché. Les Etats peuvent encourager les
réductions de prix en facilitant l'entrée précoce de fabricants de génériques
sur le marché. Par exemple, la loi américaine de 1984 connue sous le nom de loi
de Hatch-Waxman (sur la concurrence en matière de prix des médicaments et la
restauration de la durée du brevet) est parvenue précisément à ce résultat, la
part des génériques dans les ordonnances ayant augmenté de 19 % en 1984 à 47 %
en 2000.[131]
Dans d'autres pays développés, comme le Royaume-Uni, la part des génériques sur
le marché est souvent beaucoup plus élevée. Les entreprises pharmaceutiques ont
également dépensé beaucoup d'argent pour des procès intentés par elles ou
contre lesquels elles étaient obligées de se défendre, pour retarder ou
empêcher l'entrée des génériques et pour protéger ou étendre un monopole
concernant un médicament dont les ventes sont élevées.[132]
Par conséquent, nous devons nous souvenir que les fabricants de génériques
obéissent à des motivations liées au marché de même que l'industrie des
produits fondée sur la recherche, et qu'il est nécessaire d'encourager la
concurrence au sein de l'industrie des génériques si l'on veut parvenir à des prix
de médicaments inférieurs. Une étude récente effectuée aux Etats-Unis a montré
que les prix baissaient sous l'effet de l'introduction de la concurrence par
les génériques, mais qu'il fallait au moins cinq génériques concurrents pour
pousser les prix à leur niveau minimum.[133] Le nombre de concurrents entrant sur le
marché et la vitesse à laquelle ils le font dépendra des bénéfices qu'ils
attendent. Un fait crucial a été mis
en évidence : les avantages de la concurrence ne se feront complètement
sentir que pour des marchés relativement importants ; dans les petits marchés
en effet, les fabricants de génériques seront moins nombreux à considérer que
cela vaut la peine d'y entrer, et les prix aux consommateurs seront plus
élevés. Cet élément est très important pour la position des pays en
développement, comme nous allons le voir ci-dessous.
Pays en développement
Les pays en développement peuvent
également limiter les coûts du système des brevets pour leur population en
facilitant l'entrée et la concurrence des génériques. Mais dans la plupart des
cas, ces options sont en fait gravement limitées par la petite taille de leurs
marchés et par l’absence de capacités technologiques, productives et
réglementaires dans le pays. C'est cette absence de capacité à créer un
environnement concurrentiel à la fois pour les produits brevetés et les
produits génériques qui fait de la présence d’un brevet un élément plus
controversé que dans les marchés développés, qui peuvent beaucoup mieux
instaurer un environnement réglementaire très favorable à la concurrence.
Des
comparaisons internationales montrent que les copies de médicaments brevetés
ailleurs sont beaucoup moins chères sur les marchés qui n'offrent aucune
protection par brevet. Le marché indien, où il n'existe aucune protection, a
les prix les plus bas du monde. L'une de nos études a montré que pour 12
médicaments concernant un ensemble de maladies, les prix américains variaient
de 4 à 56 fois le prix des formules équivalentes en Inde, et pourtant un grand
nombre de personnes en Inde n'ont pas accès à ces produits.[134]
Toutefois, les études portant sur
les politiques des prix des sociétés multinationales (principalement pour les
ARV) indiquent que jusqu'à récemment la corrélation entre le prix du même
médicament et le revenu par habitant d'un pays était très faible. Cette
corrélation est attendue pour des raisons théoriques, parce que les entreprises
devraient être capables d'engranger plus de bénéfices en demandant des prix
faibles sur les marchés à faible revenu et des prix élevés sur les marchés à
revenu élevé (ce qu'on appelle prix différenciés), plutôt qu'en demandant un
prix uniforme dans le monde. Mais on a constaté que les prix variaient plus ou
moins au hasard selon les pays. Certains pays en développement payaient plus
que les prix américains et certains moins. Au mieux, on constatait un faible
rapport entre les prix de gros des médicaments et le revenu par habitant.[135]
Le prix réel pour le malade est compliqué par les droits à l'importation, les
tarifs douaniers locaux, les taxes et les bénéfices du grossiste.[136]
Il est possible
qu’au cours de ces deux dernières années cette situation ait changé dans une
certaine mesure étant donné que certaines entreprises ont baissé
considérablement leurs prix en réponse à des pressions internationales, émanant
principalement des ONG, et du fait de la concurrence potentielle des fabricants
de génériques, notamment en Inde. Par exemple, entre juillet 2000 et avril
2002, le coût annuel d'une association de trois spécialités ARV a diminué,
tombant de plus de 10 000 dollars à un peu plus de 700 dollars pour
certains groupes de consommateurs. Mais en même temps le prix générique le plus
bas pour cette association était descendu à 209 dollars.[137]
Mais pour estimer à nouveau
l'impact de l'introduction des régimes de brevets dans les pays en
développement, il est nécessaire d'utiliser des modèles économétriques. Quelques études, en nombre croissant
d'ailleurs, portent presque entièrement sur les pays en développement à faible
revenu et à revenu intermédiaire qui ont déjà des industries pharmaceutiques
importantes. Ces études démontrent que l'introduction des régimes de brevets
dans ces pays en développement a l'effet d'augmenter les prix ou le fera à
l'avenir. Les estimations varient considérablement selon les médicaments et les
pays examinés (de 12 % à plus de 200 %), mais même les estimations les plus
basses impliquent des coûts très importants pour le consommateur.[138]
La gamme des estimations indique le degré d'incertitude concernant l'effet
dynamique de l’introduction des brevets et laisse supposer que les résultats
seront déterminés très certainement par la structure du marché et la demande,
en particulier par le niveau de concurrence.
Un grand nombre de données
factuelles montrent également que la consommation de médicaments est sensible
au prix. Une étude effectuée en Ouganda a estimé que la réduction du prix d'une
trithérapie ARV, passant de 6 000 de dollars à 600 dollars par an,
augmenterait le nombre des malades ainsi traités de 1 000 à 50 000 si
elle était associée à des investissements relativement modestes dans les
infrastructures de traitement (de 4 à 6 millions de dollars).[139]
Une autre étude également réalisée en Ouganda a indiqué que les réductions de
prix dues aux rabais accordés par les fabricants de produits de marque ont
encore fait baisser l'importation des équivalents génériques, multipliant par
trois le nombre de malades traités entre 2000 et 2001.[140] Une étude économétrique globale a estimé que
l'effet de l'élimination des brevets dans un échantillon de pays en
développement serait d'augmenter l'accès aux ARV de 30 %, même si le niveau
existant actuel est très bas.[141]
L'impact de l'introduction des
systèmes de brevets se fera vraisemblablement sentir le plus profondément dans
les pays qui ont mis en place de solides industries génériques, avec un certain
niveau de concurrence qui a maintenu les prix à un bas niveau. Les données
disponibles montrent que dans certains pays l'introduction des brevets (par
exemple, l'Italie en 1978) ou le renforcement du régime, comme au Canada dans
les années 90, en augmentant la puissance du marché des multinationales
étrangères, aura pour résultat de consolider et de restructurer l'industrie
nationale. Cela pourrait entraîner des coûts significatifs pour le consommateur
du fait de la réduction de l’intensité de la concurrence sur le marché et de
l'augmentation des importations. Le fait que ces coûts puissent être compensés
par d'autres avantages (par exemple la stimulation de la recherche locale) est
fortement discuté. En Italie et au Canada, deux pays développés, les données
factuelles ne sont pas claires.[142]
En Italie, les multinationales ont repris un grand nombre d'entreprises
locales, les exportations de médicaments génériques ont baissé et les
importations de médicaments brevetés ont augmenté. Mais on n'a guère constaté
d'augmentation de la R&D. Au Canada, on peut observer une augmentation
significative de la R&D, en partie du fait d'un accord passé avec les
multinationales et des crédits d'impôt autorisés en vertu de la loi sur l'impôt
sur le revenu (1987), mais la R&D est axée sur les essais précliniques et
cliniques et l'amélioration des procédés de fabrication, plutôt que sur la mise
au point de nouvelles molécules.[143]
Dans ces deux pays, le contrôle des prix a été utilisé pour limiter les
augmentations de prix des produits brevetés.
Dans les pays en développement
ayant des industries génériques solides, les perspectives sont également
incertaines. D'un côté, les fabricants de médicaments principalement génériques
vont vraisemblablement souffrir de l'introduction d'une protection par brevet,
et le consommateur et l’Etat devront payer davantage pour les médicaments qui
bénéficient d'une protection par brevet. D'autre part, les fabricants en train
de mettre en place une capacité de recherche ou capables d'obtenir des licences
concédées par des multinationales pourront retirer des avantages de la
protection par brevet. Ces conséquences contradictoires expliquent pourquoi
l'introduction d'une protection par brevet en Inde est si controversée.
Certaines sections de l'industrie pharmaceutique indienne appuient
l'introduction de la protection par brevet et organisent leur recherche de
manière à anticiper cette introduction, alors que d'autres sections s'y
opposent de toutes leurs forces. Et bien sûr elle est fortement discutée par
les groupes de consommateurs et les ONG.
De manière plus générale, à
mesure que l'Accord sur les ADPIC est mis en œuvre, il ne sera plus possible de
fournir de copies génériques des nouveaux médicaments. A l'heure actuelle, la
menace de concurrence internationale de la part des fabricants de copies
génériques de produits brevetés est un facteur limitant les prix qui peuvent
être demandés dans les pays n'ayant pas de régime de brevets, et dans une
moindre mesure dans les pays dotés de régimes de brevets où il existe une
menace crédible d'octroi de licences obligatoires. Quand tous les pays
producteurs auront une législation en matière de brevets, les génériques seront
de plus en plus limités aux anciens médicaments dont le brevet aura expiré. La
situation ne sera guère différente de ce qu'elle est actuellement dans les pays
développés, mais les pays en développement rencontreront toujours des
difficultés pour payer les nouveaux médicaments brevetés. Il faudra trouver des
moyens au sein du système des brevets et en dehors pour instaurer un
environnement concurrentiel qui permettra de compenser l'effet négatif des
brevets sur le prix demandé aux consommateurs des pays en développement. Nous
examinons ci-après plusieurs mesures qui devraient être prises en compte pour
que le système des brevets renforce le droit d'un pays à protéger la santé
humaine et à promouvoir l'accès aux médicaments, conformément à la Déclaration
de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (ci-après dénommée «
Déclaration de Doha » – voir Encadré 2.1).
Autres facteurs ayant un impact sur l'accès aux médicaments
Certains font valoir, par exemple l'industrie
pharmaceutique, que le facteur qui limite le plus l'accès aux médicaments dans
les pays en développement est non pas la protection par brevet, mais
l'insuffisance des dépenses consacrées aux soins de santé dans les pays en
développement et l'absence des infrastructures sanitaires nécessaires pour
administrer les médicaments de manière sûre et efficace. Administrer les
médicaments de manière malencontreuse peut contribuer à faire apparaître une
résistance, en dehors du fait qu’ils perdent leur efficacité. Dans le cas du
VIH, en raison des nombreuses mutations du virus, une large distribution des
ARV sans la mise en place d'infrastructures adaptées peut contribuer à
l'émergence d'une résistance aux médicaments.[144]
Il a également été avancé que des versions génériques de médicaments brevetés pourraient
être d'une qualité inférieure, ou même dangereuses.[145]
Un rapport émanant de l'association des industries
pharmaceutiques américaines affirme :
«
Gênées par des ressources financières limitées, les capacités de ces pays
d'endiguer le SIDA et de traiter tout un ensemble d'autres maladies mortelles
sont compromises par des infrastructures inadaptées, des traditions culturelles
qui font obstacle aux soins et la mauvaise gestion des systèmes de soins de
santé. Certains pays en développement sont également gênés par un pouvoir
politique qui n'a pas la volonté d’affronter ou même de reconnaître les besoins
de soins de santé de son pays. »[146]
Outre les brevets, plusieurs facteurs ont une
influence sur les prix des médicaments, comme les tarifs douaniers et d’autres
formes de fiscalité indirecte.[147]
C’est peut-être faire preuve d’esprit de contradiction que de se plaindre de
l’impact des brevets sur les prix, tout en ignorant d’autres politiques
nationales qui auraient un effet semblable. Il est par conséquent important que
la fiscalité nationale fonctionne de manière à favoriser les mesures de santé
publique, tout comme devrait le faire le système des brevets.
Afin de répondre aux préoccupations concernant
l’administration des médicaments contre le SIDA, l’OMS a fait paraître cette
année les premières directives thérapeutiques pour l’utilisation des ARV dans
les environnements pauvres et elle a publié une liste des fabricants et
produits (y compris onze ARV) qui répondent aux normes de qualité de l’OMS applicables
aux fournisseurs des institutions des Nations Unies. Cette liste comporte
actuellement des producteurs de produits brevetés aussi bien que de plusieurs
versions génériques, notamment, jusqu'ici, deux fournisseurs indiens. De plus,
l’OMS a inclus pour la première fois douze ARV pour le traitement du SIDA (deux
s’y trouvaient déjà, mais pour le traitement de la transmission mère-enfant)
sur sa Liste des médicaments essentiels.[148]
On discute beaucoup pour savoir dans quelle mesure
les brevets et autres facteurs déterminent l’accès aux médicaments. Nous
estimons qu’il faut que tous ces facteurs soient pris en considération, mais
aussi qu’améliorer les dispositions de la PI pour atteindre les objectifs de
santé publique ne peut pas remplacer la nécessité d’aborder les questions de
politique, d’infrastructures et de ressources en vue des mêmes objectifs. Ces
deux voies doivent être explorées, et en explorer une n’a rien à voir avec la
capacité d’explorer l’autre. L’un des participants à notre conférence a déclaré
:
« …
Je voudrais dissuader la Commission d’arriver à la conclusion dans ce
débat {que tout dépend} des
infrastructures et des ressources. Si c’est ça la conclusion, je pense que vous
auriez dit à ce moment-là ce que le titre constate : « Les
populations sont pauvres ». Par conséquent ne faites pas de
recommandations sur le fait que les populations sont pauvres, parce que nous le
savons. Nous essayons de résoudre leurs problèmes, non pas de leur dire
qu’elles sont pauvres. »[149]
Il
faut que les pays adoptent un éventail de politiques visant à améliorer l’accès
aux médicaments. Il est essentiel de consacrer des ressources supplémentaires à
l'amélioration des services, des mécanismes de prestation et des
infrastructures. D’autres politiques macroéconomiques doivent être harmonisées
avec les objectifs de la politique sanitaire. Il en va de même pour le régime
de PI. Les pays doivent s'assurer que leurs régimes de protection de la PI ne
vont pas à l’encontre de leurs politiques de santé publique, mais au contraire
qu’ils sont compatibles avec celles-ci et les soutiennent.
CONSEQUENCES
EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE
Options de politique nationale
Contexte
Pour examiner les conséquences en
matière de politique générale, notre discussion devra se référer à la
Déclaration de Doha convenue à la Réunion ministérielle de l’OMC à Doha en
novembre 2001 (voir Encadré 2.1). Les ministres ont précisé que l’Accord sur
les ADPIC ne devait pas empêcher les pays de prendre des mesures pour protéger
la santé publique. Ils ont confirmé que, conformément aux termes de l’Accord,
des licences obligatoires pouvaient être accordées pour certaines raisons
précisées par les pays membres. En outre, des importations parallèles
pourraient également approvisionner le marché intérieur (selon ce que l’on
appelle en droit la doctrine de « l’épuisement des droits »).[150]
Ils ont admis qu’un problème spécial existait dans le cas des pays ayant des
capacités de fabrication insuffisantes en ce qui concerne le recours aux
licences obligatoires et ont donné pour instruction au Conseil des ADPIC de
trouver une solution d’ici la fin de l’année. Les membres sont également
convenus d’exempter les pays les moins avancés jusqu’en 2016 de la mise en
œuvre, de l’application et de la vérification de la protection des données
d’essai et des produits pharmaceutiques[151].
Le Conseil des ADPIC a confirmé cette décision le 27 juin 2002, en même temps
qu’il a approuvé une dérogation qui exempterait les PMA d’avoir à accorder des
droits commerciaux exclusifs pour tout nouveau médicament pendant la période
durant laquelle ils ne fournissent pas de protection par brevet. Cette dernière
dérogation, qui a été approuvée par le Conseil général de l’OMC, doit être
revue annuellement par la Conférence ministérielle de l’OMC (ou le Conseil
général entre réunions ministérielles) jusqu’à son terme.
Nos recommandations partent du principe que, pour
la plupart des pays en développement, tout avantage concret découlant de la
mise au point de nouvelles thérapies pour des maladies qui les touchent se
manifestera, au mieux, sur le long terme, alors que les coûts de la mise en
œuvre d’un système de brevets sont à la fois réels et immédiats. Par
conséquent, nous concentrerons nos efforts sur les mesures au sein du système
de PI qui vont réduire au minimum les prix des médicaments tout en maintenant
leur disponibilité. Comme indiqué plus haut, nous n’avons pas trouvé de preuve
montrant que ces mesures diminuent la motivation de la recherche sur des
maladies spécifiques aux pays en développement, parce que c’est l’absence de
demande plutôt que l’existence d’un système de PI qui en est la cause. Mais
nous reconnaissons qu’étant donné que ce domaine est inconnu, il faudrait
continuer les recherches pour voir si la mise en œuvre de l’Accord sur les
ADPIC affecte dans la pratique à la fois l’incitation à la recherche et l’accès
aux médicaments, notamment à long terme.
Encadré 2.1 Déclaration ministérielle de Doha de
l’OMC sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique
Adoptée le 14 novembre 2001
1. Nous
reconnaissons la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de
nombreux pays en développement et pays les moins avancés, en particulier ceux
qui résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies.
2. Nous
soulignons qu’il est nécessaire que l’Accord de l’OMC sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les
ADPIC) fasse partie de l’action nationale et internationale plus large visant à
remédier à ces problèmes.
3. Nous
reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est importante
pour le développement de nouveaux médicaments. Nos reconnaissons aussi les
préoccupations concernant ses effets sur les prix.
4. Nous
convenons que l’Accord sur les ADPIC n’empêche pas et ne devrait pas empêcher
les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. En
conséquence, tout en réitérant notre attachement à l’Accord sur les ADPIC, nous
affirmons que ledit accord peut et devrait être interprété et mis en œuvre
d’une manière qui appuie le droit des Membres de l’OMC de protéger la santé
publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments.
A ce sujet, nous réaffirmons le droit des Membres de l’OMC
de recourir pleinement aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC, qui ménagent
une flexibilité à cet effet.
5. En
conséquence, et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos
engagements dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces
flexibilités incluent ce qui suit :
a) Dans l’application des règles coutumières
d’interprétation du droit international public, chaque disposition de l’Accord
sur les ADPIC sera lue à la lumière de l’objet et du but de l’Accord tels
qu’ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs et principes.
b) Chaque Membre a le droit d’accorder des licences
obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles
licences sont accordées.
c) Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue
une situation d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence,
étant entendu que les crises dans le domaine de la santé publique, y compris
celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à d’autres
épidémies, peuvent représenter une situation d’urgence nationale ou d’autres
circonstances d’extrême urgence.
d) L’effet des dispositions de l’Accord sur les ADPIC qui se
rapportent à l’épuisement des droits de propriété intellectuelle est de laisser
à chaque Membre la liberté d’établir son propre régime en ce qui concerne cet
épuisement sans contestation, sous réserve des dispositions en matière de
traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4.
6. Nous
reconnaissons que les Membres de l’OMC ayant des capacités de fabrication
insuffisantes ou n’en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient
avoir des difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires
dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au
Conseil des ADPIC de trouver une solution rapide à ce problème et de faire
rapport au Conseil général avant la fin de 2002.
7. Nous
réaffirmons l’engagement des pays développés Membres d’offrir des incitations à
leurs entreprises et institutions pour promouvoir et encourager le transfert de
technologie vers les pays les moins avancés Membres conformément à l’article
66:2. Nous convenons aussi que les pays les moins avancés Membres ne seront pas
obligés, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou
d’appliquer des sections 5 et 7 de la Partie II de l’Accord sur les ADPIC ni de
faire respecter les droits que prévoient ces sections jusqu’au 1er
janvier 2016, sans préjudice du droit des pays les moins avancés Membres de
demander d’autres prorogations des périodes de transition ainsi
qu’il est prévu à l’article 66:1 de l’Accord sur les ADPIC.
Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet à cela en
application de l’article 66:1 de l’Accord sur les ADPIC.
Prix différenciés
Comme nous l’avons indiqué, la
fixation de prix différenciés devrait être, en principe pour les entreprises
mondiales, une manière rationnelle du point de vue économique de maximiser
leurs bénéfices sur des produits qui sont vendus à la fois sur des marchés à
faible revenu et à revenu élevé.[152]
Elle devrait également permettre de veiller à ce que les populations pauvres
obtiennent des produits moins chers.
Plusieurs initiatives existent
pour faciliter un système mondial de prix différenciés. Comme indiqué plus
haut, nombre d’autres facteurs, outre les DPI, affectent les prix et la
disponibilité des médicaments. Lorsqu’on établit un système de prix
différenciés, qui permettrait à des prix bas dans les pays en développement de
coexister avec des prix élevés dans les pays développés, il faut tenir compte
de deux facteurs importants :
·
Les marchés ayant des niveaux de prix
différents doivent être segmentés de sorte que les médicaments à bas prix ne
puissent entrer sur les marchés où ils ont un prix plus élevé. Ceci signifie un
contrôle des exportations et des importations des produits en question.
·
Les décisions en matière de fixation
des prix sur les marchés où les prix sont
plus élevés, lorsque ceux-ci sont fixés ou influencés par la politique
officielle, ne doivent pas être prises en faisant référence aux marchés où les
prix sont bas.
Ce deuxième
facteur ne tient pas compte de considérations de PI, mais constitue un problème
politique dans nombre de pays développés en raison des variations de prix des
produits pharmaceutiques, même entre pays développés, et des pressions qui
s’exercent sur les budgets des malades, des régimes d'assurance et de l’Etat
pour faire face aux coûts de plus en plus élevés des médicaments brevetés.
Mais les
instruments du système de PI, notamment les importations parallèles et les licences obligatoires, joueront
vraisemblablement un rôle essentiel dans l’élaboration de prix différenciés et
la segmentation du marché. Afin de veiller au fonctionnement efficace du
système de prix différenciés, les lois des pays en développement devraient
maintenir le droit du gouvernement à admettre des importations parallèles et à
octroyer des licences obligatoires.
Nous connaissons l’existence de
réductions de prix récentes et de plusieurs programmes spéciaux utilisés par
certaines sociétés, parfois en coopération avec des institutions
internationales, pour fournir des médicaments avec un fort rabais ou
gratuitement et, en accord avec le gouvernement local et les ONG, des infrastructures capables de veiller à ce
qu’ils parviennent aux malades. Ces offres ne s’appliquent en général que si
les acheteurs sont des gouvernements, des ONG, des organisations d’aide ou des
employeurs du secteur privé, et non pas des fournisseurs commerciaux de
médicaments. Il s’agit là bien sûr de contributions tout à fait bienvenues pour
améliorer l’accès aux médicaments dans les pays en développement.[153]
Mais il faut également trouver des solutions plus ambitieuses, qui soient
également durables, aux problèmes de santé publique graves qui sont abordés.
C’est pourquoi les efforts doivent se poursuivre pour que ce système de prix
différenciés devienne réalité.
Importations parallèles
En principe il
est n’est pas souhaitable que des restrictions limitent la libre circulation
des produits lorsqu’ils sont placés sur le marché par un fabricant. Mais en
pratique, et strictement dans le but d’assurer que les produits à prix plus bas
sont fournis à ceux qui ont besoin de ces prix bas et seulement à eux, il
pourrait être nécessaire de déroger à ce principe général. Par conséquent, une
composante importante de l’instauration d’un système de prix différenciés,
c’est la nécessité d’une segmentation des marchés pour empêcher que les
produits à bas prix menacent les marchés où les prix sont élevés. C’est
pourquoi les pays développés doivent impérativement installer des mécanismes
efficaces pour empêcher les importations parallèles de médicaments. Ceci existe
déjà en grande partie aux Etats-Unis et dans L'UE, mais ne semble pas être le
cas au Japon.[154]
Les pays développés devraient maintenir et
renforcer leurs régimes législatifs afin de prévenir les importations de
produits pharmaceutiques à bas prix en provenance des pays en développement.
Toutefois, pour
assurer la segmentation des marchés, il serait également souhaitable que les
pays en développement prennent des mesures pour empêcher les exportations vers
les pays développés de médicaments qui font partie d’un don ou d’un programme
de prix différenciés. Il est particulièrement important d’éviter le
détournement de ces produits des malades à qui ils sont destinés. Mais, étant
donné que les capacités de faire respecter cet état de chose sont limitées, le
fardeau de la segmentation entre pays développés et pays en développement
devra, pour être réaliste, incomber principalement aux pays développés.
Les pays en
développement ne devraient pas éliminer les sources potentielles d’importations
à faibles coûts en provenance d’autres pays en développement ou des pays
développés. Pour que les importations parallèles constituent une mesure
encourageant réellement la concurrence dans un scénario se conformant
entièrement aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC, elles devraient pouvoir
être autorisées chaque fois que les droits du titulaire du brevet sont épuisés
dans le pays étranger. Etant donné que l’Accord sur les ADPIC permet aux pays
de concevoir leurs propres régimes d’épuisement des droits (question qui a été
réaffirmée à Doha), les pays en développement devraient prévoir dans leur
législation des dispositions facilitant les importations parallèles.
Octroi de licences obligatoires
Comme indiqué
plus haut, le résultat de la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC sera de
réduire l’offre de copies génériques de produits brevetés. Ainsi disparaîtra un
important facteur de limitation et de réduction des prix des produits brevetés
dans les pays en développement. Mettre en place une législation et des
procédures efficaces pour l'octroi de licences obligatoires peut avoir un rôle
important à jouer pour maintenir une politique de DPI favorable à la
concurrence dans le nouvel environnement. Nous considérons l'octroi de licences
obligatoires non pas comme une panacée, mais plutôt comme une police
d’assurance essentielle pour prévenir les abus du système de PI.
Bien que l’Accord sur les ADPIC
autorise l'octroi de licences obligatoires (comme le précise la Déclaration de
Doha), sous certaines conditions et selon certaines procédures, les pays en
développement ne l’ont pas encore utilisé. Il est ironique de constater que ce
sont les pays développés qui recourent le plus activement aux licences
obligatoires (et pas seulement dans le domaine pharmaceutique) pour plusieurs
objectifs, notamment et c’est important de le noter, les procès anti-trust aux
Etats-Unis. Le Canada a fait grand usage des licences obligatoires dans le
domaine pharmaceutique de 1969 jusqu’à la fin des années 80. Ceci a permis que
les prix des médicaments sous licence soient inférieurs de 47 % à ceux des
Etats-Unis en 1982.[155]
Le Royaume-Uni a également eu recours aux licences obligatoires jusque dans les
années 70, notamment pour d’importants médicaments comme le Librium et le Valium. Plus récemment, en 2001, le
ministre américain de la Santé et des Services humains a envisagé publiquement
la possibilité de fournir des équivalents génériques avant ses négociations
avec Bayer (le titulaire du brevet) pour l’achat du médicament Cipro afin de
faire face aux conséquences des attaques à l'anthrax, bien qu’en fin de compte
un accord ait été conclu avec Bayer.[156]
Les pays en développement n’ont
pas utilisé ce système pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il exige une
infrastructure administrative et juridique inexistante dans de nombreux pays en
développement. Deuxièmement, les pays en développement craignent la menace de
sanctions éventuelles, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales.
Troisièmement, l'octroi de licences obligatoires doit être
« principalement pour le marché intérieur ». Quatrièmement, le mot «
obligatoire » se réfère à la limitation légitime
des droits du titulaire du brevet par un gouvernement. Le producteur réel d’un
médicament sous licence le fabrique volontairement et pour un bénéfice (tout au
moins dans le cas d’un titulaire de licence du secteur privé). Ainsi, le
titulaire de la licence doit détenir le savoir‑faire nécessaire à
l’ingénierie inverse et à la fabrication du médicament sans la coopération du
titulaire du brevet, et il doit prévoir que le marché sera suffisamment
important pour justifier les coûts d’investissement et de fabrication, et pour
rémunérer correctement le titulaire du brevet. Si ces conditions ne sont pas
remplies, la menace d’une licence obligatoire ne sera pas crédible.
La menace de l'octroi de licences
obligatoires a été utilisée avec succès par le Brésil dans la réalisation de
son programme national MST/SIDA (voir Encadré 2.2). Grâce à ses capacités de
recherche et au développement des capacités de fabrication du secteur public, le
Brésil a été en mesure d’utiliser la menace de l'octroi de licences
obligatoires dans ses négociations avec les entreprises pharmaceutiques. Cela
comprend notamment la capacité d’utiliser les estimations de ses propres coûts
de production avec une licence obligatoire lors de la négociation des prix avec
les titulaires des brevets. Mais il y a relativement peu de pays en
développement se trouvant dans la même position que le Brésil, de sorte que la
menace sera dépourvue de crédibilité dans la plupart d’entre eux, sauf s’ils
peuvent compter sur des importations des pays ayant les capacités
nécessaires.
Encadré
2.2 Programme national brésilien MST/SIDA (NSAP)
La mission principale du Programme national brésilien
MST/SIDA (NSAP) consiste à mettre les médicaments contre le VIH/SIDA
gratuitement à la disposition de tous les citoyens qui en ont besoin, par
l’intermédiaire du système national de soins de santé publique. Le NSAP a
commencé au début des années 90 et le traitement des malades atteints du VIH/SIDA
est devenu une obligation juridique en 1996. Avec l’aide des ONG concernées par
le VIH/SIDA, il a été procédé à une majeure réorganisation du réseau national
de services de santé publique pour la distribution des médicaments, le
dépistage et les soins pour le SIDA. Il existe actuellement des centaines
d’unités dispensant des médicaments dans tout le pays.
Le NSAP fournit actuellement des antirétroviraux à près de
105 000 personnes atteintes du VIH/SIDA sur un chiffre estimé à
600 000 au Brésil. Il a permis la réduction de moitié du nombre des cas de
VIH et de mortalité chez les sidéens, par rapport au chiffre prévu au début des
années 90. Les admissions à l’hôpital ont baissé de 80 % depuis 1996. Ainsi,
bien le programme soit coûteux (le coût annuel total est d’environ 500 millions
de dollars sur un budget de santé total de 10 milliards de dollars), les
dépenses évitées du fait de la réduction de la maladie, de l’hospitalisation et
d’autres conséquences du VIH/SIDA commencent à permettre d’équilibrer ce budget.
Le ministère de la Santé brésilien estime qu’en 2001, le coût final du NSAP
était négatif (économie nette de 50 millions de dollars) si l’on inclut dans ce
calcul les frais relatifs à la morbidité réduite.[157]
Les médicaments contre le SIDA
ont absorbé 300 millions de dollars des ressources de ce programme. Le coût de
l’acquisition des médicaments antirétroviraux a diminué récemment, car le
ministère de la Santé/NSAP a mis au point une production locale dans le secteur
public, établissant des laboratoires nationaux et des instruments permettant de
négocier avec des sociétés multinationales, notamment à l’aide de la menace
d'octroi de licences obligatoires. Far-Manguinhos (qui fait partie de la
Fondation Oswaldo Cruz - FIOCRUZ) est le principal producteur de médicaments
pour le gouvernement et a mis au point la technologie qui permet de fournir au
pays des médicaments antirétroviraux à bas prix. Cet institut produit déjà sept
des quinze médicaments utilisés dans le cocktail antirétroviral offert au Brésil.
Aucun de ces médicaments n’est breveté au Brésil. Leur prix, lors de leur mise
au point par la production locale, a baissé d’en moyenne 72,5 % entre 1996 et
2000. En 1999, 47 % des antirétroviraux étaient produits au Brésil mais ne
représentaient que 19 % des dépenses totales. Ainsi, 81 % des dépenses étaient
consacrées aux antirétroviraux achetés aux sociétés multinationales.
Comme Far-Manguinhos a les capacités techniques lui
permettant d’effectuer une ingénierie inverse des médicaments brevetés, et d’estimer
de manière réaliste les coûts de production, le ministère de la Santé se trouve
dans une forte position de négociation pour obtenir des réductions de prix des
producteurs étrangers, soutenue par la menace crédible de l'octroi de licences
obligatoires. En 2001, le ministre de la Santé a utilisé cette démarche avec
Roche et Merck pour leurs médicaments Nelfinavir et Efavirenz, négociant
finalement des réductions de prix de 40 à 70 %.
Même si le programme brésilien a été reconnu généralement
comme un modèle possible pour d’autres pays, il faut noter que le coût de ce
programme représente près de 5 000 dollars par an par personne traitée,
soit 800 dollars pour chaque personne infectée par le VIH, ou 3 dollars pour
chaque personne au Brésil. Le Brésil a ainsi accordé la priorité au traitement du
VIH/SIDA. Cet effort financier a été possible parce que le Brésil est un pays
en développement relativement riche et qu’il a toute proportion gardée un
faible taux d’infection par le VIH. De plus, son savoir-faire technique permet
au ministère de la Santé de négocier de véritables réductions de prix. Comme
indiqué ci-dessus, il s’agit probablement là d’un investissement qui est
rentable parce qu’il réduit la mortalité et la morbidité. Mais il est possible
que l’investissement initial de ce genre de programme soit hors de portée des
pays pauvres sans une aide extérieure, étant donné leurs taux d’infection par
le VIH beaucoup plus élevés. Pour ces pays, des capacités technologiques
médiocres constituent également une limitation en l’absence de moyens efficaces
d'octroi de licences obligatoires, comme cela a été proposé à Doha.
Dispositions
nationales concernant l'octroi de licences obligatoires
Dans les pays en développement,
un obstacle majeur à l'octroi de licences obligatoires est l’absence de
procédures législatives et administratives directes pour le mettre en œuvre.
Comme les systèmes juridiques de la plupart des pays en développement sont
surchargés, il conviendrait de mettre sur pied un système administratif quasi‑judiciaire
et indépendant chargé de la mise en œuvre de l'octroi de licences obligatoires.
Ses éléments essentiels comprendraient :
·
des procédures directes, transparentes
et rapides
·
des procédures de recours qui ne
suspendent pas l’exploitation de la licence
·
une législation qui exploite totalement
les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC s’agissant de déterminer les motifs
pour lesquels des licences obligatoires peuvent être octroyées, ainsi que pour
une utilisation non commerciale par les pouvoirs publics, y compris la
production pour l’exportation (voir ci-dessous)
·
des directives claires, faciles à
appliquer et transparentes pour fixer les taux des redevances (qui peuvent
varier).
Il y a beaucoup à apprendre de
l’expérience des pays développés, notamment du Canada qui semble avoir eu le
programme le plus complet. Le Canada a fixé un taux de redevance plus ou moins
universel de 4 %, qui découle d’un précédent fixé lors d’un arrêt de principe.
La pratique américaine varie considérablement, avec des taux allant de très bas
à très élevés, selon les décisions des tribunaux. Les pays en développement
devront mettre au point des règles et procédures adaptées à leurs propres
circonstances pour fixer les taux de redevance, mais l’expérience des autres pays
montre que ces redevances n’ont nul besoin d’être fixées à un niveau très
élevé.
Les pays en développement doivent
aussi envisager d’adopter dans ce contexte des dispositions fermes concernant
l’utilisation par les pouvoirs publics à des fins non commerciales. Ceci
diffère de l'octroi de licences obligatoires tout en ayant un effet semblable
pour la santé publique. Ici aussi, nombre de pays développés (et en
développement) ont de telles dispositions dans leurs législations. Dans les
pays du Commonwealth, elles ont été instituées par la loi britannique de 1883,
toujours en vigueur.[158]
Ces pouvoirs sont très étendus et ne précisent pas en détail les circonstances
particulières dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Par exemple, en
Nouvelle-Zélande :
« … tout ministère … peut fabriquer, utiliser,
exploiter et vendre toute invention brevetée pour les services de la Couronne
et tout ce qui est fait en application de cette sous-section ne représente pas
de contrefaçon du brevet concerné. »[159]
Les pays en développement
devraient établir des lois et des procédures leur permettant de recourir aux
licences obligatoires et prendre des dispositions appropriées pour
l’utilisation officielle.
Octroi de licences obligatoires pour les pays ayant des
capacités de fabrication insuffisantes
Le paragraphe
six de la Déclaration de Doha donne instruction au Conseil des ADPIC de trouver
une solution rapide au problème auquel doivent faire face certains pays ayant
des capacités de fabrication insuffisantes dans le domaine pharmaceutique. Il
définit le problème comme l’incapacité de ces pays à recourir aux licences
obligatoires pour obtenir les produits pharmaceutiques nécessaires d’un
producteur situé sur leur territoire. Normalement, une licence obligatoire
pourrait être utilisée dans ce but, le pays pouvant par l'octroi d’une licence
obligatoire autoriser un fabricant national à produire cet article sur son
territoire ou un importateur à se le
procurer ailleurs. Toutefois, les pays dont on sait qu’ils ont ce
problème ne peuvent s’adresser à un fabricant national pour des produits en
vertu de cette démarche et auraient besoin d’avoir recours à un fabricant d’un
autre pays.
Nous reconnaissons qu’il est
important de trouver la bonne interprétation des dispositions de l’Accord sur
les ADPIC ou de les modifier correctement, compte tenu du scénario à long terme
lorsque la protection par brevet s’appliquera aux pays qui peuvent actuellement
produire et exporter des copies génériques de médicaments brevetés. Le besoin
primordial consiste à trouver une solution concurrentielle pour le marché des
médicaments brevetés dans les pays en développement après l’entrée en vigueur
complète de l’Accord sur les ADPIC, de telle sorte qu’il soit possible de se
procurer des médicaments rapidement, de manière régulière et au coût le plus
bas possible. Ceci s’applique dans le cas où la fourniture directe de
médicaments brevetés comprend tout un ensemble de substituts thérapeutiques, ou
bien dans celui d’un approvisionnement par octroi de licences
obligatoires.
L'octroi de licences obligatoires
doit être considéré comme un moyen pour parvenir à un objectif, qui dans ce cas
consiste à faire baisser le coût des médicaments dans les pays en développement
autant que possible de manière à en faciliter l’accès. Ceci étant, le seul but
de l'octroi de licences obligatoires est de permettre d’atteindre cet objectif.
Comme on l’a indiqué plus haut, outre les aspects juridiques et administratifs,
l'octroi de licences obligatoires ne sera efficace que si le titulaire de la
licence obligatoire voit une possibilité d’obtenir un rendement raisonnable de
son investissement en demandant un prix significativement plus bas que le
titulaire du brevet (ou son titulaire de licence).
A l’heure actuelle, plusieurs pays,
notamment ceux qui sont dotés de marchés intérieurs importants, ont la capacité
de produire des copies bon marché de médicaments, ce qui deviendra beaucoup
plus difficile après 2005. A ce moment‑là, contrairement à aujourd’hui,
les fabricants dans ces pays n’auront aucune motivation pour procéder à une
ingénierie inverse des médicaments nouvellement brevetés, ni pour prendre
d’autres mesures nécessaires pour la fabrication et la vente (y compris
l’obtention de l’approbation réglementaire), car le marché intérieur sera
fermé. Ainsi, les substituts génériques des médicaments brevetés actuellement
disponibles disparaîtront progressivement. Les titulaires de licences
obligatoires éventuels devront par conséquent demander un prix beaucoup plus
proche du coût économique véritable (y compris les coûts de démarrage et de
fabrication), au lieu d’avoir la possibilité de fournir des produits génériques
immédiatement disponibles à des niveaux de prix qui tiennent compte du fait que
les coûts de démarrage ont déjà été amortis dans une certaine mesure sur le
marché intérieur. De plus, si les investissements nécessaires sont seulement
engagés si une licence obligatoire est disponible, il y aura inévitablement de
longues périodes d’attente avant que le médicament parvienne réellement aux
malades concernés.[160]
En outre, certaines indications montrent que l’ingénierie inverse des nouveaux
médicaments est intrinsèquement plus difficile dans le cas des produits
biopharmaceutiques que dans la chimie traditionnelle des procédés.
Ceci suggère donc que, sans
précautions spéciales, l'octroi de licences obligatoires en tant qu’instrument
de réduction des prix pourrait être une possibilité plus limitée qu’à l’heure
actuelle, même dans les quelques pays en développement technologiquement
avancés. Pour la plupart des pays, le seul fournisseur acceptable pourrait très
bien être le titulaire du brevet (ou son titulaire de licence).
Par conséquent, nous considérons
que le problème identifié à Doha est tout autant économique que juridique. Une
solution quasi‑juridique comme celle qui a pu être identifiée par le
Conseil des ADPIC est nécessaire, mais elle n’est en aucune manière suffisante
pour résoudre le problème que nous avons posé. En particulier, la solution
quasi‑juridique sera d’autant moins efficace que l'octroi de licences
obligatoires sera protégé par des restrictions. Il est possible que ces
restrictions soient un obstacle à l’efficacité de l'octroi de telles licences
en tant qu’argument de poids pour les pays en développement lorsqu’ils
négocieront les prix avec les titulaires des brevets : il ne sera efficace
en effet que si l’alternative que représente l'octroi de licences obligatoires
est une proposition viable du point de vue économique.
Aspects juridiques
Dans cette section,
nous examinons les diverses propositions présentées par différents pays et
groupes de pays quant à la résolution par l’OMC du problème visé au paragraphe
6 de la Déclaration de Doha. Ceci porte sur le fond des articles 28 (Droits
conférés), 30 (Exceptions aux droits
conférés) et 31 f) de l’Accord sur les
ADPIC, l’article 31 traitant des « autres utilisations sans autorisation
du détenteur du droit ». L’article 31 f) prévoit qu’une licence
obligatoire doit être accordée « principalement pour l’approvisionnement
du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation ».
Les pays ayant des capacités de
fabrication insuffisantes ou n’en disposant pas ne peuvent par conséquent pas
accorder une licence obligatoire à un fabricant du pays ni à un fabricant
étranger, parce que la portée des brevets est territoriale. A l’heure actuelle,
ces pays peuvent octroyer une licence obligatoire à un importateur, qui
pourrait s’approvisionner auprès d’un fabricant de génériques dans un pays où
le produit n’est pas breveté. Après 2005, cette option ne sera pas possible
pour les médicaments qui sont brevetés dans le pays fournisseur.
L’effet
pratique de cette disposition revient à retirer pratiquement toute valeur aux
dispositions d'octroi de licences obligatoires pour les pays qui sont
susceptibles d'en avoir le plus besoin, c’est‑à‑dire les plus
pauvres, car n’ayant que des capacités de fabrication intérieure limitées, il
n’y aura personne dans ces pays pour invoquer ces dispositions. Celles-ci
laissent donc totalement à désirer et la Déclaration de Doha reconnaît à bon
droit qu’une solution rapide doit être trouvée à ce problème.
La Déclaration de Doha soulève
plusieurs problèmes d’interprétation et nous allons en évoquer quelques-uns en
passant. Elle note que les pays sont libres de déterminer les motifs pour
lesquels des licences obligatoires sont accordées (paragraphe 5b) et ont le
droit de déterminer ce qui constitue « une situation d’urgence nationale
ou d’autres circonstances d’extrême urgence » (paragraphe 5c). Cette
dernière disposition traduit le raccourci de procédure autorisé dans ces
circonstances en application de l’article 31 b) de l’Accord sur les ADPIC.
Ainsi, le paragraphe 6 vise des procédures d'octroi de licences obligatoires
dans le secteur pharmaceutique nécessaires pour les « problèmes de santé
publique ... en particulier ceux qui résultent du VIH/SIDA, de la tuberculose,
du paludisme et d’autres épidémies » (paragraphe 1).[161]
Il ne vise pas, comme on l’a parfois supposé, uniquement l'octroi de licences
obligatoires en cas de crise grave ou de situation d’urgence. Il n’est pas non plus limité à un
type de maladie particulier.
Il faut aussi préciser quels sont
les pays ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n’en disposant
pas. Ici encore, nous pensons qu’il faut donner une interprétation économique.
Si la production d’un médicament nécessaire est techniquement possible mais
extrêmement coûteuse, l'octroi d’une licence obligatoire nationale ne sert à
rien. Si l’on recherche un accès abordable à des médicaments de qualité et de
quantité suffisantes, alors la solution serait de permettre la production de la
manière la plus économiquement viable, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays. En général, les pays en développement sont favorables à
une interprétation des « capacités de fabrication » qui tient compte
de critères économiques (par exemple, si les capacités sont telles que la
production économique est possible dans les circonstances envisagées) et
insistent sur le fait que le pays doit pouvoir décider lui-même des critères
produit par produit. Les pays développés, à une exception près, proposent que
l’on élabore des critères de définition, sans définir ce qu’ils devraient être.[162]
Etant donné que la Déclaration
permet également aux PMA de ne pas délivrer de brevets pharmaceutiques jusqu’en
2016, les pays qui tirent parti de cette disposition ne seront pas en mesure
d'octroyer des licences obligatoires, non plus que tout pays où un brevet n’a
pas été déposé. A l’heure actuelle, ces pays pourraient importer des produits
meilleur marché de pays n’ayant pas de brevets concernant les produits en
question, mais ici aussi cette situation changera après 2005. Par conséquent le
paragraphe 6, tout en visant plus particulièrement l'octroi de licences
obligatoires, vise très précisément l’ensemble des actions nécessaires pour
rendre les médicaments plus abordables et plus accessibles, notamment dans les
pays en développement et les moins avancés.
La Déclaration ne précise pas les
pays qui pourront être les fournisseurs des pays dont il s’agit. Afin de
maximiser la concurrence et de parvenir aux prix les plus bas possibles, il
semble que la solution fondée sur le marché la plus logique serait de
n’appliquer aucune restriction s’agissant des membres de l’OMC susceptibles
d’être des fournisseurs. Pour les mêmes raisons, les pays cherchant à obtenir
une licence devraient logiquement s’efforcer de trouver le titulaire de licence
obligatoire le plus compétitif, où qu’il se trouve. Les pays en développement
souhaitent avoir la possibilité de rechercher pour leurs importations des
fournisseurs dans n’importe quel pays. Un pays développé préconise la
possibilité d’importer depuis les pays développés, mais l’UE n’a pas d’opinion
déterminée et les Etats-Unis préconisent l’approvisionnement en provenance de
pays en développement uniquement, de même que les laboratoires pharmaceutiques
de recherche.
Cinq solutions principales sont
proposées au problème mentionné au paragraphe 6 de la Déclaration, solutions
que nous allons examiner successivement.
Modification
de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC. On pourrait
supprimer l'alinéa f) de l’article 31. Toutefois, ceci pourrait être considéré
comme modifiant le sens de l’Accord concernant l'octroi de licences
obligatoires dans les cas autres que pour répondre à des problèmes de santé
publique. L’autre solution est une modification qui spécifierait une exception
clairement définie à la restriction imposée par l'alinéa f) de l’article 31
concernant l'octroi de licences obligatoires nécessaires pour répondre aux
problèmes de santé publique tels qu’ils sont envisagés dans la Déclaration. Une
telle modification des dispositions de l’Accord sur les ADPIC prendrait
beaucoup de temps et exigerait la ratification des Etats. Une solution
temporaire ou provisoire, comme une déclaration d’intention et une dérogation
ou un moratoire temporaire concernant le règlement des différends, pourrait
être fournie afin de couvrir la période jusqu’à ce que toute modification
éventuelle soit ratifiée. Mais nombre de pays (tant développés qu’en
développement) pourraient hésiter à ouvrir à nouveau les négociations sur
l’Accord sur les ADPIC, car d’autres aspects de l’Accord risqueraient d’être
ouverts à nouveau à la négociation. En supposant qu’une solution soit trouvée,
il serait alors nécessaire qu’un pays exportateur éventuel supprime la clause
du « principalement » de sa propre législation et fasse en sorte
que les motifs de l'octroi de licences obligatoires soient bien ceux qui sont
envisagés dans la Déclaration. En fin de compte des licences obligatoires
devraient être invoquées et financées à la fois dans les pays importateurs et
exportateurs, si un brevet y existe dans les deux. Le pays exportateur devrait
être prêt de toute manière à octroyer une licence obligatoire au profit du pays
importateur.
Les pays en développement ont
proposé plusieurs possibilités de solution, notamment la révision de l’article
31 ou la suppression de l'alinéa f) de l’article 31, de manière que l'article
31 f) ne s’applique pas aux lois, mesures et règlements administratifs, y
compris l'octroi de licences obligatoires, adoptés pour protéger la santé
publique, et en particulier de manière à veiller à ce que les produits
pharmaceutiques soient d’un accès abordable. D’autres pays en développement ont
noté qu’en vertu des dispositions de l'alinéa f), il serait nécessaire
d'octroyer des licences obligatoires tant dans le pays importateur que dans le
pays exportateur, ce qui serait très lourd du point de vue administratif. L’UE
préconise la modification spécifique de cet alinéa décrite plus haut. Les
Etats-Unis ne recommandent pas la modification de cet alinéa, mais seraient
favorables à un moratoire sur les procédures de règlement de différends pour
parvenir au même résultat.
Interprétation
de l’article 30. L’article 30 prévoit
des exceptions limitées aux droits de brevet qui ne portent pas atteinte à
l’exploitation normale du brevet. En vertu de la solution proposée, une
modification de l’Accord sur les ADPIC n'est pas nécessaire, ni une licence
obligatoire dans le pays exportateur. L’un des avantages revendiqués serait
qu'elle permettrait des exportations vers des pays où aucun brevet n’existe
pour le médicament en question. Tout ce qui serait nécessaire, semble-t-il,
serait d’obtenir une « interprétation officielle » en vertu de
l’article IX de l’Accord sur l’OMC, adoptée par les trois quarts des membres de
l’OMC. Elle préciserait la légitimité d’une exception aux droits de brevet pour
permettre l’exportation dans des circonstances envisagées par la Déclaration.
Dans le pays exportateur, la législation nationale devrait à ce moment-là être
modifiée de manière à incorporer cette exception envisagée. Cette solution
proposée est critiquable parce qu’il faudrait alors savoir si
« l’exception de Doha » est compatible avec les conditions de
l’article 30. Une interprétation de cet article lors d’un groupe spécial de
l’Organe de règlement des différends[163]
a suggéré que l'expression « exceptions limitées » devrait être
interprétée de manière étroite. Il faut replacer ceci dans le contexte d’une
justification par le Canada d’une disposition d’exception pour exploitation
précoce par des concurrents éventuels en vue d’obtenir l’approbation réglementaire.
On peut avancer qu’une exception, telle qu’elle est suggérée ici,
est « limitée » à des circonstances particulières telles
qu’elles sont définies dans la Déclaration. On peut également dire qu’il n’y a
pas « d’atteinte injustifiée » à l’exploitation normale d’un brevet,
puisqu’il s’agit d’exportation à bas prix, à condition que « les intérêts
légitimes » du titulaire du brevet soient sauvegardés (par exemple, en
empêchant le détournement vers d’autres marchés). De plus, les intérêts
légitimes des tiers (personnes souffrant des maladies dans les pays en
développement) devraient être mis en balance de manière appropriée avec ceux du
titulaire du brevet. Dans l’ensemble, les circonstances extrêmement différentes
qui s’appliquent ici, par opposition à celles de l’affaire canadienne,
signifient que la jurisprudence de l’OMC est d’une utilité limitée.
Certains pays en développement
préconisent tout particulièrement la solution de l’article 30, faisant
remarquer qu’elle résout le problème de la double rémunération visée à
l’article 31 et supprime la nécessité d’une licence obligatoire dans le pays
exportateur. En ce qui concerne la procédure administrative, ils estiment que
c’est une option moins pesante. Il faut également noter que les ONG activistes
pensent que l’option de l’article 30 est préférable aux autres.
Moratoire
ou dérogation. Une autre solution serait la proposition de moratoire ou de
dérogation appliquée aux exportations dans les « circonstances de
Doha ». Ses partisans avancent qu’une dérogation est la solution la plus
rapide, soulignant qu’elle pourrait apporter une sécurité juridique tout en
évitant la nécessité soit de modifier, soit d’obtenir l’interprétation
officielle de l’Accord sur les ADPIC. Les conditions d’une dérogation seraient
fixées à l’avance pour définir les circonstances dans lesquelles elles
s’appliqueraient. Bien évidemment, il serait nécessaire de les préciser très
clairement et sans aucune ambiguïté de manière à satisfaire tous les membres de
l’OMC. Ceci n’a pas encore été tenté et la clarté pourrait être compromise de
manière inévitable dans les négociations sur les critères.
Le Conseil ministériel de l’OMC
devrait accepter les critères en vertu desquels les membres peuvent être
exemptés de l’application des dispositions de l’Accord sur les ADPIC.
Toutefois, que ce soit dans le cas d’un moratoire ou d’une dérogation, les
parties intéressées ne peuvent invoquer la protection en vertu de l’Accord que
si la législation nationale a été modifiée pour intégrer l’exemption à la prescription
de l'alinéa f) de l’article 31.[164]
Si la législation nationale n’est pas modifiée, le titulaire d'un brevet peut
toujours intenter un procès devant les tribunaux nationaux en dépit du fait
qu’il existe une dérogation ou un moratoire OMC. Il faut aussi se souvenir
qu’une dérogation exige une révision régulière de la part de la Conférence
ministérielle/du Conseil général si elle est accordée pour une période de plus
d’un an.
L’UE a suggéré qu’une dérogation
(ou un moratoire) pourrait être nécessaire en attendant l’approbation de la
modification qu’elle propose à l'alinéa f) de l’article 31. Certains pays en
développement ont avancé qu’une dérogation (ou un moratoire) ne constitue pas
de solution durable et juridiquement prévisible. Par contre, les Etats-Unis
estiment qu’une dérogation, ou un moratoire, permettrait de parvenir plus
facilement à une solution rapide, faisable, transparente, durable et
juridiquement certaine. Nous savons également que l’industrie pharmaceutique
soutient une proposition allant dans ce sens.
Non-justiciabilité. La proposition d’une option de
non-justiciabilité parviendrait à un résultat assez semblable à la démarche de
l’article 30 par un moyen différent. Cela fonctionnerait de manière semblable à
la position de l’Accord sur les ADPIC concernant l’épuisement des droits
(article six de l’Accord sur les ADPIC). Par interprétation officielle ou
modification de l’Accord, il serait décidé que le règlement des différends en
application de l’Accord sur les ADPIC ne serait pas utilisé en ce qui concerne
les exportations entreprises dans les conditions telles qu’elles sont
envisagées par la Déclaration. Toutefois, la manière dont cette proposition
serait appliquée n’est pas très claire.
Exportations par un pays au moyen d'une licence
obligatoire. Une dernière
option, qui ne dépend pas de l’OMC, serait que les pays ayant pour les
médicaments requis des capacités nécessaires d’ingénierie inverse ou de
fabrication, ainsi que d’importants marchés locaux, puissent octroyer des
licences obligatoires en application de leur propre législation. Dans ce cas‑là,
une proportion des produits fabriqués pourrait être offerte à l’exportation
vers des pays en ayant besoin (sur la base d’une licence obligatoire pour
l’importation si nécessaire) selon des modalités qui n’enfreignent pas les
dispositions de l'alinéa f) de l’article 31. Une licence obligatoire pourrait
également être accordée pour remédier à des pratiques anticoncurrentielles
(article 31, alinéa k)), et dans ce cas les restrictions aux importations ne
s’appliqueraient pas. Mais pour exercer cette option, il faudrait que le pays
fournisseur ait des raisons légitimes pour octroyer en premier lieu une licence
obligatoire, qu'il dispose d’un marché suffisamment important pour que les
exportations constituent moins de la moitié de la production totale et qu'il
soit disposé à exporter.
Le choix entre ces options sera fait pour des
raisons politiques, mais nous voulons insister fortement sur le fait que,
quelle que soit la solution juridique adoptée par l’OMC, elle devrait reposer
sur les principes suivants. Premièrement, il faudra qu'elle puisse être
appliquée rapidement et facilement en
vue d'apporter une solution à long terme. Deuxièmement, cette solution devra
veiller à ce que la priorité soit accordée aux besoins des pauvres dans les
pays en développement dépourvus de capacités de fabrication. Troisièmement,
elle devra viser à instaurer des conditions offrant aux fournisseurs éventuels
les incitations nécessaires pour exporter les médicaments dont ces pays ont
besoin.
Aspects économiques
Quels que soient les moyens
utilisés pour parvenir aux objectifs de Doha, les pays développés auront besoin
de garanties pour empêcher qu’un produit revienne depuis le bénéficiaire prévu
vers d’autres marchés, et pour veiller à ce que la production soit consacrée à
l’exportation vers le pays en question, et non pas à la vente sur le marché
intérieur. Il sera peut être nécessaire de prendre des mesures par
l’intermédiaire de l’OMC pour faire en sorte que tous les membres soient
informés complètement de la nature de la transaction de manière transparente.
Quelles que soient les garanties sur lesquelles l’accord se fasse, le point
essentiel est que la politique de l’offre vers un pays particulier ayant un marché
limité pourrait ne pas suffire à attirer des fournisseurs éventuels de
génériques. De plus, pour atteindre les prix les plus bas possibles dans le
cadre de l'octroi de licences obligatoires, il est nécessaire d’avoir une
concurrence entre plusieurs fournisseurs au point de la commande, voire au
moment de la fourniture réelle. Pour permettre par conséquent des économies
d’échelle et un certain niveau de concurrence, il est important que les petits
marchés se regroupent dans la mesure du possible.
Les groupes de pays ayant des
besoins semblables de médicaments essentiels devraient se regrouper. Les
institutions internationales comme l’OMS ou le Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme (GFATM) pourraient aussi avoir un rôle essentiel
à jouer en facilitant et en finançant les achats groupés de médicaments aux
fabricants de produits de marque comme de produits génériques.
Il faut
trouver un moyen de concilier la nature de la solution adoptée avec l’objectif
qui consiste à fournir des médicaments d'une qualité appropriée à des prix les
plus bas possibles. Si c'est impossible, la solution juridique n’aura guère de
réalité pratique. Et l’option de l'octroi de licences obligatoires ne pourra
guère servir d'instrument de négociation.
Législation dans les pays en développement
Pour que les DPI puissent
constituer une réponse aux problèmes de santé publique, il faut que les pays en
développement veillent à ce que leur législation prévoie des normes et
pratiques bien adaptées. Ce qui convient variera selon les circonstances du
pays et le niveau de développement. Par exemple, les pays ayant une capacité de
R&D importante, ou des compétences particulières disons en biotechnologie,
souhaiteront peut‑être disposer d’une protection « plus forte »
que les pays qui sont presque entièrement des utilisateurs des technologies
étrangères.
Les pays en développement ne
devraient pas se sentir, ni même être, obligés d’adopter les normes des pays
développés pour les régimes de DPI, car ils courent le risque d’être submergés.
Le nombre de nouvelles entités chimiques dont l’utilisation a été approuvée par
la Food and Drug Administration (FDA)
américaine n’était plus que de 27 en 2000, contre environ 60 en 1985.[165]
Mais le nombre de brevets délivrés dans la principale classe de brevets pour
les nouvelles compositions de médicaments (424) était de 6 730 en 2000.[166]
En grande majorité, les nouveaux brevets sont délivrés non pas pour de nouveaux
composés thérapeutiques, mais pour des variations dans les procédés de
fabrication, pour de nouvelles formulations ou des formes cristallines, pour de
nouvelles combinaisons de produits connus, ou pour de nouvelles utilisations de
médicaments connus. Pendant la période 1989-2000, 153 nouvelles autorisations
sur 1 035 accordées par la FDA concernaient des médicaments qui
contenaient de nouveaux ingrédients actifs et constituaient une amélioration
clinique significative. Quatre cent soixante-douze autres médicaments ont été
classés comme étant modestement innovants.[167]
Le
principe sous-jacent devrait être de prévoir des normes de brevetabilité
strictes et une portée étroite des revendications permises, dans le but de :
·
limiter la portée de l’objet qui peut être
breveté
·
appliquer des normes telles que seuls soient
délivrés des brevets qui répondent à des exigences strictes de brevetabilité,
et que l’ampleur de chaque brevet soit proportionnelle à la contribution
inventive et à la divulgation effectuée
·
faciliter la concurrence en limitant la
capacité des titulaires de brevets d’interdire aux autres de prendre pour point
de départ les inventions brevetées ou de concevoir des produits qui en sont
dérivés
·
fournir des garanties étendues pour que
les droits de brevet ne soient pas exploités de manière inappropriée.
Tout ceci
contribuerait à assurer que les règles régissant la délivrance des brevets
limitent dans la mesure du possible toute possibilité de délivrer un brevet qui
aurait pour objectif de protéger les marchés et d’exclure la concurrence plutôt
que d’encourager la R&D locale. De plus, des normes et pratiques de
délivrance de brevets mal définies, comme indiqué plus haut, peuvent réellement
faire obstacle à l’innovation en freinant les travaux de recherche entrepris
par les tiers. Comme, en vertu de l’Accord sur les ADPIC, il n’est pas possible
d’exercer une discrimination entre les différents domaines technologiques, nous
traiterons de l’application de ces principes plus en détail au Chapitre 6.
Toutefois, s’agissant des
produits pharmaceutiques, la plupart des pays en développement devraient au
minimum utiliser les possibilités offertes par l’Accord sur les ADPIC[168]
d’exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et
chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux, ainsi que les
nouvelles utilisations de produits connus (qui sont, essentiellement, des
équivalents de méthodes thérapeutiques). Etant donné que la plupart des pays en
développement ne sont pas en mesure de mettre au point ces méthodes, ils
n’auront rien à gagner en ne faisant pas usage de cette flexibilité. Bien sûr,
les quelques pays en développement dotés de capacités de recherche dans ces
domaines pourraient souhaiter avoir une telle protection, mais nous devons
noter que la plupart des pays développés excluent également ces domaines de la
brevetabilité. Nous voudrions également recommander que les pays en
développement réfléchissent très soigneusement à l’affaiblissement de cette
exception en assouplissant le concept de nouveauté et en permettant des revendications
de brevet pour essentiellement les premiers usages médicaux ou des usages
ultérieurs de composés chimiques connus, comme cela se fait dans plusieurs pays
développés et en développement.[169]
Ici encore, les pays développés peuvent considérer que pour encourager la
recherche, il est bon de permettre ces revendications, mais pour la plupart des
pays en développement dotés de capacités de recherche limitées, nous estimons
que les coûts dépasseront vraisemblablement les avantages.
La
plupart des pays en développement, notamment ceux qui ne sont pas dotés de
capacités de recherche, devraient exclure strictement de la brevetabilité les
méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales, y compris les
nouvelles utilisations de produits connus.
Nous allons maintenant aborder deux questions qui concernent plus
particulièrement le secteur pharmaceutique et la production des médicaments
génériques.
Exception Bolar
Aux Etats-Unis, la loi de 1984 sur la concurrence en matière de prix
des médicaments et la restauration de la durée du brevet a infirmé une décision
judiciaire qui faisait autorité (Roche contre Bolar, 1984) en introduisant
notamment ce qu'on appelle « l’Exception Bolar » (ou « exception
d’exploitation précoce »). Grâce à cette exception, un producteur de
génériques peut légalement importer, fabriquer et soumettre à des essais un
produit breveté avant l’expiration du brevet afin que ce produit puisse remplir
toutes les exigences réglementaires imposées par des pays particuliers comme étant
nécessaires à la commercialisation d’un générique. La légalité OMC de cette
exception a été confirmée en 2000 par le différend qui a été réglé entre l’UE
et le Canada.[170]
Cette question est importante pour les pays en développement, notamment s’ils
sont des fabricants actuels ou potentiels de génériques, afin de veiller à ce
que des génériques à des prix plus bas puissent être mis sur le marché dès que
le brevet arrive à expiration. Même s’ils ne sont pas des fabricants éventuels
dans un avenir prévisible, il serait prudent d’inclure cette exception dans la
législation. Par exemple, une société étrangère pourrait avoir besoin de faire
des essais en vue d’obtenir l’agrément officiel. Dans les législations
nationales de 63 pays en développement que nous avons examinées, seulement huit
comportaient spécifiquement une exception Bolar, bien que d’autres puissent
aussi autoriser « l’exploitation précoce » en vertu des exceptions
générales aux droits exclusifs (couvertes par des termes équivalents à l’article
30 de l’Accord sur les ADPIC).[171]
Les pays en
développement devraient inclure dans leur législation une exception aux droits
de brevet au titre de « l’exploitation précoce », ce qui permettra
d’accélérer l’introduction des substituts génériques à l’expiration du
brevet.
Approbation de la
commercialisation
Une autre mesure importante lors de la commercialisation d’un
médicament générique est la nécessité de remplir les prescriptions
réglementaires à cet effet. L’Accord sur les ADPIC prévoit à l’article 39.3 l’obligation
pour les pays de protéger les données confidentielles contre l'exploitation
déloyale dans le commerce (par exemple les données résultant d’essais) pour des
entités chimiques nouvelles déposées par les entreprises pour obtenir de
l’organisme de réglementation (comme la FDA aux Etats-Unis) l’approbation de la
commercialisation de nouveaux médicaments.
Cela se justifie par « l’effort considérable » que représente
la compilation de toutes ces données. Du point de vue des entreprises
pharmaceutiques bien entendu, il est injuste que le produit d'essais cliniques
et autres investigations ayant peut-être coûté des millions de dollars soit mis
à la disposition des concurrents qui n’ont pas à dépenser les mêmes sommes pour
obtenir l’approbation de commercialisation. Par contre, on peut avancer, du
point de la santé publique, que ces données devraient être dans le domaine
public parce qu’elles contiennent des informations médicales importantes non
disponibles ailleurs et que toute confidentialité excessive a des effets
indésirables (par exemple, les données pourraient être analysées à nouveau
utilement pour comprendre les effets secondaires qui n’ont été détectés
qu’après la commercialisation). De plus, du point de vue de la collectivité en
général, il est illogique qu’un fabricant éventuel de génériques ait à répéter
des essais extrêmement coûteux si l’équivalence biopharmaceutique de sa version
du médicament peut être démontrée de manière fiable. L’exclusivité des données
peut constituer un obstacle à l’entrée du générique sur le marché,
indépendamment du fait que le médicament a été breveté ou que la durée du
brevet a expiré.
L’Accord sur les ADPIC exige que l’on impose non pas une exclusivité en
tant que telle à propos de ces données d’essai, mais uniquement une protection
contre l'exploitation déloyale dans le commerce. Toutefois, certains règlements
de l’UE accordent l’exclusivité à ces données pour une période de six à dix
ans, et il est envisagé de l’allonger à dix ans. Par conséquent, les autorités
sanitaires ne peuvent pas compter sur ces données pour l’autorisation d’autres
applications sans le consentement des créateurs. Aux Etats-Unis, une protection
semblable est applicable pendant cinq ans.
Etant donné ce qui précède, nous estimons que les pays en développement
devraient protéger les données d’essai contre l'exploitation déloyale dans le
commerce afin de protéger les intérêts légitimes des créateurs des données et
leur « effort considérable ». Mais les dispositions de l’Accord
sur les ADPIC accordent une liberté considérable sur la manière dont cela peut
se faire.
Les pays
pourraient permettre aux autorités sanitaires d’autoriser les produits de
substitution génériques équivalents en « utilisant » les données d’origine. Les
pays en développement devraient appliquer une législation de protection des
données telle qu’elle facilite l’entrée des concurrents génériques, tout en
fournissant une protection appropriée aux données confidentielles, ce qui peut
être réalisé grâce à plusieurs moyens compatibles avec les dispositions de
l’Accord sur les ADPIC. Les pays en développement n’ont pas besoin de
promulguer des lois dont l’effet est de créer des droits exclusifs si aucune
protection par brevet n’existe ou d'étendre la durée effective du monopole du
brevet au-delà de sa durée normale.
Prorogation Doha pour les pays les moins avancés
La Déclaration de Doha
(paragraphe sept) donne pour instruction au Conseil des ADPIC de permettre aux
pays les moins avancés de repousser l’introduction de la protection par brevet
pour les produits pharmaceutiques et de la protection des données d’essai
confidentielles au moins jusqu’en 2016. Nous applaudissons l’intention qui est
derrière ce paragraphe, mais il crée et souligne plusieurs anomalies.
Au moins 70 % de la population
des PMA se trouvent dans des pays qui accordent une protection par brevet aux
produits pharmaceutiques, et 27 des 30 PMA en Afrique le font également. Ces
pays devraient donc modifier leur législation pour supprimer une telle protection
afin de tirer parti de cette prorogation. Il se pourrait très bien qu’ils aient
intérêt à le faire étant donné la longueur de cette prorogation. Toutefois,
nous pensons que les modifications à la législation ne pourront pas être
rétrospectives et que par conséquent les brevets en cours resteront valables.
De plus, certains pays seront
obligés de modifier leurs lois par accords bilatéraux ou multilatéraux. Par
exemple les 12 PMA membres de l’OAPI (trois ne sont pas des PMA) devront
convenir d’une révision de l’Accord de Bangui qui régit l’OAPI. De même,
d’autres pourraient être liés par des accords bilatéraux qui ne permettent pas
de prendre ces mesures.
Pour les pays qui n’ont pas
encore mis en place de protection de la PI, nous nous demandons s’il est bien
utile d’appliquer le régime complet de protection de la PI en 2006, sauf pour
la protection des produits pharmaceutiques. Etant donné que ces produits
représentent une proportion importante de toutes les demandes de brevets (par
exemple, 50 % des brevets délivrés par l’ARIPO en 1994-1999 portaient sur des
produits pharmaceutiques),[172]
il devient encore plus difficile de justifier l’utilisation de ressources
financières et humaines nécessaires pour l’application d’un régime de PI dans
ces pays uniquement pour les secteurs non pharmaceutiques. L’article 66.1 de
l’Accord sur les ADPIC prévoit que le Conseil des ADPIC peut autoriser des
prorogations de la période de transition pour les PMA compte tenu de leurs
« besoins et impératifs spéciaux ... leurs contraintes économiques,
financières et administratives et le fait qu’ils ont besoin de flexibilité pour
se doter d’une base technologique viable ». Il n’est par conséquent pas
logique d’accorder une prorogation pour un secteur pour des motifs de santé publique
jusqu’à une date spécifique à l’avenir alors que les critères spécifiés par
l’Accord sur les ADPIC pour accorder des prorogations sont beaucoup plus
amples.
Les PMA qui
accordent déjà une protection aux produits pharmaceutiques devraient examiner
avec soin le moyen de modifier leur législation pour tirer parti de la
Déclaration de Doha. Comme nous l’avons fait remarquer ailleurs, le Conseil des
ADPIC devrait revoir les dispositions transitoires applicables aux PMA,
notamment à ceux qui ont fait des demandes d’adhésion à l’OMC, et ce dans tous
les domaines technologiques.
Chapitre 3
AGRICULTURE ET RESSOURCES
GENETIQUES
INTRODUCTION
Contexte
On n’insistera jamais suffisamment sur l’importance du
secteur agricole, dans les pays en développement, comme source de denrées
alimentaires, de revenus, d’emplois et souvent de devises étrangères. Tout autant qu’une bonne santé, un
secteur agricole productif et durable est essentiel à la croissance économique
et à la réduction de la pauvreté. Environ trois quarts des pauvres du monde
vivent et travaillent dans des zones rurales.[173]
Outre son rôle direct de soutien des revenus et de l’emploi, la part de
l’agriculture, et en particulier de l’évolution des techniques agricoles, comme
facteur de l’ensemble de la croissance économique a été l’objet de nombreux
débats chez les économistes et les responsables politiques. Augmenter la
productivité de l’agriculture peut directement augmenter le niveau des revenus
et de l’emploi de la majorité des pauvres qui dépendent de l’agriculture. Cela
peut également contribuer à réduire le prix des denrées alimentaires (de
manière relative ou absolue) pour les populations pauvres vivant dans les zones
rurales et urbaines.
Depuis toujours l’agriculture est considérée, quoique tous
ne soient pas d’accord, comme une source de denrées alimentaires, d'emplois et
de financement permettant de subvenir aux besoins d’un secteur urbain et
industriel en expansion, dont dépendra la croissance durable des revenus. Pour
parvenir à cette situation, il faut habituellement augmenter la productivité de
manière que les prix des denrées alimentaires n’augmentent pas afin de ne pas
paralyser la croissance industrielle ni d’empêcher la réduction de la pauvreté.
Dans les pays développés, les changements technologiques et institutionnels du
secteur agricole sont considérés comme ayant joué un rôle clé dans la
révolution industrielle.
Dans les pays en développement, les progrès techniques se
sont traditionnellement produits grâce à un processus d’expérimentation, de
sélection et d’adaptation dans l’exploitation agricole des variétés de pays[174]
traditionnelles. Puis est intervenue une sélection intentionnelle de nouvelles
variétés de cultures, principalement par croisement des variétés ayant des
caractéristiques souhaitables. Ce processus de recherche, mené principalement
dans le secteur public par les instituts nationaux de recherche, a été
entretenu au cours de ces trente dernières années par un réseau d’instituts de
recherche internationaux sous l’égide du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI). C’est ce réseau qui a conduit à la Révolution
verte des années 60, fondée initialement sur des variétés demi-naines de riz et
de blé de fort rendement. En dépit des critiques relatives à son impact sur
l’environnement et sur la répartition, cette technologie est largement
considérée dans le monde comme ayant eu des répercussions favorables sur
l’alimentation, l’emploi et les revenus, bien que surtout dans les régions des
pays en développement où l’irrigation pouvait être raisonnablement assurée.
Ensuite, les obtenteurs ont fait de nouvelles tentatives, moins heureuses, pour
étendre ces technologies aux nouvelles cultures et aux régions en cultures
sèches et non irriguées.
Plus récemment, des changements significatifs se sont
produits tant au niveau de la technologie que de la structure de la recherche
agricole. Tout d’abord, l’arrivée de la biotechnologie, et en particulier du
génie génétique, a permis, au cours de ces vingt dernières années, d’élargir
les possibilités dans le domaine de la recherche agricole (par exemple
l’introduction de nouvelles caractéristiques génétiques dans les végétaux).
Ensuite, alors que les investissements publics dans la recherche publique, tout
au moins par l’intermédiaire du GCRAI, ont eu tendance à stagner au cours de
ces dernières années, l’investissement du secteur privé a augmenté de manière
très rapide.[175] Les forces du marché déterminent de plus en
plus l’orientation et l’objectif des dépenses de recherche supplémentaires.
Droits de propriété intellectuelle en
agriculture
Traditionnellement, les systèmes de protection de la
propriété intellectuelle ont été appliqués principalement aux inventions
mécaniques d’une sorte ou d’une autre, ou aux créations artistiques.
L’atttribution de DPI sur des organismes vivants est relativement récente dans
les pays développés. Les plantes obtenues par multiplication végétative sont
brevetables aux Etats‑Unis seulement depuis 1930. Et la protection des
variétés végétales (ou droit d'obtention végétale - DOV), nouvelle forme de
propriété intellectuelle, ne s’est répandue que pendant la deuxième moitié du
XXe siècle. Ainsi, les systèmes de protection des végétaux
proviennent de la structure économique et de la situation de l'agriculture dans
les pays développés à cette époque-là. L’apparition de ces systèmes traduisait
le souci croissant des obtenteurs privés de protéger leur propriété
intellectuelle. Les agriculteurs traditionnellement replantent, échangent ou
vendent des semences de la récolte de l’année précédente, ce qui signifie que
les obtenteurs ont des difficultés à récupérer les investissements faits pour
les variétés améliorées par l’intermédiaire de ventes renouvelées. Les brevets
ou les DOV imposent normalement des restrictions à la possibilité des agriculteurs de vendre leurs
propres semences (et dans certains cas de les réutiliser) et, par conséquent,
renforcent le marché des semences des obtenteurs. Même dans les pays développés,
la réutilisation des semences reste très courante, bien que pour de nombreuses
cultures les achats annuels soient maintenant de règle. Dans les pays en
développement, la majorité des agriculteurs réutilisent, échangent ou vendent
officieusement aux voisins, et les achats annuels de nouvelles semences sont
relativement rares dans la plupart des pays.
Avec l’adoption de l’Accord sur
les ADPIC, les pays en développement ont été obligés de protéger les variétés
végétales, par des brevets ou d'une autre manière, sans qu’on se soit demandé
vraiment si cette protection serait bénéfique à la fois au producteur et au
consommateur, ou si elle aurait des répercussions sur la sécurité alimentaire.
Comme dans le cas des médicaments, on peut se demander si, et dans quelle
mesure, la protection de la PI peut contribuer à encourager la recherche et
l’innovation répondant aux besoins des pays en développement et des pauvres. Il
faut aussi se demander quelles sont pour les agriculteurs les répercussions de
la protection de la PI sur les coûts et la disponibilité des semences et des
autres intrants dont ils ont besoin.
Si l’objectif de la protection
des variétés végétales est d’offrir des incications aux obtenteurs, alors il
faudrait savoir comment la contribution que les agriculteurs apportent à la
conservation et au développement des ressources phytogénétiques doit être
reconnue et préservée. Avant l’introduction des programmes de sélection
officiels, les améliorations variétales et culturales dépendaient d’un
processus de sélection et d’expérimentation effectué par les agriculteurs.
Certains programmes de sélection officiels ont depuis utilisé ces variétés et
ces connaissances afin de mettre au point des variétés améliorées de
productivité accrue, ou dotées d’autres caractéristiques souhaitables. On se demande
alors si cette contribution des agriculteurs à la conservation et à
l’innovation ne devrait pas être protégée ou récompensée. S'appuyant sur les
principes inscrits dans la Convention sur la diversité biologique (CDB), que
nous examinons au chapitre suivant, le nouveau Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGRFA)
cherche à établir des principes permettant de faciliter l’accès aux ressources
phytogénétiques et de mettre en place des mécanismes justes et équitables de
partage des avantages.
Dans ce chapitre, nous abordons les questions suivantes :
·
La protection de la propriété
intellectuelle sur les végétaux et les ressources génétiques peut-elle
contribuer à créer les technologies nécessaires aux agriculteurs des pays en
développement ?
·
La protection de la PI aura-t-elle des
répercussions sur l’accès des agriculteurs aux technologies dont ils ont besoin
?
·
Quel apport le système de propriété
intellectuelle peut-il faire aux principes relatifs à l’accès et au partage des
avantages inscrits dans la CDB et dans l'ITPGRFA ?
LES VEGETAUX ET LA PROTECTION DE
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Introduction
Conformément à
l’Accord sur les ADPIC, les pays peuvent exclure de la brevetabilité les
végétaux et les animaux ainsi que les procédés essentiellement biologiques pour
les produire, mais non les micro‑organismes. Et ils doivent protéger les
variétés végétales, soit par des brevets soit par un système sui generis.
Les définitions concernant les
mots utilisés par l’Accord sur les ADPIC présentent nombre de difficultés
juridiques, comme la signification exacte d’une variété végétale, d’un
« micro‑organisme » ou d’un procédé essentiellement biologique.
Mais il est important de noter ici que l’Accord sur les ADPIC ne dit pas si les
gènes devraient ou non être brevetables, qu’ils proviennent des végétaux, des
humains ou des animaux. La question soulevée par l’Accord sur les ADPIC porte
sur ce qui constitue une invention en ce qui concerne le matériel génétique.
Par exemple, le matériel génétique identifié dans la nature devrait-il être
brevetable aux motifs que son isolation et sa purification le différencient
d’une découverte non brevetable ? Il s’agit là d’une question qui relève de la
législation nationale. La seule prescription spécifique, à part celle qui
concerne les micro-organismes, porte sur l’obligation de protection des
variétés végétales.
Au nom de l’éthique, certains
s’opposent totalement à la délivrance de brevets sur des organismes vivants,
considérant que la propriété privée de substances créées par la nature est
injuste et incompatible avec les valeurs culturelles dans différentes parties
du monde. Le séquençage du génome humain soulève également des inquiétudes
particulières. Nous reconnaissons ces inquiétudes que nous examinons plus en
détail au Chapitre 6 dans le contexte de la conception des systèmes de brevets.
Les questions éthiques et juridiques concernant la délivrance de brevets pour
l’ADN sont examinées dans un récent rapport du Conseil Nuffield sur la
bioéthique.[176]
Notre tâche ici consiste à examiner les conséquences pratiques et économiques
de la délivrance de brevets dans l’agriculture et ses répercussions sur les
moyens d’existence des pauvres et l’élaboration des politiques officielles.
Pour le
matériel végétal, la protection de la propriété intellectuelle peut être
conférée de plusieurs manières :
·
Le
modèle américain de brevets de plantes, qui sont distincts des brevets normaux
(utilité)
·
En
permettant la délivrance de brevets normaux pour des végétaux ou des parties de
végétaux, comme les cellules
·
Par la délivrance de brevets sur des
variétés végétales, comme c’est la pratique aux Etats-Unis et dans quelques
autres pays (mais pas dans l’UE, par exemple)
·
En appliquant une forme sui generis de protection des variétés
végétales (PVV), telle que le droit d'obtention végétale (comme dans l'UE et
aux Etats-Unis) ou autres modalités
·
En permettant la délivrance de brevets
pour des séquences d’ADN et des gènes chimères, y compris le gène, les végétaux
transformés par ces chimères, les semences et la descendance de ces végétaux.
De plus, les brevets sont
largement utilisés pour protéger les technologies qui sont employées dans la
recherche sur la génomique végétale.[177]
Outre l’utilisation des brevets
et de la PVV, la propriété intellectuelle relative aux végétaux peut être
acquise par des moyens technologiques. Par exemple, des cultures comme le maïs
hybride[178]
commercial ne peuvent pas être réutilisées, si l’on veut conserver la vigueur et
le rendement de l’hybride. Cette caractéristique de certains hydrides confère
une forme naturelle de protection aux termes de laquelle les semenciers peuvent
plus rapidement obtenir un retour sur leur investissement grâce aux ventes
renouvelées de semences. Par contraste, d’autres types de variétés de semences
peuvent être replantés chaque année sans dégradation des rendements, de sorte
que les agriculteurs peuvent replanter leurs propres semences sans nouvel
achat. Les variétés de la Révolution verte étaient de cette nature, ce qui
explique pourquoi elles ont eu autant de succès. Il n’y a pas longtemps que les
variétés hybrides de riz et ensuite de blé ont été mises au point. « Les
technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques » (GURT)
est un terme utilisé pour décrire différentes formes de contrôle de l’action
des gènes dans les végétaux. La terminologie appelée « terminator »,
qui rendrait les semences stériles de sorte qu’il ne soit pas physiquement
possible d’obtenir une deuxième récolte,[179]
est bien connue, mais d’autres caractéristiques peuvent également être
maîtrisées, pour des raisons agronomiques ou commerciales. L’effet de la
protection technologique est semblable à celui de la protection de la PI, mais
probablement moins coûteux et certainement plus efficace étant donné qu’il est
automatique.
Recherche et développement
Comparée à la recherche médicale,
la R&D agricole est beaucoup plus souvent entreprise par et pour les pays
en développement. On estime, par exemple, qu’en 1995 les dépenses totales du
secteur public en recherche agricole dans les pays en développement, bien que
leur répartition soit inégale, représentaient 11,5 milliards de dollars (en
valeur internationale du dollar de 1993) contre 10,2 milliards de dollars dans
les pays développés.[180]
La grande majorité de la recherche est menée dans les pays en développement
d’Asie et d’Amérique latine les plus avancés du point de vue technologique. En
outre, les dépenses de recherche de ces pays ont augmenté de 5 à 7 % par an de 1976 à 1996, alors qu’elles
stagnaient en Afrique.[181]
Par contre, sur les 11,5 milliards de dollars de dépenses totales mondiales de
la recherche privée, seulement 0,7 milliard peut être attribué aux pays en développement.
Ceci signifie qu'au niveau
mondial environ un tiers de toute la R&D agricole est dépensé dans les pays
en développement, soit considérablement plus que le maximum de 5 % que l’on
estime consacrer à la recherche en matière de santé pour ces mêmes pays. Il
faut noter trois éléments ici. Tout d’abord le montant total de la R&D en
agriculture n’est que légèrement supérieur à la moitié du montant estimé de la
R&D en matière de santé.[182]
Deuxièmement, le montant de R&D consacré à l’agriculture est près de deux
fois plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé. En médecine,
les dépenses du secteur privé sont proportionnellement plus importantes, comme
nous l’avons déjà vu. Troisièmement, et en partie de ce fait, les pays en
développement sont relativement mieux servis pour ce qui est de la recherche
agricole.
Néanmoins, les tendances
actuelles peuvent inquiéter. Bien que le GCRAI ne dépense que 340 millions de
dollars environ par an, son rôle est d’importance stratégique. Par exemple, les
centres du GCRAI ont joué un rôle essentiel dans la Révolution verte et
actuellement sont les dépositaires de la collection la plus vaste du monde de
ressources génétiques importantes pour les pays en développement, collection
qui constitue la principale source d’amélioration des récoltes pour l’avenir.
Mais le financement du système GCRAI, qui est à la charge de la communauté des
bailleurs de fonds, a diminué en valeur réelle depuis 1990[183],
situation qui menace à la fois ses efforts de recherche et ses capacités à
assurer le fonctionnement des banques de gènes ou à aider les pays en
développement à gérer leurs collections. En fait, la FAO et le GCRAI ont
demandé une dotation pour veiller à ce que ce matériel génétique puisse être
correctement géré dans le monde entier.[184]
Alors que le financement provenant des bailleurs de fonds reste stable, le
secteur privé constitue l’élément dynamique de la R&D agricole, mais une
petite partie seulement intéresse directement les agriculteurs pauvres des pays
en développement.
Impact de la protection des variétés végétales
Dans cette section, nous
examinons les données factuelles concernant l’impact de la protection des
variétés végétales (PVV) dans les pays développés et en développement, et ce
que ces systèmes de PVV pourraient avoir à offrir aux pays en développement.
La plupart des données factuelles
relatives à l'impact des brevets ou de la PVV sur la recherche proviennent des
pays développés et sont loin d’être nombreuses. Avant l’introduction de la
protection de la PI, les initiatives de sélection effectuées par le secteur
privé portaient surtout sur les variétés hybrides, notamment pour le maïs aux
Etats-Unis, car dans ces variétés existe un élément inhérent de
« protection technologique ». Selon une étude américaine des années
80, rien ne prouvait que l’ensemble de l’activité de R&D était en
augmentation du fait de l’introduction de la PVV, sauf peut-être dans une
certaine mesure pour le soja et peut-être le blé.[185]
Ces dernières cultures représentaient également la majorité des certificats
d'obtention végétale délivrés. Il existait également d’autres preuves que la
PVV était utilisée en tant que stratégie commerciale pour la différenciation
des produits, et qu’elle avait contribué au grand nombre de fusions qui avaient
eu lieu dans l’industrie des semences. Mais ces données ne sont pas
concluantes, en particulier parce qu’il est difficile de séparer l’effet de la
protection de celui des autres changements intervenus. Même à l’heure actuelle,
les dépenses de recherche consacrées aux cultures hybrides en tant que part des
ventes continuent à dépasser celles qui sont consacrées aux cultures non
hybrides, qui sont le principal objet de la PVV.[186]
Il a été démontré dans une étude récente que la PVV concernant le blé aux
Etats-Unis n’avait pas contribué à augmenter les investissements relatifs aux
sélections de semences de blé effectuées par le secteur privé, mais qu’elle
pouvait avoir obtenu ce résultat dans le secteur public. Cette protection n’a
pas non plus contribué à accroître les rendements. Mais la part des superficies
plantées de blé provenant de variétés d’origine privée a augmenté notablement,
ce qui renforce l’idée que la PVV est principalement utilisée comme outil de
commercialisation.[187]
Une étude
majeure menée dans les pays en développement à revenu intermédiaire[188]
n’a pas pu vraiment établir que la PVV entraîne une augmentation du matériel
végétal mis à la disposition des agriculteurs, ou de l’innovation. L’accès au
matériel génétique étranger s’était amélioré, mais son utilisation était
parfois soumise à des restrictions, par exemple en ce qui concerne les
exportations. En général, les gros agriculteurs et l’industrie des semences
étaient considérés comme les principaux bénéficiaires. Les agriculteurs pauvres
n’avaient pas bénéficié directement de cette protection, mais pouvaient en
principe être durement touchés par les restrictions apportées à la conservation
et à l’échange des semences à l’avenir.
En vertu des dispositions de l’Accord sur les
ADPIC, les pays en développement peuvent prévoir un « système sui generis efficace » de PVV. Une décision importante consiste à identifier un
système qui convient à l’agriculture et aux conditions socioéconomiques
particulières au pays. La Convention UPOV (voir Encadré 3.1) est l’un des
systèmes qu’ils peuvent adopter, fondé sur la législation introduite en Europe
et aux Etats-Unis. Cette convention a l’avantage de fournir un cadre législatif
tout prêt, mais elle présente l’inconvénient d’avoir été conçue pour répondre
aux besoins de l’agriculture commercialisée des pays développés. C’est pourquoi
des réserves se sont élevées à propos de l’application du modèle UPOV dans les
pays en développement, certaines concernant toute forme de PVV quelle qu’elle
soit.
Les critères relatifs à l'octroi d'un certificat d’obtention
végétale impliquent des seuils inférieurs à ceux des normes nécessaires à
l’octroi de brevets. La nouveauté et le caractère distinctif sont exigés, mais
il n’y a pas d’équivalent de la non-évidence (activité inventive) ni de
l’utilité (applicabilité industrielle). Par conséquent, le droit en matière de
PVV permet aux obtenteurs de protéger des variétés dotées de caractéristiques très semblables, ce
qui signifie que le système tend à être dirigé par des considérations d’ordre
commercial (différenciation de produits et obsolescence planifiée) plutôt que
par des améliorations authentiques des caractères agronomiques.[189]
Les pays en développement pourraient envisager de relever ce seuil, de sorte
que la protection ne soit accordée que pour des innovations notables ou
importantes ayant des caractéristiques particulières jugées utiles du point de
vue social (par exemple, des augmentations de rendement ou des caractères
relatifs à la valeur nutritive). Ainsi, les critères relatifs au caractère
distinctif pourraient être renforcés, et il serait possible de formuler des
critères définissant l’utilité d’après des objectifs de politique agricole. Une
autre solution serait que les pays décident de conserver des normes moins
exigeantes pour certaines catégories de végétaux, afin de faciliter l’accès des
toutes jeunes industries nationales en matière de sélection à la PVV dont il
pourrait découler des avantages pour le commerce intérieur et
l’exportation.
De même, l'exigence d’homogénéité
(et de stabilité) dans les systèmes de type UPOV exclut les variétés locales
mises au point par les agriculteurs qui sont plus hétérogènes du point de vue
génétique et moins stables. Mais ces caractéristiques sont justement celles qui
leur permettent de s’adapter à l’environnement agro-écologique dans lequel
vivent la plupart des agriculteurs pauvres. Ici aussi, les pays en
développement auraient la possibilité de mettre au point des systèmes capables
de fournir une protection aux variétés qui répondent aux critères convenant aux
conditions et aux cultures dont dépendent les agriculteurs pauvres. Mais de
tels critères pourraient être difficiles à établir, et le système coûteux à
faire fonctionner. Et les Etats pourraient penser que l’extension d’un tel
système ne jouerait pas de rôle positif dans l’élaboration de leurs systèmes
d’exploitation agricole.
Une autre préoccupation porte sur
le critère d’homogénéité. Alors que les partisans de la PVV avancent qu’en
stimulant la production de nouvelles variétés, elle augmente véritablement la
biodiversité, d’autres affirment que l'exigence d’homogénéité, et la
certification de variétés de cultures essentiellement semblables, augmenteront
l’uniformité des cultures et la diminution de la biodiversité. Bien sûr, cette
préoccupation va bien au-delà de la PVV. Dans de nombreux pays, la législation
en matière de semences impose de strictes conditions d’homogénéité, parfois
plus strictes que la législation en matière de PVV. De plus, de semblables
inquiétudes ont été suscitées par l’uniformité accrue résultant de la réussite
des variétés de la Révolution verte, qui a conduit à une plus grande
sensibilité aux maladies et à une diminution de la biodiversité naturelle.
Mais, à mesure que la sélection des variétés est de plus en plus une activité du
secteur privé, et que de nouvelles variétés remplacent un grand nombre de
variétés traditionnelles, il est essentiel de savoir comment les ressources
génétiques doivent être conservées et gérées pour une utilisation future
éventuelle, que ce soit dans les champs ou dans des « banques de
gènes ».[190]
Il peut également être nécessaire
de faire une distinction entre les normes de protection selon les différents
types de cultures. Par exemple, les pays ayant des secteurs commerciaux et
d’exportation importants pourraient adopter des normes de type UPOV pour les
cultures qui relèvent de ces secteurs afin d’encourager l’innovation et la
commercialisation. Mais ils pourraient adopter d’autres normes pour les
cultures vivrières récoltées par les agriculteurs en vue de protéger leurs
pratiques, qui consistent à conserver, échanger et vendre les semences, ainsi
que les autres systèmes spontanés d’innovation. Par exemple, au Kenya, les
droits conférés par la PVV semblent avoir été demandés surtout par les
entreprises commerciales appartenant à des étrangers qui exportent des fleurs
et des légumes, afin de renforcer la commercialisation et l’exportation. Ceci
peut être avantageux pour l’expansion des industries d’exportation du Kenya et
pour son agriculture commerciale, ainsi que, indirectement, pour les
populations pauvres. La PVV peut faciliter la mise à disposition de nouvelles
variétés au Kenya (qui auraient pu ne pas l’être en l’absence de protection),
mais ne semble guère stimuler la recherche locale. Apparemment, le système n’a
pas répondu véritablement aux préoccupations directes des agriculteurs pauvres
du Kenya et n'a pas présenté beaucoup d'intérêt s'agissant des plantes qu'ils
cultivent.
Encadré
3.1. Union internationale pour la
protection des obtentions végétales (UPOV)
L’accord reconnu dans le monde en matière de PVV est la
Convention UPOV, qui date de 1961 et a été révisée trois fois depuis. A
l’exception de l’Afrique du Sud, les premiers pays en développement à adhérer à
l’UPOV ont été l’Uruguay et l’Argentine en 1994, ce qui a porté le nombre des
membres à 26. Depuis 1994, 24 autres pays en développement y ont adhéré. Bien
que les dispositions de l’Accord sur les ADPIC prévoient seulement qu’il
devrait y avoir un régime sui generis,
l’UPOV constitue un choix évident, car elle fournit une solution toute prête
pour élaborer une telle législation. De plus, des pressions ont été exercées
sur divers pays pour qu’ils adhèrent à l’UPOV dans le contexte d’accords
commerciaux bilatéraux (par exemple, l’accord commercial récemment conclu entre
le Vietnam et les Etats-Unis oblige les deux parties à être membres de l’UPOV,
dont les Etats-Unis sont déjà membres).
L’objectif de la Convention UPOV est d’assurer que les Etats
membres de l’Union reconnaissent les résultats des obtenteurs de nouvelles
variétés végétales, en mettant à leur disposition un droit de propriété
exclusif sur la base d’un ensemble de principes uniformes et clairement
définis.
Comme la Convention UPOV a été révisée par la suite (1978 et
1991), la portée et l’étendue de la protection ont été élargies. La période
minimale de protection a été augmentée à 20 ans (25 ans pour les vins et les
arbres) dans la version de 1991 (alors qu’elle était respectivement de 15 et 20
ans auparavant). A la différence des brevets, les critères de protection ne
comprennent pas d’activité inventive proprement dite. Pour avoir droit à la
protection, les variétés doivent distinctes, homogènes, stables et nouvelles
(s’agissant de la commercialisation antérieure).
L’Acte de 1978 de la Convention permettait aux obtenteurs
d’utiliser des variétés protégées comme source de nouvelles variétés, pouvant
être à leur tour protégées et commercialisées. Le texte de 1991 préserve la
dérogation de l’obtenteur, mais le droit de l’obtenteur s’étend à des variétés
qui sont « essentiellement dérivées » de la variété protégée, qui ne
peut pas être commercialisée sans l’autorisation du titulaire de la variété
originale.
Le texte de 1978 fournissait à l’obtenteur une protection en
ce qui concerne la production de semences à des fins d'écoulement commercial,
leur mise en vente et leur commercialisation (article 5.1) et par conséquent
autorisait implicitement les agriculteurs à replanter et à échanger leurs
semences (bien que ce droit ne soit pas spécifié). La Convention de 1991 est
plus restrictive en ce qui concerne les droits des agriculteurs. Le droit de
l’obtenteur s’étend maintenant à la production ou à la reproduction, en plus de
la commercialisation du matériel reproduit ou récolté (article 14.1). Ceci est
atténué par une dérogation facultative qui permet aux agriculteurs
« d’utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le
produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre
exploitation, de la variété protégée ou [d’une variété essentiellement dérivée de la variété protégée] ».
(Article 15.2).[191]
Les pays en développement
devraient envisager de fonder leur législation en matière de PVV sur une
appréciation réaliste de la manière dont elle pourrait faciliter le
développement agricole et la sécurité alimentaire, compte tenu aussi du fait
que l'agriculture peut créer des exportations, des devises et des emplois. Ils
devraient en particulier envisager des modifications éventuelles au modèle de
la Convention UPOV pour l'adapter à leurs propres circonstances.[192] Plusieurs pays ont adopté ou
envisagent d'adopter des lois qui tiennent compte des éléments décrits
ci-dessus.[193]
Un aspect important des systèmes sui generis est la portée de la
dérogation des agriculteurs. A la différence des brevets, la législation en
matière de PVV prévoit en général une dérogation, comme dans la Convention UPOV
de 1978, qui permet aux agriculteurs de réutiliser les semences récoltées sur
leur propre exploitation sans l'autorisation du titulaire des droits. Aux
Etats-Unis, cette dérogation a été élargie de manière à permettre des ventes
limitées de cultures récoltées afin de procurer des semences à d'autres
agriculteurs. Et dans le monde en développement, en l'absence de règles
juridiques, les agriculteurs échangent et vendent officieusement leurs
semences. Comme nous l'avons fait remarquer, il s'agit là d'une pratique
toujours très répandue parmi les agriculteurs pauvres des pays en développement
et même encore courante dans les pays développés. Ces systèmes de vente et
d'échange constituent un mécanisme important permettant aux agriculteurs de
sélectionner et d'améliorer traditionnellement leurs propres variétés, et la
restriction de ce droit pourrait empêcher ce processus d'amélioration. Bien que
le texte de la Convention UPOV de 1991 permette aux pays d'autoriser les
agriculteurs à réutiliser leurs propres récoltes à des fins de semences sur
leurs propres exploitations, elle ne permet ni la vente, ni l'échange de
manière informelle. Par contre, l'Accord sur les ADPIC prescrit seulement
l'obligation d'une certaine forme de protection de la PI pour les variétés
végétales et ne définit en aucune manière les dérogations aux droits des
détenteurs de variétés protégées qui peuvent être prévues.
Ainsi, certains pays et
organisations ont essayé plusieurs solutions différentes dans ce domaine. Par
exemple, l'OUA (maintenant l'Union Africaine) a produit une législation modèle
pour que les pays africains puissent l'adapter dans leur propre législation.
Cette législation prévoit le droit de conserver, d'utiliser, de multiplier et
de reproduire les semences qui ont été obtenues sur l'exploitation, mais
n'autorise pas leur vente à une échelle commerciale.[194]
L’Inde, qui a récemment décidé de demander l'adhésion à l'UPOV, a intégré dans
sa loi sur la PVV (2002) une clause (39.1.iv)) aux termes de laquelle :
« Un agriculteur est réputé avoir le droit de
conserver, d’utiliser, de semer, de semer à nouveau, d’échanger, de partager ou
de vendre le produit de sa récolte, y compris les semences d’une variété
protégée en vertu de la présente loi, comme il en avait le droit avant l’entrée
en vigueur de la présente loi :
A condition que l'agriculteur n'ait pas le droit de vendre
des semences de marque d'une variété protégée en vertu de la présente
loi. »[195]
La dérogation de l’obtenteur,
conformément aux dispositions de la PVV, est également différente de la
législation en matière de brevets, car les obtenteurs peuvent sans autorisation
utiliser une variété protégée comme base de sélection d’une autre variété (qui
elle-même pourra ensuite obtenir une protection). Ainsi, la PVV fournit une
protection moindre que le brevet et, comme nous l’avons montré également, une
incitation minime à la recherche, mais de ce fait, elle présente aussi moins de
restrictions que le brevet à l’innovation progressive ultérieure. Ici aussi,
les pays en développement sont libres de choisir précisément les dérogations
qu’ils accordent. Au maximum, la PVV pourrait être conférée comme une catégorie
supérieure de certificat de semence ou de cachet donnant au détenteur les
droits exclusifs de vendre la semence portant ce cachet. Mais il n’existerait
aucun droit susceptible de protéger l’utilisation ou la vente ultérieure des
semences, tant qu’elles ne sont pas vendues assorties d’un certificat. Ce droit
pourrait être supérieur à celui d’une marque ou d’un certificat de semence,
mais ne limiterait en aucune manière la réutilisation ultérieure des semences récoltées.
Un tel système permettrait d’adapter la PVV aux besoins des agriculteurs
pauvres, mais il ne serait pas aussi motivant pour les obtenteurs.[196]
Impact des
brevets
Les brevets sur les variétés
végétales en tant que telles ne sont autorisés qu’aux Etats-Unis, au Japon et
en Australie, et c’est aux Etats-Unis qu’ils sont les plus fréquents. La loi
américaine de 1930 a introduit une catégorie spéciale de brevet de plante pour
le matériel obtenu par multiplication végétative, mais il est maintenant possible
aux Etats-Unis de délivrer des brevets d’utilité ordinaires pour des variétés
végétales. Les brevets constituent la forme de protection de la propriété
intellectuelle la plus forte, en ce sens qu’ils permettent normalement au
titulaire des droits d’exercer le contrôle le plus vaste sur l’utilisation du
matériel breveté en limitant les droits des agriculteurs de vendre ou
réutiliser les semences qu’ils ont récoltées, ou ceux d’autres obtenteurs
d’utiliser les semences (ou les technologies intermédiaires brevetées) à des
fins de recherche et sélection ultérieures. Toutefois, le droit des brevets
peut prévoir des dérogations semblables à celles des systèmes de PVV. Par
exemple la directive relative à la protection juridique des inventions
biotechnologiques de l’UE, tout en n’autorisant pas la délivrance de brevets
sur des variétés végétales, prévoit une dérogation pour l’agriculteur lorsqu’un
brevet portant sur un matériel génétique empêcherait autrement sa réutilisation
dans l’exploitation agricole. Elle contient également une disposition relative
à l'octroi de licences obligatoires, dans certains conditions, lorsque
l’utilisation d’un matériel par un obtenteur porterait autrement atteinte aux
droits conférés par un brevet.[197]
Aux Etats-Unis, le brevetage des
variétés végétales est particulièrement important parce que, en insérant les
revendications appropriées dans le brevet, le détenteur de la variété brevetée
peut empêcher les autres de l’utiliser à des fins de sélection. Il s’agit d’une
différence tout à fait significative par rapport à la PVV. Apporter la preuve
qu’une nouvelle variété répond aux critères de brevetabilité est plus ardu et
plus coûteux que d’obtenir la protection de la variété végétale, qui implique
des critères de protection sont plus bas. La protection par brevet est
également fréquemment obtenue grâce à un brevet de large portée qui revendique
le gène, le vecteur ou le porteur pour effectuer la transformation, etc., ce
qui peut recouvrir plusieurs variétés ou cultures susceptibles d’incorporer ce
gène. A des fins pratiques, ceci pourrait avoir le même effet que de faire
breveter toute la plante, car le brevet confère une protection qui s’étend à
« toute matière ... dans laquelle le produit est incorporé ».[198]
Quelles que soient les incitations
fournies par la délivrance d’un brevet, les forces du marché auront tendance à
orienter les efforts de recherche du secteur privé vers ce qui pourra rapporter
le rendement le plus élevé. Toutefois, par opposition aux médicaments, les
entreprises sont susceptibles d’être intéressées par des cultures qui sont
largement récoltées dans les pays en développement. Les coûts d’investissement
sont proportionnellement inférieurs à ceux de la recherche médicale, et les
marchés potentiels proportionnellement plus importants. Par exemple, alors que
la valeur du riz produit en Inde seule excède celle du marché du maïs aux
Etats-Unis, c’est jusqu’à présent une culture dont la sélection a été réservée
au secteur public national ou international (principalement le GCRAI). Depuis
lors, le secteur privé s’intéresse de plus en plus à la recherche sur le riz.
Monsanto et Syngenta travaillent au séquençage du génome de deux principales
variétés de riz. Le nombre de brevets délivrés aux Etats-Unis pour le riz a
augmenté de moins de 100 par an en 1995 à plus de 600 en 2000.[199]
Jusqu’à présent, 80 % des essais
sur des cultures transgéniques ont été réalisés dans les pays développés, où
sont cultivés les trois quarts des cultures GM du monde. Les stratégies de
sélection des multinationales se sont naturellement orientées vers les besoins
des marchés du monde développé et vers les secteurs commerciaux des pays en
développement à revenu intermédiaire (par exemple, du Brésil, de l’Argentine ou
de la Chine). La mise au point de caractères génétiques, tels que la tolérance
aux herbicides, est principalement déterminée par la recherche d’un avantage
commercial, plutôt que par l’obtention de caractéristiques utiles aux
agriculteurs pauvres des pays en développement. Mais certaines entreprises sont
en train d’introduire des variétés GM qui, même si elles sont contestées à la
fois dans les pays en développement et dans les pays développés, sont
considérées par certains pays en développement comme pouvant éventuellement
leur être utiles (par exemple, le gène Bt qui confère une résistance aux
insectes).[200] Le
coton-Bt ou le maïs-Bt sont maintenant cultivés dans cinq pays en développement
au moins, et d’autres pays pourraient être intéressés s’ils parviennent à
apporter une solution aux préoccupations d’ordre écologique. Par exemple,
l’Inde a récemment approuvé la plantation de coton-Bt. Les entreprises ont
également donné des technologies utiles pour les pays en développement (par
exemple au moyen de licences sans redevances), y compris celles qui sont liées
au riz enrichi de vitamine A (Golden Rice) et au manioc. Certaines sociétés ont
publié des articles scientifiques fondés sur leurs travaux de recherche sur le
génome, qui ont été contestés parce qu’elles n’ont pas déposé les données brutes
dans les banques de données publiques. Les négociations concernant le dépôt
dans les banques de données publiques ont été compliquées par le désir des
entreprises de limiter l’accès aux composantes de ces données qui représentent
la plus grande valeur commerciale potentielle.[201]
Ainsi, il est possible que les
technologies agricoles mises au point par le secteur privé puissent entraîner
des avantages pour les secteurs commerciaux des pays en développement. Mais si
la Révolution verte, qui a été mise au point et appliquée avec le financement
du secteur public, n'est pas parvenue à atteindre effectivement les
agriculteurs pauvres vivant dans des environnements pluvieux mais divers du
point de vue agro-écologique, il est évident que la recherche liée aux biotechnologies
entreprise par le secteur privé y parviendra encore moins. C’est pourquoi le
secteur public devra entreprendre davantage de travaux de recherche
spécialement orientés vers les besoins de ces agriculteurs. En 1998, le système
du GCRAI a dépensé 25 millions de dollars pour cette recherche alors que
Monsanto a investi 1,26 milliard de dollars.[202]
Indépendamment du problème des
incitations à une recherche qui serait utile aux agriculteurs pauvres, il
semble que les brevets, et dans une certaine mesure la PVV, ont joué un rôle
dans la consolidation importante des industries mondiales des semences et des
intrants agricoles. Cette consolidation semble être déterminée par l’évolution
technologique et suivre un objectif d’intégration verticale et horizontale, de
sorte que la pertinence des investissements dans la recherche peut être
maximisée grâce à un meilleur contrôle des réseaux de distribution, notamment
ceux des intrants agricoles complémentaires (comme les herbicides).
Les entreprises cherchent à obtenir
des droits de brevet pour protéger leurs propres investissements dans la
recherche et pour empêcher que d’autres portent atteinte à leurs droits. Mais
il s’ensuit que les droits de brevet des uns peuvent empêcher la recherche des
autres. Par exemple, il existe plusieurs centaines de droits de brevet qui se
chevauchent pour la technologie Bt et au moins quatre sociétés ont obtenu des
brevets qui concernent le maïs-Bt.[203]
Récemment, Syngenta a entamé deux procès aux Etats-Unis contre plusieurs
concurrents au motif qu’ils portent atteinte à plusieurs de ses brevets
relatifs à cette technologie, bien que les entreprises en question utilisent
ces technologies et vendent des semences les incorporant depuis plusieurs
années.[204] La
concession réciproque de licences[205],
ou des alliances stratégiques, peuvent également être utilisées comme
mécanismes pour répondre aux problèmes de brevets qui entrent en conflit,[206]
mais les fusions ou acquisitions pourraient bien être le moyen le plus efficace
d’obtenir la liberté d’utiliser les technologies en question dans un domaine de
recherche particulier. Toutes ces démarches, et pas seulement cette dernière,
réduisent la concurrence. Et les grandes sociétés agrochimiques
multinationales, du fait du contrôle croissant qu’elles exercent sur des
technologies essentielles assorties de droits exclusifs, représentent également
un obstacle insurmontable à l’entrée de nouvelles entreprises innovantes.[207]
Dans les années 80, le secteur universitaire et public représentait 50 % de la
totalité des brevets américains délivrés à propos du Bt. En 1994, les
entreprises indépendantes et les particuliers en détenaient 77 % dans le
domaine de la biotechnologie, mais en 1999 les six grandes sociétés (qui ne
furent plus que cinq avec la fusion des branches agricoles de AstraZeneca et
Novartis pour former Syngenta) en détenaient 67 %. De plus, le contrôle
croissant de ces sociétés a été prouvé par le fait que 75 % de leurs brevets
relatifs au Bt en 1999 ont été obtenus par l’acquisition de petites entreprises
biotechnologiques et semencières.[208]
Dans les pays en développement,
on a décelé de semblables tendances, avec un processus extrêmement rapide de
fusion et acquisition par les multinationales. Par exemple, au Brésil, à la
suite de l’introduction de la protection des variétés végétales en 1997 (mais
probablement aussi en raison de la permission attendue de cultiver des cultures
GM), Monsanto a augmenté sa part du marché des semences de maïs de 0 % à 60 %
entre 1997 et 1999. Cette société a acquis trois entreprises locales (y compris
Cargill à l’issue d’un accord international), alors que Dow et Agrevo
(maintenant Aventis) augmentaient également leur part de marché par
acquisition. Il n’est resté qu’une seule entreprise brésilienne ne possédant
qu’une part de marché de 5 %.[209] Cette tendance semble répandue dans les pays
en développement.[210]
Ainsi, la rapidité de
concentration dans ce secteur soulève de graves questions en matière de
concurrence. La sécurité alimentaire risque d'être sérieusement menacée si les
technologies sont fournies à des prix trop élevés excluant les petits
agriculteurs, ou si aucune autre source de nouvelles technologies n’existe,
notamment en provenance du secteur public. De plus, cette concentration accrue
et les revendications de brevet, qui entrent en conflit lorsque les secteurs
tant public que privé ont fait breveter des technologies végétales, pourraient
ralentir les travaux de recherche. Dans le secteur privé, la réaction a été de
nouer des alliances ou de faire des acquisitions, mais dans le secteur public,
il s’agit de savoir comment avoir accès aux technologies dont on a besoin pour
entreprendre des recherches sans porter atteinte aux DPI et, si de nouvelles
technologies sont mises au point, à quelle condition elles pourraient être
mises à disposition. Une récente étude publiée par le ministère de
l’Agriculture américain conclut que « on ne peut pas dire à coup sûr
si le régime actuel de propriété intellectuelle stimule ou entrave la
recherche ».[211]
Nous aborderons ce sujet à nouveau au Chapitre 6.
Conclusion
Par conséquent, les pays en
développement ont peut-être trois options pour s’acquitter de leur obligation
de protéger les variétés végétales en vertu de l’Accord sur les ADPIC. Ils
peuvent adopter une ou plusieurs des possibilités suivantes :
·
Une législation de type UPOV fondée sur
la Convention de 1978 ou de 1991 (bien que maintenant ils ne puissent adhérer
qu’à la Convention de 1991)
·
Une autre forme de système sui generis, incluant ou non les
variétés de pays
·
Des brevets délivrés pour des variétés
végétales.
Nos réserves concernant l'impact
possible des brevets ne s’appliquent pas seulement aux brevets sur les variétés
végétales, mais aussi aux végétaux et aux animaux en général. A l’heure
actuelle, il ne semble guère que la protection par brevet des inventions liées
à la biotechnologie serve vraiment les intérêts de la majorité des pays en
développement n’ayant pas ou guère de capacités dans ce domaine. Par
conséquent, nous voudrions recommander d’utiliser au maximum les possibilités
offertes par l’Accord sur les ADPIC concernant l’exclusion de ces inventions de
la protection par brevet. Même dans les cas où l’Accord sur les ADPIC stipule
qu’une protection par brevet doit être fournie, par exemple en ce qui concerne
les micro-organismes, les pays en développement ont la possibilité de
restreindre la portée de la protection. En particulier, en l’absence de toute
définition reconnue de manière universelle de ce qui constitue un
« micro-organisme », les pays en développement restent libres
d’adopter une définition crédible qui limite la gamme de matériel couvert.[212]
Etant
donné que les brevets peuvent imposer des restrictions à l'utilisation des
semences par les agriculteurs et les chercheurs, les pays en développement ne devraient
en principe pas délivrer de brevets sur les végétaux et les animaux, ce que
permet l’article 27.3 b) de l’Accord sur les ADPIC. Ils devraient plutôt
envisager différentes formes de systèmes sui
generis pour les variétés végétales.
Les
pays en développement aux capacités technologiques limitées devraient
restreindre l’application des brevets en biotechnologie agricole, selon des
modalités compatibles avec l’Accord sur les ADPIC, et adopter une définition
restrictive du terme « micro-organisme ».
Les pays qui ont déjà, ou désirent développer, des
industries liées aux biotechnologies souhaiteront sans doute offrir une
protection par brevet dans ce domaine. Dans ce cas, ils devraient établir
néanmoins des exceptions spécifiques aux droits exclusifs pour ce qui concerne
la sélection végétale et la recherche. Il faut en outre examiner dans quelle
mesure les droits de brevet s’appliquent au produit de la reproduction ou de la
multiplication de l’invention brevetée, et prévoir une exception très explicite
afin que les agriculteurs puissent réutiliser les semences.
Le
réexamen de l’article 27.3 b) de l’Accord sur les ADPIC actuellement en cours
devrait préserver le droit des pays de ne pas délivrer de brevets sur les
végétaux et les animaux, y compris les gènes et les végétaux et animaux
génétiquement modifiés, ainsi que celui de mettre au point des régimes sui generis pour la protection des
variétés végétales qui conviennent à leurs systèmes agricoles. Ces régimes
devraient permettre l’accès aux variétés protégées pour la recherche ou la
sélection ultérieures et prévoir tout au moins le droit des agriculteurs à
conserver et à replanter leurs semences, y compris la possibilité de les vendre et de les
échanger de manière informelle.
En raison de la concentration croissante de
l’industrie des semences, il est important que la recherche du secteur public
en matière d'agriculture et sa composante internationale soient renforcées et
mieux financées. L’objectif devrait être de garantir que la recherche est
orientée vers les besoins des agriculteurs pauvres, que les variétés
appartenant au secteur public sont disponibles pour permettre la concurrence
avec les variétés du secteur privé et que le patrimoine des ressources
génétiques végétales mondiales est préservé. De plus, c’est un domaine dans
lequel les pays devraient envisager l’utilisation du droit de la concurrence
pour faire face au degré élevé de concentration au sein du secteur privé.
ACCES AUX
RESSOURCES PHYTOGENETIQUES ET DROITS DES AGRICULTEURS
Introduction
Comme indiqué plus haut, l’avenir de la recherche
agricole dépend beaucoup de la conservation des ressources génétiques contenues
dans les champs et dans les collections nationales et internationales, ainsi
que de la garantie de l’accès des chercheurs à des conditions qui reconnaissent
la contribution apportée par les agriculteurs dans le monde en développement
s’agissant de la conservation, de l’amélioration et de la disponibilité de ces
ressources.
L’action internationale visant à garantir la
conservation, l’utilisation et la disponibilité des ressources phytogénétiques
est fondée sur l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques de
la FAO, adopté en 1983. Par la suite, le concept de droits des agriculteurs[213]
s’est dégagé des débats de la FAO lorsqu’il a été reconnu qu’il existait un
déséquilibre entre les DPI accordés aux obtenteurs de variétés végétales modernes et les droits des
agriculteurs qui avaient fourni les ressources phytogénétiques à partir
desquelles ces variétés étaient principalement dérivées. Autre
préoccupation : comment concilier la mise à disposition des ressources
phytogénétiques en tant que patrimoine commun de l’humanité et l'octroi de DPI
privés sur des variétés qui en proviennent ?
En 1989, la FAO a reconnu ces problèmes en
incorporant dans l’Engagement les droits des agriculteurs, c’est-à-dire les
droits « que confèrent aux agriculteurs et en particulier à ceux des
centres d’origine et de diversité des ressources phytogénétiques, leurs
contributions passées, présentes et futures à la conservation, à l’amélioration
et à la disponibilité de ces ressources ».[214]
Les droits des agriculteurs devaient être exercés par l’intermédiaire d'un
Fonds international pour les ressources phytogénétiques, qui financerait les
activités pertinentes, notamment dans les pays en développement. Par la suite,
la FAO a convenu que « les droits des obtenteurs tels qu’ils sont reconnus
par l’UPOV ... ne sont pas incompatibles avec l’Engagement
international », choix de mots qui traduisait l’ambivalence ressentie par
certains pays en développement concernant la logique existant entre
l’Engagement et l’UPOV.[215]
A la suite de l'adoption de la CDB en 1992, c’est
sur cette base qu’a été entrepris le processus de transformation de l’Engagement
en Traité (ITPGRFA), finalement convenu en 2001.[216]
Le Traité ITPGRFA a pour objectif spécifique de faciliter l’accès aux
ressources phytogénétiques détenues par les parties contractantes et à celles
des collections internationales, pour le bien commun, reconnaissant qu’elles
constituent une matière première indispensable à l’amélioration génétique des
plantes cultivées et que de nombreux pays dépendent de ressources génétiques
venant d'ailleurs. Ceci constitue une application des principes de la CDB, compte
tenu des caractéristiques particulières des ressources phytogénétiques. La
plupart des variétés existantes actuellement, notamment celles qui sont
dérivées des programmes de sélection publics, contiennent un matériel génétique
provenant de nombreuses sources, souvent dérivées d’un matériel génétique issu
des banques de gènes, qui elles-mêmes peuvent provenir de diverses origines.
Le Traité ITPGRFA reconnaît également la
contribution des agriculteurs à la conservation, l’amélioration et la mise à disposition
de ces ressources, et que cette contribution est le fondement des droits des
agriculteurs. Il ne limite sous aucune forme que ce soit les droits que peuvent
avoir les agriculteurs, en vertu de la législation nationale, de conserver,
utiliser, échanger et vendre des semences de ferme. Il précise également le
droit de participer à la prise de décisions concernant l'utilisation de ces
ressources ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages en découlant
(voir Encadré 3.2).
Droits des agriculteurs
Le Traité ITPGRFA déclare dans
son article 9.2 que la responsabilité de la réalisation des droits des
agriculteurs est du ressort des gouvernements. Ainsi, l’application de droits
spécifiques des agriculteurs n’est pas une obligation internationale, comme
celle qui est imposée par les dispositions de l’Accord sur les ADPIC.
La justification des droits des
agriculteurs associe des arguments concernant l’équité et l’économie. Les
obtenteurs de végétaux et le monde dans son ensemble tirent parti de la
conservation et de la mise en valeur des ressources phytogénétiques entreprises
par les agriculteurs, mais les agriculteurs ne sont pas récompensés pour la
valeur économique qu’ils ont ainsi apportée. Les droits des agriculteurs
peuvent être considérés comme un moyen de fournir aux agriculteurs une
motivation afin qu’ils continuent à conserver et à protéger la biodiversité.
Comme on l’a indiqué, la protection des variétés végétales tend par sa nature
même à encourager l’homogénéité et à réduire la biodiversité, ce à quoi les
pratiques traditionnelles des agriculteurs constituent un contrepoids
essentiel. Il faudrait apporter une aide aux agriculteurs au nom de la valeur
économique qu’ils conservent, qui n’est pas reconnue sur le marché et qui est
dans une certaine mesure menacée par les évolutions techniques et l’extension
de la protection des obtenteurs de variétés végétales. De plus, l’extension de
la protection de la propriété intellectuelle menace vraiment de restreindre les
droits des agriculteurs à réutiliser, échanger et vendre des semences, pratique
qui constitue la base de leur rôle traditionnel en matière de conservation et de mise en valeur.
Encadré 3.2 Droits des
agriculteurs inscrits dans le Traité ITPGRFA (Article 9)
9.1 Les Parties contractantes reconnaissent l’énorme
contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les
agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres
d’origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continuent
d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources
phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et
agricole dans le monde entier.
9.2 Les Parties contractantes conviennent que la
responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs, pour ce qui est
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, est du
ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités, chaque
Partie contractante devrait, selon qu’il convient, et sous réserve de la
législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les
Droits des agriculteurs, y compris :
(a) la protection
des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
(b) le droit de
participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
(c) le droit de
participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions
relatives à la conservation et à l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
9.3 Rien dans cet Article ne devra être interprété comme limitant les
droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger
et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous
réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu’il convient.
Les droits des agriculteurs ne constituent pas un
droit de propriété intellectuelle, mais doivent être considérés comme un
contrepoids important aux droits accordés aux obtenteurs dans le secteur
officiel au titre de la PVV ou des brevets. Toutefois, les moyens permettant
d’appliquer ces droits au niveau national sont complexes, comme nous
l’examinons dans le prochain chapitre à propos de la CDB. Le Traité prévoit la
mise en place d’une stratégie de financement alimentée par des contributions et
par la part des ressources tirées de la commercialisation, ce qui permettra la
mise en œuvre des plans et programmes convenus pour les agriculteurs « qui
conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture ».[217]
Système multilatéral
En vertu du Traité, les pays ont
convenu de faciliter l’accès aux ressources phytogénétiques énumérées sur une
liste convenue de cultures figurant en annexe, et qui sont importantes pour la
sécurité alimentaire. En signant ce Traité, les gouvernements conviennent
d’incorporer les ressources directement contrôlées par eux dans le
« Système multilatéral ». Ils encourageront également les
institutions qui ne relèvent pas directement de leur juridiction à faire de
même. Ce qui est particulièrement important, c’est la grande collection de
matériel génétique intéressant les pays en développement qui est sous l'égide
du GCRAI, mais il y a bien sûr de nombreuses collections nationales
d’importance mondiale dans les pays développés comme dans les pays en
développement, ainsi que les réserves de diversité génétique dans les champs
des agriculteurs.
En ce qui
concerne les DPI, la partie éventuellement discutable de ce Traité porte sur la
protection des ressources auxquelles il est possible d’avoir accès grâce au
Système multilatéral. Il a été finalement convenu, comme le stipule le Traité,
que :
« Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit
de propriété intellectuelle ou autre droit limitant l’accès facilité aux
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou à leurs
parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système
multilatéral ; »[218]
Inévitablement, ce texte
constitue un compromis diplomatique, traduisant le désir de nombreux pays en
développement d’éviter toute limitation de l’accès qui serait imposée par la
délivrance de DPI, et celui de certains pays développés de permettre la
délivrance de brevets sur le matériel génétique conformément aux critères
existants appliqués au niveau national. Les mots cruciaux « sous la forme
reçue » signifient que le matériel reçu ne peut pas être breveté en tant que tel, mais ils permettent que
des brevets soient délivrés pour des modifications (quelle qu’en soit la
définition) de ce matériel.
Le libellé de
ce compromis exclut bien évidemment la délivrance de brevets pour des semences
obtenues d’une banque de semences. Mais la mesure dans laquelle il est possible
d’octroyer des brevets pour un gène isolé à partir de ce matériel est loin de
faire l’unanimité. Pendant la négociation de ce Traité, certains pays estimaient
que cet article devait être interprété comme excluant l’octroi de tels brevets.
D’autres estimaient que la forme isolée d’un gène (pour lequel une fonction a
également été déterminée) est différente de « la forme reçue » et,
par conséquent, devrait être brevetable. Ainsi, ce libellé soulève la question
d’ordre général importante, à savoir quelles sont les règles qui conviennent
pour la délivrance de brevets sur un matériel génétique, tant pour les pays
développés que pour les pays en développement. Il faut pour y répondre prendre
en compte la nature de l’activité inventive nécessaire pour la délivrance du
brevet, la nature des revendications pour l’utilisation inventée de ce matériel
et la mesure dans laquelle ces revendications pourraient limiter l’utilisation
du matériel génétique servant de support. Nous examinerons ceci plus en détail
au Chapitre 6.
Ce Traité a également établi un
principe important selon lequel tout utilisateur de matériel doit signer un
accord type de transfert de matériel (ATM),[219]
devant être adopté par l’Organe directeur du Traité, qui comprendra les
conditions d’accès convenues dans le Traité (article 12.3) et prévoira le
partage des avantages des produits de toute commercialisation provenant du
matériel par l’intermédiaire d’un fonds créé conformément aux dispositions du
Traité. Ceci va bien au-delà des dispositions de la CDB en suggérant un
mécanisme concret pour le partage des avantages, fondé sur des arrangements
multilatéraux plutôt que bilatéraux.
Les
pays développés et les pays en développement devraient accélérer le processus
de ratification du Traité international de la FAO sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Ils devraient
notamment appliquer les dispositions du
Traité concernant :
·
le
non-octroi des DPI sur tout matériel transféré dans le cadre du système
multilatéral, sous la forme reçue
·
la
mise en œuvre au niveau national de mesures visant à promouvoir les droits des
agriculteurs, y compris a) la protection des savoirs traditionnels relatifs aux
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; b) le droit
de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation
des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; c)
le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les
questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Chapitre 4
SAVOIRS TRADITIONNELS ET
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
INTRODUCTION
Les communautés humaines ont
toujours produit, affiné et transmis leurs connaissances de génération en
génération. Ces « savoirs traditionnels »[220]
constituent souvent un élément important de leur identité culturelle. Les
savoirs traditionnels ont joué, et jouent encore, un rôle vital dans la vie
quotidienne de la grande majorité des gens. Ils sont en effet essentiels à la
sécurité alimentaire et à la santé de millions de personnes dans le monde en
développement. Dans de nombreux pays, les médecines traditionnelles constituent
les seuls soins abordables à la disposition des pauvres. Dans les pays en
développement, jusqu’à 80 % de la population dépend des médecines
traditionnelles pour répondre à ses besoins en matière de santé.[221]
En outre, la connaissance des propriétés médicinales des plantes est à
l’origine de nombreux médicaments modernes. Comme nous l’avons observé au
Chapitre 3, l’emploi et le développement constant de variétés végétales par les
agriculteurs locaux, et le partage et la diffusion de ces variétés ainsi que
des savoirs qui y sont associés, jouent un rôle essentiel dans les systèmes
agricoles des pays en développement.
Ce n’est toutefois que récemment que la communauté
internationale a cherché à reconnaître et à protéger les savoirs traditionnels.
En 1981, l’OMPI et l’UNESCO ont adopté une loi type sur le folklore. En 1989,
le concept de droits des agriculteurs a été introduit par la FAO dans son
Engagement international sur les ressources phytogénétiques et, en 1992, la
Convention sur la diversité biologique (CDB) a mis en avant la nécessité de
promouvoir et de conserver les savoirs traditionnels.[222]
En dépit de ces efforts couvrant deux décennies, aucune solution définitive et
acceptable pour tous n’a encore vu le jour pour protéger et promouvoir les
savoirs traditionnels.
La CDB pose également des principes régissant l’accès aux
ressources génétiques et aux savoirs qui y sont associés, ainsi que le partage
des avantages découlant de cet accès. Nous étudions donc les relations entre le
système de PI et les principes d’accès et de partage des avantages de la CDB,
dans le cadre des savoirs, traditionnels ou autres, et des ressources
génétiques.
Nous examinons aussi ici, bien qu’il s’agisse pour une
grande part d’un sujet distinct, si les indications géographiques (IG) ont un
rôle à jouer dans la promotion du développement. A ce sujet, nous abordons
également les questions qui intéressent les pays en développement dans les
débats actuels du Conseil des ADPIC.
Ainsi, dans le présent
chapitre, nous examinons les questions suivantes :
·
Quelle est la
nature des savoirs traditionnels et du folklore et qu’entend-on par leur
protection ?
·
Comment le système
de PI existant peut-il être utilisé pour protéger et promouvoir les savoirs
traditionnels ?
·
Quelles
modifications du système de PI pourraient améliorer la protection ?
·
Comment le système
de PI peut-il appuyer les principes d’accès et de partage des avantages
consacrés dans la CDB ?
·
La protection des
indications géographiques est-elle importante pour les pays en
développement ?
SAVOIRS TRADITIONNELS
Contexte
Plusieurs affaires portant sur
les savoirs traditionnels ont attiré l’attention de la communauté
internationale. Par conséquent, la question des savoirs traditionnels a pris le
devant de la scène dans le débat général entourant la propriété intellectuelle.
Ces affaires impliquent ce que l’on appelle fréquemment la
« biopiraterie » (voir Encadrés 4.1 et 4.2). Les exemples du curcuma,
du margousier et de l’ayahuasca illustrent les problèmes que peut poser
l’octroi d’une protection par brevet aux inventions relatives aux savoirs
traditionnels tombés dans le domaine public. Dans ces affaires, des brevets
nuls ont été délivrés car les examinateurs des brevets n’avaient pas connaissance
des savoirs traditionnels concernés. Dans un autre exemple, un brevet a été
accordé sur une espèce végétale appelée hoodia. Là, la question n’était pas de
savoir si le brevet devait être accordé ou non, mais plutôt si la population
locale, appelée San, qui avait développé le savoir traditionnel sous-tendant
l’invention, était en droit de recevoir une juste part des avantages issus de
la commercialisation.
Encadré
4.1 Biopiraterie
Il n’existe aucune définition officielle de la
« biopiraterie ». Le Groupe d'action sur l'érosion, la technologie et
la concentration (Groupe ETC) la définit comme « l’appropriation des
savoirs et des ressources génétiques des communautés agricoles et autochtones
par des personnes ou des institutions visant à obtenir un contrôle
monopolistique exclusif (généralement par le biais de brevets ou de droits
d'obtention végétale) sur ces ressources et savoirs ».
Les actions suivantes ont été décrites comme des actes de
« biopiraterie » :
a) La
délivrance de « mauvais » brevets. Il s’agit de brevets délivrés pour des inventions qui ne
sont pas nouvelles ou inventives eu égard aux savoirs traditionnels tombés dans
le domaine public. Ces brevets peuvent être délivrés en raison d’omissions lors
de l’examen du brevet ou simplement parce que les examinateurs des brevets
n’avaient pas accès aux savoirs. Ce second cas de figure se présente lorsque
les savoirs sont écrits mais inaccessibles à l’aide des outils à la disposition
des examinateurs, ou lorsqu’il s’agit de savoirs non écrits. Une initiative
lancée par l’OMPI, visant à répertorier et classer les savoirs traditionnels,
cherche à résoudre une partie de ces problèmes.
b) La
délivrance de « bons » brevets. Il est possible que des brevets soient délivrés
régulièrement, conformément au droit national, pour des inventions dérivées des
savoirs traditionnels d’une communauté ou de ses ressources génétiques. On
pourrait avancer que la délivrance de tels brevets constitue un acte de
« biopiraterie » pour les raisons suivantes :
·
Les
normes en matière de brevets sont insuffisantes. Par exemple, des brevets sont
autorisés pour des inventions qui ne sont guère plus que des découvertes. Ou
bien, le régime national des brevets (comme aux Etats-Unis, par exemple) peut
ne pas reconnaître certaines formes de divulgation publique des savoirs
traditionnels comme faisant partie de l’état de la technique.[223]
·
Même
si le brevet représente une réelle invention, quelle qu’en soit la définition,
il est possible qu’aucune disposition n’ait été prise pour obtenir le
consentement préalable donné en connaissance de cause[224] des membres des
communautés fournissant le savoir ou la ressource, ni pour partager les
avantages de la commercialisation afin de rémunérer ces personnes en
conséquence, conformément aux principes de la CDB.
Encadré
4.2 Affaires controversées portant sur des brevets et impliquant des savoirs
traditionnels et des ressources génétiques
Curcuma
Le curcuma (Curcuma
longa) est un végétal de la famille du gingembre produisant des rhizomes
couleur safran, utilisés comme une épice pour aromatiser la cuisine indienne.
Il possède également des propriétés qui en font un ingrédient efficace de
médicaments, de produits cosmétiques ou encore de teintures colorées. A titre
thérapeutique, il sert généralement à soigner les blessures et les érythèmes.
·
En
1995, deux ressortissants indiens du centre médical de l’Université du
Mississippi ont obtenu le brevet américain numéro 5.401.504 pour
« l’utilisation du curcuma pour soigner des blessures ».
·
Le
Conseil indien de la recherche scientifique et industrielle (Council of Scientific and Industrial
Research - CSIR) a demandé à l’Office des brevets et des marques des
Etats-Unis (US Patent and Trademark
Office - USPTO) le réexamen du brevet.
·
Le
CSIR alléguait que le curcuma était utilisé depuis des milliers d’années pour
soigner les blessures et les érythèmes et que son usage médicinal n’était donc
pas nouveau.
·
Cette
revendication était appuyée par des preuves écrites du savoir traditionnel,
dont un texte ancien en sanskrit et un article publié en 1953 dans le journal
de l’Association médicale indienne.
·
Malgré
les arguments des titulaires du brevet, l'USPTO a admis les objections du CSIR
et a révoqué le brevet.
Observations : L’affaire du curcuma a
eu du retentissement car c’était la première fois que la contestation d’un
brevet fondé sur les savoirs traditionnels d’un pays en développement était
retenue. Les frais de justice encourus par l’Inde dans cette affaire, tels que
calculés par le gouvernement indien, s’élèvent à 10 000 dollars
environ.
Margousier
Le margousier (Azadirachta
indica) est un arbre originaire de l’Inde et d’autres parties de l’Asie du
Sud et du Sud-Est. Il est maintenant cultivé dans les tropiques en raison de
ses propriétés en tant que médicament, pesticide et engrais naturel. Les
extraits de margousier peuvent être utilisés pour lutter contre des centaines
d’animaux nuisibles et de mycoses qui attaquent les cultures alimentaires.
L’huile extraite de ses graines est employée dans le traitement du rhume et de
la grippe et, mélangée au savon, elle apporterait un soulagement à bon prix
dans les cas de paludisme, de maladie de peau et même de méningite.
·
En 1994, l’OEB a délivré le brevet européen numéro
EP0436257 à la société américaine W.R. Grace et au ministère de l’Agriculture
des Etats-Unis (US Department of
Agriculture - USDA) pour une « méthode pour combattre les
champignons aux plants avec l'huile
de margousier extraite hydrophobément ».
·
En
1995, un groupe d’ONG internationales et de représentants d’agriculteurs
indiens a déposé une opposition en justice contre ce brevet.
·
Ce
groupe a présenté des preuves que l’effet fongicide des extraits de graines de
margousier était connu et utilisé depuis des siècles dans l’agriculture
indienne pour protéger les cultures, et que l’invention alléguée dans la
demande EP0436257 n’était donc pas nouvelle.
·
En
1999, l’OEB a jugé que, sur le fondement des preuves, « tous les éléments
de la présente revendication avaient été communiqués au public avant la demande
de brevet … et [le brevet] est donc réputé n’impliquer aucune activité
inventive ».
·
Le
brevet a été révoqué par l’OEB en 2000.
Ayahuasca
Depuis plusieurs générations, les shamans de tribus
autochtones du bassin amazonien traitent l’écorce de Banisteriopsis caapi pour produire une boisson cérémonielle appelée
« ayahuasca ». Les shamans utilisent l’ayahuasca (littéralement,
« vin de l’âme ») lors de cérémonies religieuses et curatives pour
diagnostiquer et traiter des maladies, rencontrer les esprits et prédire
l’avenir.
Un Américain, Loren Miller, a obtenu le brevet de plante
américain numéro 5.751 en juin 1986, lui octroyant des droits sur une prétendue
variété de Banisteriopsis caapi qu’il
avait appelée « Da Vine ». La description du brevet précisait que la
« plante a été découverte poussant dans un jardin privé de la forêt
ombrophile amazonienne d’Amérique du Sud ». Le titulaire du brevet
alléguait que Da Vine constituait une variété nouvelle et distincte de Banisteriopsis caapi, en raison principalement
de la couleur de ses fleurs.
La Coordination des organisations autochtones du bassin de
l'Amazone (Coordinating Body of
Indigenous Organizations of the Amazon Basin - COICA), organe de
coordination représentant plus de 400 groupes autochtones, a appris
l’existence du brevet en 1994. Pour le compte de la COICA, le Centre pour
les lois internationales de l'environnement (Center for International Environmental Law - CIEL) a déposé
une demande de réexamen relative au brevet. Le CIEL avançait qu’une étude de
l’état de la technique avait révélé que Da Vine n’était ni nouvelle ni
distincte. Il a également allégué que la délivrance du brevet était contraire
aux aspects publics et moraux de la loi américaine sur les brevets en raison du
caractère sacré de Banisteriopsis caapi
dans l’ensemble de la région amazonienne. Le CIEL a présenté de nombreuses
nouvelles preuves de l’état de la technique et, en novembre 1999, l'USPTO a
rejeté la revendication du brevet, admettant que Da Vine ne pouvait pas être
distinguée de l’état de la technique présenté par le CIEL et que, par
conséquent, le brevet n’aurait jamais dû être délivré. Toutefois, de nouveaux
arguments du titulaire du brevet ont persuadé l'USPTO de revenir sur sa
décision et d’annoncer début 2001 que le brevet était valable.
Observations : En raison de la date de dépôt du
brevet, celui-ci n’était pas couvert par les nouvelles règles des Etats-Unis
relatives au réexamen entre les parties. Le CIEL ne pouvait donc pas apporter
de commentaires sur les arguments avancés par le titulaire du brevet, arguments
qui ont conduit à la confirmation du brevet.
Cactus hoodia
Les San, qui vivent dans la région du désert de Kalahari en
Afrique australe, consomment traditionnellement le cactus hoodia pour apaiser
leur faim et leur soif lors de longues expéditions de chasse. En 1937, un
anthropologue néerlandais qui étudiait les San a observé cette utilisation du
hoodia. Ce n’est que récemment que les scientifiques du Conseil sud-africain de
la recherche scientifique et industrielle (South
African Council for Scientific and Industrial Research - CSIR) ont
découvert son rapport et commencé à étudier cette plante.
En 1995, le CSIR a fait breveter l’élément anorexigène du
hoodia (P57). En 1997, il a accordé une licence sur le P57
à une société britannique de biotechnologie, Phytopharm. En 1998, la
société de produits pharmaceutiques Pfizer a acquis les droits de développement
et de commercialisation du
P57, en tant que produit amincissant potentiel et de
traitement éventuel de l'obésité (marché d'une valeur de plus de 6 milliards de
livres sterling), auprès de Phytopharm pour un total de 32 millions de
dollars en redevances et paiements d’étape.
Ayant appris l’exploitation possible de leur savoir
traditionnel, les San ont menacé d ‘engager une action en justice contre
le CSIR au motif de « biopiraterie ». Ils alléguaient que leur savoir
traditionnel leur avait été dérobé et que le CSIR
n’avait pas respecté les règles de la Convention sur la diversité biologique,
qui exigent le consentement préalable donné en connaissance de cause de toutes
les parties prenantes, dont les découvreurs et utilisateurs d’origine.
Phytopharm a procédé à des enquêtes approfondies, mais n’a
trouvé aucun « détenteur du savoir ». A l’époque, les San encore en
existence vivaient apparemment dans un village de toile à 2 400 km des terres
de leur tribu. Le CSIR a allégué qu’il avait prévu
d’informer les San de ses recherches et d’en partager les avantages,
mais qu’il voulait auparavant s’assurer que le médicament se révélait efficace.
En mars 2002, Le CSIR et les San sont parvenus à un accord,
selon lequel les San, reconnus en tant que dépositaires du savoir traditionnel
associé au végétal hoodia, recevront une part des redevances futures
éventuelles. Bien qu’il soit probable que les San ne reçoivent qu’un
pourcentage minime des ventes futures, la taille potentielle du marché signifie
que la somme concernée pourrait rester substantielle. Il est peu probable que
le médicament sera commercialisé avant 2006 et risque encore d’échouer au stade
des essais cliniques.
Observations : Cette affaire semblerait démontrer qu’avec la bonne volonté de toutes
les parties, il est possible de parvenir à des accords acceptables pour tous
concernant l’accès et le partage des avantages. L’importance de la propriété
intellectuelle dans l’obtention d’avantages futurs semble avoir été reconnue
par toutes les parties, y compris les San.
Grâce, en partie, à ces affaires
célèbres, de nombreux pays en développement, détenteurs de savoirs
traditionnels, et des organisations militantes font pression dans un grand
nombre de forums pour l’obtention d’une meilleure protection des savoirs
traditionnels. Ces pressions ont conduit, par exemple, à la création d’un
Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux
ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore au sein de
l’OMPI. La protection des savoirs traditionnels et du folklore fait également
l’objet de discussions dans le cadre de la CDB et d’autres organisations
internationales comme la CNUCED, l'OMS, la FAO et l’UNESCO.[225]
En outre, la Déclaration ministérielle de Doha de l’OMC a mis en avant la
nécessité de poursuivre les travaux sur la protection des savoirs traditionnels
dans le cadre du Conseil des ADPIC.[226]
Nature des savoirs traditionnels
et objectif de la protection
Comment peut-on définir les
savoirs traditionnels ? Si la grande majorité des savoirs sont anciens,
dans le sens où ils se sont transmis de génération en génération, ils sont toutefois
constamment affinés et de nouveaux savoirs sont développés en permanence, de
manière assez comparable au processus scientifique moderne qui avance par
amélioration progressive permanente plutôt que par grands bonds en avant. L’un
des intervenants de notre conférence a suggéré que le terme
« folklore » soit remplacé par « expressions de la
culture », qui convient mieux et représente les traditions vivantes et
fonctionnelles, plutôt que des souvenirs du passé. Si la majorité des savoirs
traditionnels et du folklore est transmise oralement, une partie d’entre eux,
comme la conception textile et le savoir médical ayurveda, est codifiée. Les
groupes qui détiennent des savoirs traditionnels sont très divers : les
dépositaires peuvent être des individus ou des groupes d’individus ou de
communautés. Ces communautés peuvent être des peuples autochtones ou des
descendants de colons ultérieurs. La nature des savoirs est également très
diverse : elle couvre, par exemple, les œuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques, les chants, les danses, les traitements et pratiques médicaux,
et les technologies et techniques agricoles.
Si plusieurs définitions ont été
avancées pour les savoirs traditionnels et le folklore, il n’existe aucune
définition générale acceptable pour les uns ou pour l’autre. Ce n’est pas
uniquement l’étendue des savoirs traditionnels qui a compliqué le débat
jusqu’ici. En effet, il existe aussi une certaine confusion quant à ce que l’on
entend réellement par « protection » et à son objectif. Celle-ci ne
devrait certainement pas être directement associée au mot
« protection » au sens de la PI. Dans son rapport sur une série de
missions d’enquête, l’OMPI[227]
a cherché à résumer les préoccupations des détenteurs de savoirs traditionnels,
de la manière suivante :
·
Préoccupations concernant la
disparition des modes de vie traditionnels et des savoirs traditionnels, et
réticence des plus jeunes membres des communautés à poursuivre les pratiques
traditionnelles
·
Préoccupations concernant le manque de
respect pour les savoirs traditionnels et les détenteurs de savoirs
traditionnels
·
Préoccupations concernant l’utilisation
illicite des savoirs traditionnels, y compris l’utilisation des savoirs
traditionnels sans partage des avantages ou de manière dégradante
·
Reconnaissance insuffisante de la
nécessité de protéger et de promouvoir la poursuite de l’utilisation des
savoirs traditionnels.
Une autre source a classé ces
motifs de protection des savoirs traditionnels, ainsi que d’autres, de la
manière suivante :
·
Question d’équité – les dépositaires
des savoirs traditionnels doivent recevoir une rémunération équitable si les
savoirs traditionnels conduisent à un profit commercial
·
Préoccupations relatives à la
conservation – la protection des savoirs traditionnels contribue à l’objectif
plus large de conservation de l’environnement, de la biodiversité et des
pratiques agricoles durables
·
Préservation des pratiques
traditionnelles et de la culture – la protection des savoirs traditionnels
servirait à accroître la notoriété des savoirs et des personnes à qui ils sont
confiés, à l’intérieur et à l’extérieur des communautés
·
Prévention de l’appropriation par des
parties non autorisées ou de la « biopiraterie »
·
Promotion de leur utilité et de leur
importance pour le développement.[228]
On ne peut pas s’attendre à ce
qu’une solution unique puisse apaiser des inquiétudes et atteindre des
objectifs si nombreux et divers. Il est possible que les mesures requises pour
empêcher l’appropriation illicite soient tout à fait différentes de celles qui
seront nécessaires pour encourager une utilisation plus répandue des savoirs
traditionnels, voire incompatibles avec ces dernières. Une multitude de mesures
complémentaires sera presque certainement nécessaire, dont un grand nombre
sortiront du champ de la propriété intellectuelle. En effet, une question bien
plus large sous-tend peut-être ce débat, comme la situation des communautés
indigènes au sein de l’économie générale et de la société du pays dans lequel
elles se trouvent, ainsi que leur accès aux terres sur lesquelles elles vivent
depuis toujours ou leur droit de les posséder. En ce sens, les préoccupations
relatives à la préservation des savoirs traditionnels et au maintien du mode de
vie de ceux qui les détiennent peuvent être symptomatiques des problèmes
sous-jacents auxquels sont confrontées ces communautés face aux pressions
externes.
Toutefois, nous
entendons limiter notre étude à la manière dont le système de propriété
intellectuelle peut contribuer à répondre à ces préoccupations. Il a déjà coulé
beaucoup d’encre à ce sujet et nombre d’organisations internationales, l’OMPI
notamment, ont commencé à envisager la question de savoir si le système de
propriété intellectuelle existant a un rôle à jouer ou si de nouvelles formes
de protection sont nécessaires.
Gestion du débat sur les savoirs
traditionnels
Comme nous l’avons observé
ci-dessus, un grand nombre d’organisations, dont l’OMPI, la CDB, la CNUCED et
l’OMC, débattent de la protection des savoirs traditionnels. Ces débats se sont
concentrés à juste titre sur la compréhension de cette question, plutôt que sur
l’élaboration de normes internationales. Ce n’est qu’avec une meilleure
compréhension et une plus grande expérience pratique au niveau national ou
régional qu’il sera possible de concevoir un système international de
protection des savoirs traditionnels. Il est essentiel que tous les organismes
qui se penchent sur cette question collaborent afin d’éviter une double emploi
inutile et d’assurer que le débat englobe autant de points de vue différents
que possible. A cet égard, il nous a été suggéré qu’une organisation comme
l’OMPI, qui traite exclusivement de la propriété intellectuelle, pourrait ne
pas être l'instance la plus appropriée pour s’intéresser aux savoirs traditionnels
sous tous leurs aspects.[229] Nous estimons
toutefois peu probable qu’un seul organe possède la capacité, l’expertise ou
les ressources nécessaires pour aborder tous les aspects des savoirs
traditionnels. Selon nous en effet, une multitude de mesures, dont certaines
seulement se rattachent à la PI, sera nécessaire pour protéger, préserver et
promouvoir les savoirs traditionnels.
A
ce stade précoce du débat, il y a tout avantage à ce que cette question soit
examinée au sein d'un certain nombre instances, tout en veillant à mettre au
point des démarches cohérentes et à éviter les doubles emplois.
Utilisation
du système de PI existant pour protéger et promouvoir les savoirs traditionnels
On voit
apparaître des exemples illustrant la manière dont le système actuel de PI peut
être utilisé pour commercialiser les savoirs traditionnels ou empêcher leur
utilisation illicite. Ainsi, des artistes aborigènes et de l’île de Torres
Strait en Australie ont obtenu une marque nationale de certification.[230] Comme tout autre marque,
cette marque de certification ou label d’authenticité (Label of Authenticity) entend contribuer à la promotion de la
commercialisation de leur produits artistiques et culturels et prévenir la
vente de produits prétendant à tort être d’origine aborigène.
Dans des
enquêtes récentes sur la protection existante des savoirs traditionnels et du
folklore, plusieurs pays ont proposé d’autres exemples de la manière dont les
outils de PI ont été utilisés pour promouvoir et protéger les savoirs
traditionnels et le folklore.[231] Parmi ces exemples, on
compte la protection par voie de droit d'auteur au Canada, visant à protéger
les créations fondées sur la tradition, dont les masques, les mâts totémiques
et les enregistrements sonores des artistes aborigènes ; l’emploi des
dessins et modèles industriels pour protéger l’apparence extérieure d’articles
comme les chapeaux et tapis au Kazakhstan ; et l’utilisation d’indications
géographiques pour protéger les produits traditionnels, comme les liqueurs, les
sauces et les thés au Venezuela et au Vietnam.
Leur capacité à
prolonger indéfiniment la vie des marques de fabrique ou de commerce et la
possibilité de leur propriété collective suggèrent que ces droits puissent
particulièrement convenir à la protection des savoirs traditionnels. C’est
également le cas des indications géographiques, qui peuvent être utilisées pour
protéger les produits ou artisanats traditionnels s’il est possible d’attribuer
leurs caractéristiques particulières à une origine géographique particulière.
Toutefois, les marques et les indications géographiques ne peuvent empêcher que
l’utilisation des marques ou indications protégées ; elles ne protègent
pas les savoirs en eux-mêmes, ou les technologies qui intègrent ces savoirs.
Les autres DPI,
notamment ceux qui nécessitent un élément de nouveauté ou dont la protection
est d’une durée relativement limitée, semblent moins adaptés à la protection
des savoirs traditionnels. Néanmoins, il ressort nettement de ces enquêtes,
voire d’autres études, que les DPI existants ont un rôle à jouer dans la
protection des savoirs traditionnels. Il reste à voir si ce rôle est
significatif ou non. L’expérience dans d’autres domaines suggère que leur
impact risque de ne pas être énorme, en raison notamment du coût élevé de
l’obtention et du respect des droits. Si la majorité des petites sociétés des
pays développés trouve que le système de PI, et en
particulier le système des brevets, est peu attirant,[232] il
semble alors peu probable que les communautés locales des pays en voie de
développement, ou les individus qui composent ces communautés, en tireront un
grand avantage.
Protection sui generis des savoirs traditionnels
Certains pays
ont déjà décidé que le système de PI existant n’est pas, à lui seul, suffisant
pour protéger les savoirs traditionnels. Plusieurs de ces pays ont adopté ou
sont en train d’adopter des lois instituant des systèmes de protection sui generis.[233]
Les Philippines
ont adopté une loi, et envisagent de nouvelles dispositions,[234] conférant aux communautés
autochtones des droits sur leurs savoirs traditionnels. Ces droits s’étendent
au contrôle de l’accès aux terres ancestrales, aux ressources biologiques et
génétiques et aux savoirs autochtones relatifs à ces ressources. L’accès des
tiers sera fondé sur le consentement préalable en connaissance de cause de la
communauté, obtenu conformément aux lois coutumières. Tous avantages issus des
ressources génétiques ou des savoirs associés seront partagés équitablement. La
loi cherche toutefois à maintenir le libre échange de la biodiversité entre les
communautés locales. Elle cherche également à assurer que les communautés
autochtones sont en mesure de participer à tous les niveaux du processus
décisionnel.
Si l’objectif
premier de ces actes législatifs est la reconnaissance, la protection et la
promotion des droits des communautés et des populations autochtones, y compris
les droits relatifs aux ressources biologiques et aux savoirs traditionnels
associés, ils reconnaissent également le potentiel d’exploitation de ces
ressources. Toutefois, le droit guatémaltèque cherche aussi à préserver et
promouvoir une utilisation plus large de ses savoirs traditionnels en plaçant
les expressions de la culture nationale, dont par exemple les connaissances
médicinales et la musique, sous la protection de l’État.[235] Il interdit la vente de
ces expressions ou leur rémunération. Ainsi, différents types de modèles sont
élaborés au niveau national, cherchant à adapter la législation et la pratique
aux besoins locaux.
Une question particulièrement
importante est la mesure dans laquelle les formes de protection reconnaissent
les lois coutumières sous l’empire desquelles les savoirs ont évolué. Des pays
comme le Bangladesh et des organisations comme l’Union africaine (UA)[236] envisagent une
législation sui generis qui prévoit
des droits dans le chef de la communauté sur les ressources biologiques et
savoirs traditionnels associés et cherchent à obtenir une plus grande
reconnaissance des pratiques culturelles et coutumières des communautés. Le
système de protection sui generis des
Philippines tient également compte des lois coutumières.
La Cour suprême australienne a
envisagé la pertinence des lois coutumières et pratiques aborigènes dans une
affaire d'atteinte à un droit d'auteur. Bien que la Cour ait jugé qu’elle ne
pouvait pas « reconnaître l'atteinte à des droits de propriété du type de
ceux que protège le droit aborigène pour les propriétaires traditionnels des
récits du temps du rêve et des images utilisées dans les œuvres d’art des demandeurs
à l’instance », elle a tenu compte du préjudice subi par les artistes
aborigènes dans leur environnement culturel pour déterminer les dommages et
intérêts.[237] Si
de telles décisions accordent une certaine reconnaissance aux lois coutumières,
elles ne vont visiblement pas aussi loin que certains le souhaiteraient. Dans
le cadre de nos consultations à ce sujet, plusieurs personnes ont demandé une
plus grande reconnaissance des lois coutumières.[238]
La reconnaissance des lois
coutumières, qu’elles se rapportent spécifiquement aux savoirs traditionnels ou
non, soulève des questions qui sortent du champ du présent rapport. Nous
estimons néanmoins que les lois coutumières relatives aux savoirs traditionnels
doivent être respectées et, si possible, reconnues plus largement. Il faudrait
soutenir la poursuite des travaux visant à atteindre ces objectifs, comme le
prescrit par exemple la 6e Conférence des Parties à la CDB.[239]
Il reste à voir
si ces systèmes nationaux, à mesure de leur évolution, présenteront suffisamment
de caractéristiques communes pour permettre le développement d’un système sui generis international. Nous
reconnaissons qu’il y existe des pressions constantes visant à la création d’un
système sui generis international,
ainsi que l’a récemment exprimé le G15.[240]
Etant donné la large gamme de matériel à protéger
et la diversité des raisons pour le « protéger », il se peut qu’un
seul système sui generis portant sur
tous les aspects de la protection des savoirs traditionnels soit trop
spécifique et insuffisamment souple pour tenir compte des besoins locaux.
Ainsi que nous
l’avons déjà mentionné, la capacité à protéger, promouvoir et exploiter les
savoirs traditionnels n’est pas nécessairement tributaire de la présence de
DPI. Réunir, par exemple, les innovateurs et entrepreneurs locaux pourrait être
bien plus pertinent. Quelles que soient les mesures mises en place ou quels que
soient les outils utilisés, l’exploitation accroîtra
sans doute la notoriété des savoirs traditionnels et de l’innovation locale au
sein des communautés et encouragera probablement une plus grande participation
des plus jeunes membres de la communauté. Ce scénario est particulièrement
probable dans le cas de la production de rendements économiques tangibles. Il
est toutefois important de se rappeler que les détenteurs des savoirs
traditionnels ne seront pas tous favorables à l’exploitation de leurs savoirs
de cette manière. Un participant à l’un de nos ateliers d’experts, un Indien
Kechuan péruvien, a signalé cet argument à la Commission. Pour beaucoup de
communautés locales, a-t-il expliqué, le concept de richesse est radicalement
différent de celui du monde occidental. Pour ces communautés, l’impératif est
de pouvoir assurer que leurs savoirs traditionnels et les lois coutumières qui
les régissent sont préservés et respectés, plutôt que d’obtenir un
dédommagement pécuniaire. Il a également observé que les attentes des
détenteurs de savoirs traditionnels n’étaient probablement pas réalistes quant
à la valeur économique potentielle de leurs savoirs. Ces attentes, bien
entendu, augmentent avec les affaires célèbres comme l’exemple du hoodia
(Encadré 4.2).
Appropriation illicite des savoirs traditionnels
La nature des
savoirs traditionnels est telle que la majeure partie d’entre eux se transmet
par oral plutôt que par écrit. Cela pose des problèmes particuliers lorsque des
parties non autorisées par le détenteur de ces savoirs cherchent à obtenir des
DPI sur ceux-ci. En l’absence de trace écrite accessible, les examinateurs de
brevets d’un autre pays ne peuvent pas accéder à des documents qui
contesteraient la nouveauté ou l’inventivité d’une demande fondée sur des
savoirs traditionnels. La seule option pour une partie lésée, qu’il s’agisse
des détenteurs des savoirs ou de la personne qui les représente, est alors de
contester le brevet durant le processus de délivrance ou après celui-ci,
lorsque le droit national le permet. C’est ce à quoi est parvenu le
gouvernement indien en faisant annuler les brevets sur le basmati (voir Encadré
4.5 ci-dessus) et le curcuma aux Etats-Unis.
La présence de
procédures administratives ou quasi-judiciaires d’opposition ou de réexamen des
brevets a facilité l’annulation de ces brevets. En l’absence de telles
procédures, il aurait été nécessaire d’engager une action devant le tribunal
compétent, avec les coûts inhérents et les délais que cela implique. Même en
présence de ces procédures, il est extrêmement difficile et coûteux pour les
pays en développement de contrôler et de contester des DPI accordés dans le
monde entier. Nous suggérons plus loin dans ce chapitre un moyen possible
d’aider les pays à contrôler les brevets accordés sur des inventions consistant
en des éléments biologiques acquis et des savoirs associés, ou développées à
partir de ceux-ci.
Il ne devrait pas être fait droit
aux demandes de brevets fondées sur des savoirs traditionnels tombés dans le
domaine public. Le problème est que les savoirs sont rarement documentés ou
s’ils le sont, ils sont rarement accessibles aux examinateurs de brevets. En
particulier, il est peu probable que les informations sur les savoirs
traditionnels figurent dans le type de renseignements relatifs aux brevets
auxquels se fient le plus souvent les offices des brevets pour apprécier la
nouveauté et l’inventivité. Pour résoudre ce problème, l’OMPI et plusieurs pays
en développement, sous l’impulsion de l’Inde et de la Chine, cherchent à créer
des bibliothèques numériques de savoirs traditionnels (voir Encadré 4.3). Ces
bibliothèques numériques détailleront par écrit un nombre considérable de
savoirs traditionnels tombés dans le domaine public et tiendront également
compte des normes de classification internationales (le système de
classification internationale des brevets (CIB) de l’OMPI) de sorte que
examinateurs de brevets puissent accéder facilement à ces données.
Encadré 4.3 Bibliothèque
numérique des savoirs traditionnels – le point de vue indien
En 1999, après la contestation par l’Inde (finalement
admise, mais coûteuse) des brevets sur le curcuma et le basmati accordés par
l'USPTO, il fut convenu que l’Institut national indien de la communication
scientifique (Indian National Institute
of Science Communication - NISCOM) et le Département du système indien
de médecine et d’homéopathie (Department
of Indian System of Medicine and Homoeopathy - ISM&H)
collaboreraient pour créer une bibliothèque numérique des savoirs traditionnels
(Traditional Knowledge Digital Library -
TKDL).
Le projet de TKDL se concentre initialement sur l'ayurveda
(système de médecine traditionnelle indienne) et se propose de documenter les
savoirs disponibles dans le domaine public (la littérature existante sur
l’ayurveda) en format numérisé. Les informations d’environ 35 000 slokas
(vers et prose) et formules seront saisis sur une base de données, et il est
prévu que le site web comptera environ 140 000 pages consacrées à
l’ayurveda. Les données seront mises à disposition dans plusieurs langues
internationales (anglais, espagnol, allemand, français, japonais et hindi).
La classification des ressources des savoirs traditionnels (Traditional Knowledge Resource
Classification - TKRC) est un système de classification innovant et
structuré, conçu pour faciliter l’organisation, la diffusion et la récupération
systématique des informations dans la TKDL. La TKRC se fonde sur le système de
classification internationale des brevets (CIB) : les informations sont
répertoriées en fonction de leur section, classe, sous-classe, groupe et
sous-groupe pour faciliter leur utilisation par les examinateurs de brevets
internationaux. Elle propose toutefois une plus grande précision des
informations sur les savoirs traditionnels en divisant un groupe CIB (à savoir
AK61K35/78 relatif aux plantes médicinales) en 5 000 sous-groupes environ.
La TKDL légitimera les savoirs traditionnels existants et,
en assurant la récupération aisée des informations liées aux savoirs
traditionnels par les examinateurs de brevets, empêchera, nous l’espérons, la
délivrance de brevets comme ceux portant sur le curcuma et le margousier dans
les affaires susmentionnées, qui portent sur des objets tombés dans le domaine
public.
L’OMPI travaille sur de telles bibliothèques et a créé un
groupe de travail spécialisé composé de représentants de la Chine, de l’Inde,
de l'USPTO et de l’OEB, qui examine comment ces bibliothèques peuvent être
intégrées dans les outils de recherche existants utilisés par les offices des
brevets.
L’OMPI examine également la
mesure dans laquelle des informations sur les savoirs traditionnels sont déjà
disponibles sur l'Internet. Les premières conclusions de l’OMPI indiquent que
la quantité d’informations disponibles sur les savoirs traditionnels est
substantielle et croissante. Toutefois, le format d’une grande partie d’entre
elles ne permet pas sa recherche ou son utilisation par les examinateurs de
brevets.[241]
La meilleure documentation des
savoirs traditionnels pourra être utile, non seulement pour empêcher la
délivrance de brevets injustifiés, mais également, ce qui est plus important,
pour contribuer à la préservation, la promotion et l’exploitation possible des
savoirs traditionnels. A cet égard, il est essentiel que le processus de
documentation ne porte pas préjudice aux DPI éventuels sur les éléments
documentés. La Fondation nationale de l’innovation (National Innovation Foundation) de l’Inde offre un exemple de
tentative de réponse à ces questions.[242]
L’une des inquiétudes soulevées par l’OMPI et plusieurs pays en développement,
au sujet de nombre des bases de données découvertes par l’OMPI, était de savoir
si les informations avaient été enregistrées avec le consentement préalable
donné en connaissance de cause des détenteurs des savoirs. Lors de discussions
à l’OMPI sur la documentation des savoirs traditionnels,[243]
des différences étaient également manifestes entre les pays en développement
quant au type de données qui pouvaient ou devaient être incluses dans les bases
de données. Certains pays, par exemple, avançaient que ces bases de données ne
convenaient que pour des informations déjà disponibles sous forme codifiée.
D’autres ont argué que les savoirs traditionnels qui n’avaient pas encore été
codifiés pouvaient également être inclus.
Les
bibliothèques numériques de savoirs traditionnels devraient être incorporées
aussitôt que possible aux listes de documentation de recherche minimale des
offices des brevets, ce qui permettrait de veiller à ce que les données qui y
sont contenues soient examinées lors du traitement des demandes de brevets. Les
détenteurs de savoirs traditionnels devraient jouer un rôle primordial
lorsqu’il s’agit de décider si ces savoirs sont inclus dans les bases de
données et tirer en outre des avantages de toute exploitation commerciale de
cette information.
La médecine
traditionnelle est un domaine qui présente un bon potentiel de documentation.
En République démocratique populaire lao, par exemple, le gouvernement a créé
le Centre de ressources des médecines traditionnelles (Traditional Medicines Resource Centre - TRMC) qui travaille
avec les guérisseurs locaux pour recenser les détails de toutes les médecines
traditionnelles, en vue de promouvoir le partage des pratiques au Laos. Le TRMC
collabore également avec le Groupe international coopératif sur la biodiversité
(ICBG) dans ses efforts de découverte de produits médicinaux potentiels. Tous
avantages, profits ou redevances réalisés à partir des plantes et savoirs
obtenus par le biais de cette collaboration seront partagés avec toutes les
communautés impliquées.[244]
Il est clair
que les DPI peuvent avoir un rôle à jouer dans l’exploitation des produits
fondés sur la médicine traditionnelle. Mais l’objectif premier doit être la
promotion de l’application de ces savoirs à l’amélioration de la santé humaine,
plutôt qu’à la production de revenus. En effet, il serait malheureux que
l’objectif de partage des avantages fondé sur la commercialisation n’ait pour
résultat que l’accroissement de la richesse de quelques personnes au prix de la
réduction de l’accès à des médicaments dont les pauvres ont particulièrement
besoin. La Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005
fait clairement ressortir l’objectif de santé publique.[245] Les leçons tirées de cet
effort et d’autres initiatives similaires doivent être librement partagées et
une assistance technique doit être offerte pour aider les autres pays à gérer
des initiatives relatives à la documentation.
Il faut
toutefois reconnaître qu’une grande partie des savoirs traditionnels restera
non documentée. Le concept de nouveauté absolue, selon lequel toute divulgation
dont par le biais de l’utilisation
dans toute partie du monde suffit à éliminer la nouveauté d’une invention,
reste donc un garde-fou nécessaire. Sans ce garde-fou, il serait possible de
continuer à délivrer des brevets sur des savoirs traditionnels tombés dans le
domaine public, même s’ils n’ont pas été divulgués par écrit. Certains pays
n’incluent pas l’utilisation en dehors de leur pays dans « l’état de la
technique ».
Les pays qui n’incluent que l’utilisation
nationale dans leur définition de l'état de la technique devraient accorder le
même traitement aux utilisateurs des savoirs dans les autres pays. En outre, il
faudrait tenir compte de la nature non écrite d’une grande partie des savoirs
traditionnels lorsque l’on s’efforcera de développer le système des brevets au
niveau international.
Pour certaines
communautés, l’octroi de DPI comme des brevets sur leurs savoirs peut
constituer une insulte. Bien qu’il existe des dispositions dans la plupart des
pays afin d’interdire l’octroi de DPI pour des raisons morales, il n’est pas
certain que les bureaux de la propriété intellectuelle seront en mesure de les
appliquer aux petites communautés autochtones. Par exemple, les raisons morales
de rejet des demandes de marque existent depuis un certain temps en
Nouvelle-Zélande, mais il est maintenant considéré nécessaire de définir plus
clairement la portée de cette disposition.
La modification envisagée interdirait l’enregistrement d’une marque lorsque, pour des motifs raisonnables, l’utilisation ou
l’enregistrement de la marque est susceptible d’insulter une partie
significative de la communauté, dont les Maoris.[246] Des mesures comme celle-ci,
ainsi qu’un usage plus répandu des bases de données consultables relatives aux
savoirs traditionnels tombés dans le domaine public, devraient contribuer à
empêcher l’octroi de DPI sur des éléments qui ne sont pas nouveaux ou qui sont
évidents ou susceptibles de vexer.
Toutefois,
comme nous l’avons déjà mentionné, il existe un second groupe de brevets et
d’ailleurs d’autres DPI qui suscitent des inquiétudes. Il s’agit des droits qui
remplissent globalement les critères habituels de brevetabilité ou de
protection, mais qui néanmoins :
·
sont
fondés sur des éléments obtenus par des moyens illicites ou sans le
consentement de leur détenteur, ou qui consistent en de tels éléments
·
ne
reconnaissent pas pleinement la contribution d’autrui à l’invention, en termes
de propriété des droits ou de partage des avantages éventuels découlant de la
commercialisation de l’invention brevetée.
Ces inquiétudes
ne s’appliquent pas uniquement aux brevets relatifs aux savoirs traditionnels,
bien qu’à la lueur de la CDB, les brevets les plus contestés dans ce domaine
sont souvent ceux qui portent sur des ressources biologiques et/ou les savoirs
traditionnels associés à ces ressources. Dans l’affaire du hoodia, la question
n’était pas tant de savoir si le brevet devait être délivré ou non, mais si les
San allaient recevoir une part équitable des avantages de la commercialisation.
Nous présentons ci-dessous des moyens potentiels de parvenir à un équilibre
plus équitable dans de tels cas.
ACCES ET PARTAGE DES AVANTAGES
Contexte
Comme nous
l’avons vu, l’une des principales questions du débat sur les savoirs
traditionnels concerne le lien entre la protection de la propriété
intellectuelle et la propriété et les droits afférents aux savoirs sur lesquels
se fonde le droit de propriété intellectuelle. Le cadre de notre examen de
cette question inclut également comment promouvoir les objectifs de partage des
avantages et de consentement préalable donné en connaissance de cause fixés par
la CDB. La ratification par la communauté internationale, à quelques grandes
exceptions près, de l’Accord sur les ADPIC et de la CDB impose une obligation
d’assurer que ces deux textes se renforcent l’un l’autre au lieu de se
contredire.
Convention sur la diversité
biologique (CDB)
La Convention, signée en 1992,
cherche à promouvoir la conservation de la biodiversité et le partage équitable
des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.[247]
Elle affirme les droits souverains des nations sur leurs ressources nationales,
et leur pouvoir de déterminer l’accès conformément à la législation nationale,
dans le but de faciliter l’utilisation durable de ces ressources, de promouvoir
leur accès et leur usage commun. Elle observe que l’accès aux ressources
génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause
et à des modalités mutuellement convenues qui prévoient le partage juste et
équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des
avantages résultant de l’utilisation commerciale et autre.[248]
Elle appelle également au partage juste et équitable des avantages découlant de
l’utilisation des savoirs traditionnels.[249]
En ce
qui concerne la propriété intellectuelle, la CDB stipule que l’accès et le
transfert (des ressources génétiques) doivent être compatibles avec la
« protection adéquate et effective » des droits de propriété
intellectuelle. Les gouvernements doivent mettre en place des politiques visant
à assurer que, notamment pour les pays en développement, l’accès aux ressources
génétiques a lieu selon des modalités mutuellement convenues. Elle observe que
les brevets et autres DPI peuvent avoir une influence sur l’application de la
Convention et que les gouvernements doivent coopérer (dans le respect des
législations nationales et du droit international) pour assurer que ces droits
s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs.[250]
L’organe directeur de la CDB est
maintenu convenu de lignes directrices sur l’accès et le partage des avantages
qui doivent guider les pays lors de la rédaction de législations nationales.[251]
Mais les pays sont confrontés à des décisions difficiles, au niveau pratique et
conceptuel, pour mettre en pratique le partage des avantages. En premier lieu,
les ressources en question ne sont souvent la « propriété » de
personne en particulier, mais constituent le patrimoine d’une ou plusieurs
communautés, qui ne sont pas nécessairement cohésives et ne vivent pas nécessairement
dans le même pays. En deuxième lieu, si certaines ressources génétiques peuvent
être rattachées à des régions et habitats très particuliers, dans d’autres cas
elles se composent d’éléments venant de nombreux pays, auquel cas les accords
de partage des avantages seront tout à fait impraticables. En troisième lieu,
en raison de la diversité des situations nationales, voire d’ailleurs au sein
même des nations, en matière de conditions culturelles, économiques ou
institutionnelles, il est très difficile de concevoir une législation et des
pratiques qui couvrent cette diversité selon des modalités facilitant la mise
en œuvre de ces mesures. En fait, il faudra prendre soin de s’assurer que la
législation et les pratiques qui cherchent à donner effet à la CDB ne limitent
ou ne découragent pas en réalité l’usage légitime des ressources génétiques,
que ce soit dans un but de commercialisation ou en termes de recherche
scientifique. On observe des signes de ce que le resserrement des restrictions
dans certains pays a gêné l’accès des biologistes étudiant les ressources
génétiques.[252]
Tout en admettant ces
difficultés, nous nous concentrons sur la manière dont les règles de propriété
intellectuelle peuvent devoir être modifiées dans les pays développés et en
développement pour apporter un appui à l’accès et au partage des avantages.
Nombreux sont ceux qui avancent que, puisque l’Accord sur les ADPIC ne parle
pas de la CDB et que la CDB ne fait pas mention de l’Accord sur les ADPIC, il
ne peut exister aucun conflit entre ces deux textes. Il est en outre avancé que
l’Accord sur les ADPIC appuie la CDB dans le sens où le brevetage engendre
souvent la commercialisation qui elle-même génère les avantages qui sont la
condition préalable de tout accord de partage des avantages. D’autres ont
contré cet argument en signalant que, puisque le brevetage fondé sur
l’utilisation des ressources génétiques est autorisé aux termes de l’Accord sur
les ADPIC (sous réserve de la satisfaction des critères de brevetabilité), celui-ci
ne soutient pas les objectifs de la CDB car les critères de brevetabilité
n’incluent pas le consentement préalable donné en connaissance de cause ou des
modalités mutuellement convenues pour le partage des avantages. Si la CDB
affirme la souveraineté nationale sur les ressources génétiques, aucune
disposition de l’Accord sur les ADPIC ne prévoit d’appui pour ces objectifs de
la CDB. Les sociétés étrangères peuvent obtenir des droits privés dérivés de
ressources nationales, mais l’Accord sur les ADPIC ne parle pas des obligations
stipulées par la CDB.
Néanmoins, même ceux
(principalement dans l’industrie) pour qui il n’existe aucun conflit entre la
CPD et l’Accord sur les ADPIC soutiennent dans l’ensemble les principes
sous-jacents de la CDB. En particulier, puisque la CDB affirme le principe que
les nations ont toute souveraineté sur leurs ressources naturelles, les
industries intéressées par l’utilisation de ressources génétiques doivent
assurer que les activités de prospection se déroulent sur le fondement du
consentement préalable donné en connaissance de cause et d’accords de partage
des avantages. Si elles ignorent ces principes, l’accès à ces ressources peut
ne pas être licite.
Compte tenu des difficultés
compréhensibles auxquelles les pays en développement sont confrontés pour
formuler et faire respecter les lois sur l’accès et le partage des avantages,
nous estimons que les pays développés et en développement doivent faire
davantage pour assurer que leurs systèmes de PI contribuent à la promotion des
objectifs de la CDB et de la communauté d’intérêts sous-jacente qui devrait
exister entre les fournisseurs de ressources génétiques, principalement dans
les pays en développement, et les utilisateurs, essentiellement basés dans les
pays développés.
Divulgation
de l’origine géographique des ressources génétiques dans les demandes de
brevets
Il a été suggéré que les
demandeurs de DPI consistant en des ressources génétiques ou développés à
partir de celles-ci soient tenus d’identifier l'origine de ces ressources et de
présenter la preuve qu’elles ont été acquises avec le consentement préalable
donné en connaissance de cause du pays dans lequel elles ont été prélevées.
Nous donnons dans l’Encadré 4.4 des exemples de pays qui ont introduit de
telles conditions dans leur droit.
La nature territoriale des
brevets signifie que les conditions susmentionnées ne s’appliquent que pour les
brevets délivrés dans ces pays ou régions particuliers. Par exemple, elles
n’ont aucun impact sur les brevets délivrés aux Etats-Unis ou au Japon. C’est
justement ce point, est-il avancé, qui justifie une solution plus
internationale au problème.
Si toutes les législations en
matière de brevets faisaient peser sur le demandeur une obligation de
divulgation de la source d’origine des ressources génétiques et de preuve du
consentement préalable donné en connaissance de cause, on estime que la
transparence augmenterait et que la simple communication d’informations
contribuerait à faire respecter les accords d’accès et de partage des
avantages. Une telle exigence pourrait également mettre en évidence les cas
similaires à l’exemple du hoodia.
Encadré 4.4 Exemples de législation en matière de
brevets incluant la divulgation de l’origine
Inde : L’article 10 (contenu de la description)
de la loi de 1970 sur les brevets (Patents
Act 1970), telle que modifiée par la seconde loi de modification sur les
brevets de 2002 (Patents Second Amendment
Act), prévoit que le demandeur doit divulguer la source et l’origine
géographique de toute matière biologique déposée au lieu d’une description. Par
ailleurs, l’article 25 (opposition à la délivrance d’un brevet) modifié permet
le dépôt d’une opposition au motif que « la description complète ne
divulgue pas ou mentionne de manière erronée la source ou l’origine
géographique de la matière biologique utilisée pour l’invention ».
Communautés
andines : La décision
andine No 486 prévoit dans son article 26 que les demandes de
brevets doivent être déposées auprès de l'office national compétent et doivent comprendre
:
h) une copie du contrat d’accès, si les produits ou méthodes
pour lesquels une demande de brevet est déposée ont été obtenus ou développés à
partir de ressources génétiques ou de produits dérivés originaires de l'un des
Etats membres ;
i) le cas échéant, une copie du document attestant de la
licence ou de l’autorisation d’utilisation des savoirs traditionnels des
communautés autochtones, afro-américaines ou locales des Etats membres, lorsque
les produits ou méthodes dont la protection est demandée ont été obtenus ou
développés sur le fondement de savoirs originaires de quelconque des Etats
membres, en application de la décision No 391 et de ses
modifications et règlements en vigueur ;
Costa Rica : L’article 80 (consultation préalable
obligatoire) de la loi 7788 sur la diversité biologique stipule que « Le
Bureau national des semences et les agents d’enregistrement de la propriété
intellectuelle et industrielle sont tenus de consulter le Bureau technique de
la Commission [pour la gestion de la biodiversité] avant d’accorder la
protection de la propriété intellectuelle ou industrielle à des innovations
impliquant des éléments de biodiversité. Ils doivent toujours fournir le
certificat d’origine délivré par le Bureau technique de la Commission et le
consentement préalable donné en connaissance de cause. L’opposition motivée du
Bureau technique interdira l’enregistrement d’un brevet ou la protection de
l’innovation ».
Le défaut de
présentation des informations exigées dans les cas susvisés pourra entraîner le
rejet de la demande ou la révocation du brevet.
Europe : Le considérant 27 de la
directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions
biotechnologiques prévoit que la demande de brevet devrait, le cas le cas
échéant, comporter une information concernant le lieu géographique d'origine de
la matière biologique, si celui-ci est connu. Mais cette démarche est
entièrement volontaire car ceci est sans préjudice de l'examen des demandes de
brevets et de la validité des droits résultant des brevets délivrés.
Les opposants avancent que
chercher à contrer l’accès illégal ou l’utilisation non autorisée par le droit
des brevets ne règle pas les cas n’impliquant pas de brevets. En outre,
l’introduction d’une telle condition uniquement pour les ressources génétiques
et les savoirs associés entraîne une discrimination à l’égard des autres cas
dans lesquels des brevets ont pu être obtenus en conséquence d’activités
illégales ou non autorisées. Il est également avancé que cela entraînerait une
plus grande incertitude juridique et créerait de « graves difficultés dans
la pratique » puisque « l’origine d’un échantillon biologique [est]
souvent peu claire ».[253]
Même lorsque la source immédiate du matériel est connue, elle peut ne pas être
la source d’origine, surtout lorsque le matériel est obtenu, comme c’est
fréquemment le cas, depuis des collections ex
situ constituées sur de nombreuses années.
Il est difficile d’apprécier à
quel point cette incertitude serait réelle. Lorsqu’une société est intéressée
par une ressource génétique particulière, il semble probable qu’elle
s’efforcera de découvrir autant d’informations que possible au sujet de ce
matériel en raison de leur pertinence pour son utilité potentielle (par
exemple, la manière dont les populations locales l’utilisent). En pareil cas,
il est probable que l’origine géographique de la ressource sera connue. Dans
les autres cas, il peut être plus difficile d’établir avec précision l’origine
géographique d’un échantillon particulier. Néanmoins, il paraît peu probable,
notamment pour les échantillons obtenus après 1992, que certaines informations
relatives à l'origine géographique d’un échantillon particulier ne soient pas
disponibles. Aux termes de la CDB, les avantages éventuels doivent être partagés
avec le pays fournissant la ressource, que celle-ci soit ou non réellement
originaire de ce pays.[254]
Le Traité ITPGRFA, comme nous l’avons vu, prévoit un mécanisme différent pour
les ressources phytogénétiques de diverses origines.
L’un des objectifs déclarés de l’exigence de
divulgation de la source d’origine et du consentement préalable donné en
connaissance de cause est d’encourager le respect des principes d’accès et de
partage des avantages de la CDB. Toutefois, d’autres mécanismes et incitations
existent, qui pourraient permettre d’atteindre cet objectif. Le défaut
d’obtention de l’autorisation d’accès ou d’utilisation de matériel pourrait,
par exemple, donner lieu à une action en justice en vertu de la théorie de
l’appropriation illicite ou de la rupture de contrat. Mais chercher un
dédommagement de cette manière demande du temps et est coûteux, et présente peu
d’intérêt pour nombre des détenteurs de savoirs traditionnels. En outre, le
risque d’être stigmatisées en tant que « pirates biologiques » peut
également inciter les organisations à assurer la probité de leurs activités. Les
contrevenants à la CDB identifiés pourraient se voir interdire l’accès futur au
matériel. Une telle sanction a déjà été envisagée au Bangladesh.[255] Les fournisseurs de
matériel peuvent convenir collectivement de n’approvisionner que les
organisations consentant à communiquer dans les demandes de brevets qu’elles
pourraient déposer l’intégralité des détails des contrats d’accès éventuels. Il
est possible que ces incitations suffisent en elles-mêmes. Les
sociétés et les organisations qui utilisent ou fournissent des matières
biologiques ou des savoirs traditionnels ont déjà adopté ou considèrent
l’adoption de codes de conduite couvrant les activités relevant de la CDB.[256]
Néanmoins, nous estimons qu’il est important de
reconnaître le pouvoir de la CDB, même si seuls quelques pays ont mis en œuvre
une législation spécifique d’accès et de partage des avantages. Nous
concluons donc que, lorsqu’un pays a établi un cadre juridique clair régissant
l’accès aux matières biologiques et/ou aux savoirs traditionnels, ce pays
devrait alors pouvoir intervenir lorsque des DPI sont accordés sur des matières
ou savoirs acquis de manière illicite dans ce pays.
Nous irions même plus loin dans notre soutien des objectifs
de la CDB en avançant que personne ne devrait pouvoir bénéficier de DPI
consistant en des ressources génétiques ou savoirs associés obtenus de manière
illicite ou utilisés de manière non autorisée, ou fondés sur de tels ressources
et savoirs. Les organisations qui réfléchissent actuellement à cette question
devraient examiner quelles sont les mesures qui permettraient d’atteindre cet
objectif dans le cadre international existant. Outre la possibilité du rejet
des demandes ou de la révocation des droits, nous suggérons qu’il convient
également de réfléchir à la déclaration de l’inopposabilité de tels DPI.[257]
Cette sanction est déjà disponible aux Etats-Unis en vertu des doctrines des
« mains sales » et de la conduite inéquitable, selon lesquelles un
tribunal refusera d’opposer un brevet tant que son titulaire ne se sera pas
lavé les mains ou n’aura pas remédié à sa conduite inéquitable ou à sa fraude
éventuelle. Dans leur interprétation de ces doctrines, les tribunaux ont
observé que l’intérêt dominant est d’assurer que les brevets sont issus
« d’un contexte dépourvu de fraude ou d’une autre conduite
inéquitable ».[258]
La Cour suprême des Etats-Unis a également observé que
« Un tribunal d’équité n’agit que lorsque la conscience
l’exige et conformément à elle ; et si la conduite du demandeur est
contraire aux principes de justice naturelle, alors, quels que puissent être
les droits qu’il possède et quel que soit l’usage qu’il puisse en faire devant
un tribunal de droit, il sera jugé sans recours devant un tribunal
d’équité ».[259]
En application
du principe d’équité, aucune personne ne devrait pouvoir bénéficier d’un droit
de PI fondé sur des ressources génétiques ou des savoirs associés acquis en
violation de toute législation régissant l’accès à ce matériel. En tels cas,
c'est au détenteur du savoir qu'il devrait généralement incomber de prouver que
le titulaire du DPI a agi indûment. Toutefois, la condition préalable à toute
action est la connaissance du préjudice. C’est pour offrir une assistance à cet
égard que nous pensons qu’une prescription de divulgation du type susmentionné
est nécessaire.
Tous les pays
devraient prévoir dans leur législation l’obligation de divulguer dans la
demande de brevet l’origine géographique des ressources génétiques dont
l’invention est dérivée. Cette exigence devrait être assortie d’exceptions
raisonnables, comme par exemple lorsqu’il est véritablement impossible
d’identifier l'origine géographique du matériel. Des sanctions, éventuellement
du type susmentionné, ne devraient être infligées que dans les cas où il est
démontré que le titulaire du brevet n’a pas divulgué l'origine qu'il
connaissait, ou a cherché sciemment à induire en erreur en ce qui concerne l'origine. Le Conseil des ADPIC devrait examiner
cette question, dans le cadre du paragraphe 19 de la Déclaration ministérielle
de Doha.
Il
faudrait également envisager d'établir un système selon lequel les offices des
brevets examinant les demandes de brevets qui indiquent l'origine géographique
de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels transmettent cette
information soit au pays concerné, soit à l’OMPI qui pourrait agir en tant que
dépositaire des informations liées aux brevets et relatives aux allégations de
« biopiraterie ». Ces mesures permettraient de suivre de plus près
l’utilisation et l’usage abusif des ressources génétiques.
INDICATIONS
GEOGRAPHIQUES
Contexte
Au début de ce chapitre, nous avons envisagé la pertinence
des indications géographiques pour la protection des savoirs traditionnels.
Toutefois, les indications géographiques ont une application beaucoup plus
large et, pour certains pays, constituent l’une des catégories les plus
importantes de propriété intellectuelle, ce que reflète l’Accord sur les ADPIC.
Indications géographiques et
Accord sur les ADPIC
Les négociations relatives à la section sur les indications
géographiques de l’Accord sur les ADPIC ont été tout particulièrement
difficiles.[260] La
raison en était une nette division entre les principaux auteurs de l’Accord sur
les ADPIC (les Etats-Unis et l'UE). En outre, ainsi qu’il est ressorti des
discussions ultérieures au sein du Conseil des ADPIC, il existe également des
divisions parmi les autres pays développés et parmi les pays en développement.
Le texte final de l’Accord illustre ces divisions et, en demandant une
poursuite des travaux, reconnaît qu’il a été impossible de parvenir à un accord
sur plusieurs points importants.
Par conséquent, le texte actuel de l’Accord sur les ADPIC
offre une protection de base, et des normes renforcées pour les vins et
spiritueux. L’inclusion de ces normes renforcées ne découle pas des
caractéristiques des vins et spiritueux, mais représente plutôt un compromis convenu lors des
négociations. Ce déséquilibre de la protection a suscité des demandes de
protection additionnelle de la part de plusieurs pays, dont l’Inde, le
Pakistan, le Kenya, l’île Maurice et le Sri Lanka.[261]
D’autres pays, comme l’Argentine, le Chili et le Guatemala, avancent que
l’extension de la protection additionnelle à d’autres produits imposerait des
charges financières et administratives supplémentaires à tous les membres de
l’OMC, lesquelles annuleraient les avantages commerciaux éventuels. Ces pays
estiment que ces charges seraient tout particulièrement lourdes pour les pays
en développement.
En l’absence d’une évaluation
économique fiable, il est difficile d’apprécier les mérites de ces deux séries
d’arguments. Ces arguments reflètent également, bien entendu, les différences
entre les pays développés et en développement concernant les intérêts
économiques perçus. Quelques pays, par exemple l’Egypte et le Paraguay, ont
déjà signalé que la protection additionnelle des indications géographiques pour
les vins et les spiritueux sera mise à disposition dans leur droit national
pour d’autres produits.[262]
Il sera intéressant de voir si l’introduction de cette protection additionnelle
élargie entraîne des coûts et avantages supplémentaires significatifs en
l’absence de reconnaissance internationale.
Registre multilatéral des indications
géographiques
Outre l’introduction d’une protection renforcée des
indications géographiques pour les vins et spiritueux, l’Accord sur les ADPIC
prescrit également le lancement de négociations au Conseil des ADPIC concernant
l'établissement d’un registre multilatéral des indications géographiques pour
les vins. La Conférence ministérielle de Doha a élargi ce mandat pour inclure
des négociations sur l'établissement d’un système incluant les spiritueux.
L’objectif du registre n’a pas été clairement défini. Comme nous l’observons
ci-dessous, les opinions des groupes de pays divergent sur ce point. Certains
souhaitent en effet l’utiliser comme un registre international exhaustif qui
obligerait tous les Etats membres à accorder une protection aux indications
géographiques satisfaisant aux critères d’enregistrement. D’autres préfèrent un
système d’enregistrement volontaire, source d’information.
A ce jour, trois propositions différentes ont été présentées
portant sur le registre multilatéral. L’UE envisage un registre opposable à
tous les Etats membres de l’OMC, qu’ils aient ou non des indications
géographiques incluses dans le registre.[263]
Tout membre de l’OMC souhaitant contester l’inclusion d’une indication
géographique dans le registre est tenu de notifier le pays concerné et
d’entamer des négociations en vue de la résolution du litige. La proposition de
la Hongrie prévoit que lorsqu’un membre de l’OMC a abouti dans sa contestation
de l’inclusion d’une indication géographique pour certains motifs particuliers,
il ne sera alors pas nécessaire aux autres membres de l’OMC de protéger cette
indication géographique.[264]
Dans ces deux propositions, l’inclusion d’une indication géographique dans le
registre constituerait une présomption d’éligibilité à la protection par tous
moyens de droit offerts pour la protection des indications géographiques dans
tout Etat membre de l’OMC.
En revanche la proposition commune des Etats-Unis, du
Canada, du Chili et du Japon prévoit un système d’enregistrement opposable
uniquement à ceux qui cherchent à participer au système.[265]
Les membres participants utiliseraient le registre lors de l’examen, par
exemple, de demandes de marques contenant une indication géographique ou
consistant en une indication géographique. Les membres de l’OMC non
participants seraient encouragés à utiliser le registre de la même manière. Les
négociations sur le registre doivent, selon la récente Conférence ministérielle
de Doha de l’OMC, parvenir à terme à la Conférence de Mexico en 2003 au plus
tard.
Le Secrétariat du Conseil des ADPIC a déjà commencé à
clarifier la manière dont plusieurs membres de l’OMC, dont certains pays en
développement, ont satisfait à leurs obligations aux termes de l’Accord sur les
ADPIC.[266] La
grande majorité des pays ayant donné des informations prévoit une législation
spécifique portant sur les indications géographiques, bien qu’on ne sache pas
si cette législation résulte directement de l’Accord sur les ADPIC ou était
déjà en place pour répondre, par exemple, à des engagements bilatéraux.
La charge administrative de
l’application de la nouvelle législation pour les pays actuellement sans
protection ne semble pas excessivement lourde. En effet, l’Accord sur les ADPIC
n’exige actuellement aucun système d’enregistrement officiel national des
indications géographiques, et la charge et les coûts de l’obligation
d’application pèsent donc sur les détenteurs de l’indication géographique et
non sur les pouvoirs publics. Comme il est indiqué ci-dessous, toutefois, le
coût de veiller à la conformité aux normes de qualité et de promouvoir et faire
respecter les indications géographiques à l’étranger peut être significatif.
Impact économique des
indications géographiques
Pour apprécier
les positions à adopter dans les discussions sur le registre multilatéral et
l’extension possible du champ de la protection, il est important que les pays
en développement réfléchissent avec soin aux coûts et avantages potentiels. En
effet, comme nous l’avons suggéré dans une autre partie de ce rapport, nous pensons
qu’il convient de procéder à des évaluations complètes de l’impact économique
avant d’introduire de nouvelles obligations en matière de PI à la charge des
pays en voie de développement.
Les conséquences économiques pour un pays en voie de
développement sont difficiles à évaluer. Le principal avantage économique des
indications géographiques serait de servir de marque de qualité, ce qui jouera
un rôle dans la croissance des marchés d'exportation et des revenus. Mais la
protection renforcée, surtout lorsqu’elle est appliquée au niveau
international, pourrait produire des effets négatifs sur les entreprises
locales exploitant actuellement des indications géographiques qui pourraient
être protégées à l’avenir par une autre partie. Ainsi, les pays produisant des
succédanés de produits protégés à l’avenir par des indications géographiques
enregistreront des pertes. La prolifération des indications géographiques
aurait tendance à réduire leur valeur individuelle.
Il a également été suggéré que les indications géographiques
pourraient présenter un intérêt particulier pour plusieurs pays en
développement susceptibles d’avoir ou d’obtenir un avantage comparatif en
matière de produits agricoles et de boissons et d’aliments préparés.[267]
Pour ces pays, rechercher et faire valoir la protection des indications
géographiques à l’étranger pourrait entraîner des gains économiques. Toutefois,
les coûts impliqués dans de telles actions, notamment en matière de respect,
pourraient être prohibitifs. En outre, avant de rechercher la protection à
l’étranger, il est nécessaire de développer et de protéger l’indication
géographique dans son pays d’origine. Il pourrait être nécessaire de déployer
des ressources pour veiller à ce que la qualité requise, la réputation ou
autres caractéristiques du produit couvert par l’indication géographique soient
développées et maintenues. Il sera également nécessaire de prendre des mesures
pour veiller à ce que l’indication géographique ne devienne pas un terme
générique admis, que tous peuvent utiliser librement (voir Encadré 4.5).
Selon nous, il est loin d’être certain que ces pays seront
en mesure de tirer un avantage significatif de l’application des indications
géographiques. A titre d’exemple, l’Arrangement de Lisbonne, système
international de protection administré par l’OMPI concernant la protection des
appellations d’origine, a été convenu en 1958.[268]
A ce jour, 20 pays seulement (dont sept pays développés) ont ratifié
l’Arrangement et, en 1998, 766 appellations d’origine étaient protégées par
l’Arrangement, dont les pays européens détiennent 95 %.
Encadré 4.5 Indications géographiques :
l’affaire du basmati
Le basmati est une variété de riz des provinces du Punjab en
Inde et au Pakistan. Il s’agit d’une variété de riz aromatique à grains longs
et minces, originaire de cette région, qui représente une grande culture à
l’exportation pour les deux pays. Les exportations annuelles de basmati valent
environ 300 millions de dollars et constituent le gagne-pain de milliers
d’agriculteurs.
La « bataille du basmati » a commencé en 1997
lorsque la société américaine d’amélioration génétique de riz RiceTec Inc. a
obtenu un brevet (US5663484) de plante et semence, recherchant le monopole sur
diverses lignées de riz, dont certaines présentaient des caractéristiques
similaires à celle des lignées de basmati. Soucieuse des effets potentiels sur
ses exportations, l’Inde a demandé un réexamen de ce brevet en juin 2000. Le
titulaire du brevet, en réponse à cette action, a retiré plusieurs
revendications, dont celles qui couvraient les lignées de type basmati.
D’autres revendications ont également été retirées à la suite des inquiétudes
soulevées par l'USPTO. L’objet du litige est toutefois passé du brevet à
l’utilisation illicite du nom « basmati ».
Dans certains pays, le terme « basmati » ne peut
s’appliquer qu’au riz aromatique à grains longs cultivé en Inde et au Pakistan.
RiceTec a également demandé l’enregistrement de la marque « Texmati »
au Royaume-Uni, alléguant que « basmati » était un terme générique.
L’opposition fut retenue et le Royaume-Uni a établi un code de pratique pour la
commercialisation du riz. L’Arabie saoudite (premier importateur mondial de riz
basmati) possède une réglementation similaire sur l’étiquetage du riz basmati.
Le code prescrit que « dans les cercles de
consommateurs, commerciaux et scientifiques, il [est] estimé que
le caractère distinctif
du riz basmati
ne peut être
obtenu que dans
les régions septentrionales de
l’Inde et du Pakistan en raison de la combinaison unique et complexe de
l’environnement, de la terre, du climat, des pratiques agricoles et de la
génétique des variétés basmati ».
Mais en 1998, la Fédération du riz américaine a avancé que
le terme « basmati » était générique et faisait référence à un type
de riz aromatique. En réaction, un collectif d’organisations de la société
civile de l’Inde et des Etats-Unis a déposé une demande visant à interdire
l’utilisation du mot « basmati » dans la publicité du riz cultivé aux
Etats-Unis. Le minitère de l'Agriculture américain et la Commission fédérale du
commerce américaine ont rejeté cette demande en mai 2001. Aucun de ces deux
organismes ne considérait que l’étiquetage du riz en tant que « basmati
cultivé aux Etats-Unis » était susceptible d’induire en erreur et ont jugé
que le terme « basmati » était un terme générique.
Ce problème ne se pose pas seulement aux Etats-Unis :
l’Australie, l’Egypte, la Thaïlande et la France cultivent également du riz de
type basmati et pourraient suivre l’exemple des Etats-Unis et considérer
officiellement que le mot « basmati » est un terme générique.
Le nom « Basmati » (et les marchés d'exportation
de l’Inde et du Pakistan) peuvent être protégés par son enregistrement en tant
qu’indication géographique. Toutefois, l’Inde et le Pakistan devront également
expliquer pourquoi ils n’ont pas engagé d’action contre l’adoption progressive
du statut générique du mot « basmati » ces 20 dernières années.
Ainsi, l’Inde n’a pas déposé de protestation officielle lorsque la Commission
fédérale du commerce américaine a officiellement déclaré le mot
« basmati » comme un terme générique.
Même si l’on tient compte des faiblesses bien documentées de
l’Arrangement de Lisbonne (comme l’absence d’exceptions appropriées pour les
indications géographiques devenues génériques) qui en détournent aussi bien les
pays développés que les pays en développement, le niveau d’intérêt que
l’Arrangement suscite semble très limité, même dans les pays en développement
ayant estimé qu’il valait la peine d'y adhérer.[269]
Dans le cadre des discussions de l’OMC au sujet d’un
registre multilatéral, il a été proposé de réfléchir plus avant, entre autres,
au coût probable de l’introduction du type de registre proposé par l’UE.[270]
Plusieurs pays en développement ont demandé une analyse de ce type lors de
discussions récentes à l’OMPI.[271]
Toutefois, certains des pays qui font maintenant pression sur l’OMC pour
poursuivre ce travail ne lui avaient pas donné l’appui nécessaire pour
progresser. Comme d’autres, nous pensons que ce n’est qu’avec ce type d’analyse
que les pays en développement, en particulier les pays à faible revenu,
pourront adopter une position en connaissance de cause dans les débats en cours
sur les indications géographiques, notamment au sein de l’OMC.[272]
De nouvelles
recherches devraient être entreprises d’urgence par un organe compétent,
peut-être la CNUCED, pour évaluer, pour les pays en développement :
·
les
coûts réels ou potentiels de la mise en œuvre des dispositions sur les
indications géographiques existantes dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC
·
le
rôle que les indications géographiques pourraient jouer dans le développement
de ces pays
·
les
coûts et avantages probables de l’extension à d’autres produits de la
protection additionnelle actuellement accordée aux vins et spiritueux
·
les
coûts et avantages des diverses propositions visant à établir un registre
multilatéral des indications géographiques.
Chapitre 5
DROIT D’AUTEUR, LOGICIELS ET
INTERNET
INTRODUCTION
Toute enquête
sérieuse portant sur la PI et le développement doit envisager le rôle crucial
que jouent le droit d’auteur et les industries du droit d’auteur (dont
l’édition, le cinéma, la télévision, la radio, la musique et, maintenant, les
logiciels informatiques également) dans la production et la diffusion du savoir
et des produits fondés sur le savoir. Ces industries fournissent leurs
« matières premières » intellectuelles à la science et à
l’innovation, ainsi qu’à l’éducation et l’instruction en général. Elles ont en
outre contribué aux progrès spectaculaires enregistrés par la productivité, en
participant à la création de produits fondés sur l’information, comme les
logiciels de publication assistée par ordinateur, la messagerie électronique ou
les bases de données informatisées scientifiques complexes. En outre, les
industries du droit d’auteur ont évolué pour se transformer en une immense
source de richesses et de création d’emplois dans l’économie mondiale fondée
sur le savoir. Ainsi, aux Etats-Unis, leur valeur totale a progressé à un
rythme tellement rapide ces vingt ou trente dernières années qu’actuellement
elles apportent ensemble plus de 460 milliards de dollars au produit
intérieur brut américain et ont exporté pour plus 80 milliards de dollars
de produits en 1999.[273]
Pour les pays
en développement, cette situation présente à la fois des opportunités et des
défis immenses :
« La
protection des auteurs et des détenteurs des produits intellectuels revêt une
importance croissante dans les économies postindustrielles, où l’information et
le savoir jouent un rôle central. Le concept de droit d’auteur, qui visait à
l’origine à protéger les auteurs d’ouvrages et leurs éditeurs, a été étendu à
d’autres produits intellectuels tels que programmes informatiques et films...
Le droit d’auteur s’est imposé comme l’un des principaux moyens de réglementer
le flux international des produits basés sur les idées et le savoir, et il sera
un instrument essentiel pour les industries du savoir du XXIe
siècle. Ceux qui pourront se prévaloir de ce droit bénéficieront d’un précieux
atout dans l’économie mondiale fondée sur le savoir qui est en train de se
mettre en place. Il est de fait que les droits d’auteur de bon nombre de ces
produits sont entre les mains des principaux pays industrialisés et des grands
groupes multimédias, de sorte que les pays où le revenu par habitant est peu
élevé et ceux dont l’économie est de taille modeste se retrouvent nettement
désavantagés. »[274]
La protection
juridique du droit d’auteur remonte au XVIIIe siècle, avec
l’adoption en Grande-Bretagne d’une loi sur le droit d’auteur (Statute of Anne), et fut consacrée par
la Convention de Berne à la fin du XIXe siècle. Bien que les termes
employés par la Convention suggèrent un paradigme pour la protection des droits
des auteurs et artistes, les droits d’auteur n’appartiennent pas la plupart du
temps aux individus, mais aux sociétés qui les emploient. En effet, les droits
d’auteur constituent un élément fondamental du modèle d’entreprise des
éditeurs, des producteurs de télévision, des éditeurs de logiciels et des
maisons de disques car ils octroient à leurs titulaires des droits exclusifs
sur, entre autres, la reproduction et
la distribution des œuvres protégées. Les
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), et en
particulier l’Internet, permettent la création non autorisée de copies
illimitées, parfaites et gratuites d’œuvres protégées, ainsi que leur
distribution presque instantanée dans le monde entier. Cette situation lance un
défi sans précédent aux législations sur le droit d’auteur. Certains estiment
que l’avenir verra un déclin considérable de l’importance du droit d’auteur, à
mesure que les industries adoptent une protection fondée sur la technologie,
sous forme de cryptage et de mesures de lutte contre le contournement,
complétée par le droit des contrats et des formes de protection sui generis de la PI en matière de bases de données.
Nous pensons que les questions de
droit d’auteur revêtent une pertinence et une importance croissantes pour les
pays en développement, alors que ceux-ci entrent dans l’ère de l’information et
se démènent pour participer à l’économie mondiale fondée sur le savoir. Bien
entendu, certains pays en développement s’inquiètent depuis longtemps de ce que
la protection par le droit d’auteur des livres et des matériels pédagogiques,
par exemple, risque d’entraver la réalisation de leurs objectifs d’éducation et
de recherche. Ces préoccupations, exprimées vigoureusement en 1967 lors de la
Conférence de Stockholm de la Convention de Berne, restent tout aussi valables
aujourd’hui.
A présent, le droit d’auteur
demande une attention particulière, non seulement parce que des millions de
pauvres n’ont toujours pas accès aux livres et autres œuvres protégées par le
droit d’auteur, mais également parce que ces dix dernières années ont vu des
progrès rapides en matière de technologies de l’information et de la
communication, qui ont transformé la production, la diffusion et le stockage
des informations. Cette évolution s’est accompagnée d’un renforcement de la
protection nationale et internationale du droit d’auteur. En effet, ce sont
principalement ces évolutions techniques qui ont incité les industries du droit
d’auteur des pays développés à faire pression pour l’adoption de l’Accord sur les
ADPIC et du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, ainsi que du système de
protection sui generis des bases de
données instauré par l’UE en 1996. Ces tendances ont certainement des
conséquences favorables et défavorables pour les pays en développement et il
est important de comprendre quel est leur impact sur ces pays, et sur les
pauvres en particulier.
Pour les pays en développement,
la question cruciale est de parvenir à un équilibre entre la protection du
droit d’auteur et l’accès adéquat au savoir et aux produits fondés sur le
savoir. Les coûts d’accès, ainsi que l’interprétation des exemptions au titre
du « fair use » ou du
« fair dealing »
(utilisation équitable), revêtent une importance particulièrement aiguë pour
les pays en développement, et ce d’autant plus que le champ du droit d’auteur
s’étend pour couvrir les logiciels et le matériel numérique. Il convient
d’examiner ces questions afin de veiller à ce que les pays en développement
puissent accéder aux produits importants fondés sur le savoir lorsqu’ils
cherchent à atteindre l’objectif d’éducation pour tous, à encourager la
recherche, à améliorer la compétitivité, à protéger les expressions de leur
culture et à réduire la pauvreté.
Dans ce
chapitre, nous examinons les questions suivantes :
·
Quelle est l’importance du droit
d’auteur en tant que stimulant des industries culturelles et autres dans les
pays en développement ?
·
Quel est l’impact du droit d’auteur sur
les pays en développement en leur qualité de consommateurs de produits
étrangers, et en particulier de matériels éducatifs, dont via l’Internet ?
·
Quelles mesures les pays en
développement devraient-il appliquer en matière de respect du droit
d’auteur ?
·
Quel est l’impact sur les pays en
développement du droit d’auteur sur les logiciels ?
LE DROIT D’AUTEUR EN TANT QUE
STIMULANT DE LA CREATION
Ainsi que l’ont signalé des
organismes comme l’OMPI, l’UNESCO et la Banque mondiale, il est important que
les pays en développement élaborent des mécanismes pour protéger leurs propres
œuvres de création passées et actuelles et bénéficier de leur exploitation
commerciale. A cet égard, le droit d’auteur peut jouer un rôle de premier ordre
dans le développement d’industries culturelles dans les pays en développement,
en assurant des rémunérations par le biais de droits exclusifs sur la
reproduction et la distribution.[275]
Au Chapitre 4, nous avons examiné les questions relatives à la protection
des savoirs traditionnels dans les pays en développement et une grande partie
de ces observations s’appliquent également ici, dans la mesure où ces savoirs
et ces créations peuvent être susceptibles d’une protection en vertu des
législations sur le droit d’auteur.
A l’échelon mondial, ce sont
principalement les industries européennes et nord-américaines de l’édition, des
divertissements et des logiciels qui perçoivent les fruits directs de la
protection du droit d’auteur. Comme le montre la Figure 5.1 ci-dessous, les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie
produisaient à eux seuls presque les deux tiers des exportations mondiales de
livres en 1998. Mais, dans certains cas, les industries du droit d’auteur dans
les pays en développement sont également florissantes et obtiennent une partie
de ces fruits.
L’exemple le plus célèbre est sans
doute celui de l’industrie indienne du logiciel. Entre 1994-95 et 2001-02, les
revenus bruts de cette industrie ont progressé de 787 millions de dollars
à 10,2 milliards de dollars (dont une grande part était constituée par les
logiciels à l’exportation, dont la valeur est passée de 489 millions de
dollars à 7,8 milliards de dollars sur la période considérée) et, en mars
2002, le secteur des logiciels et des services connexes employait environ
520 000 personnes.[276]
Il est en outre certain que les pays en développement possèdent une richesse de
talent créatif (comme les musiciens au Mali et à la Jamaïque, ou les artistes
traditionnels au Népal), susceptible d’être exploitée en vue de produire
davantage de richesses pour les économies émergentes. Toutefois, cette
exploitation ne sera possible que s’il existe une infrastructure locale pour
les industries culturelles, l’édition et l’enregistrement par exemple.
Actuellement, de nombreux écrivains et musiciens des pays en développement (en
Afrique notamment) doivent avoir recours à des éditeurs ou maisons de disques
étrangers.
Figure 5.1 Principaux
pays exportateurs de livres en fonction de leur part de marché, 1998
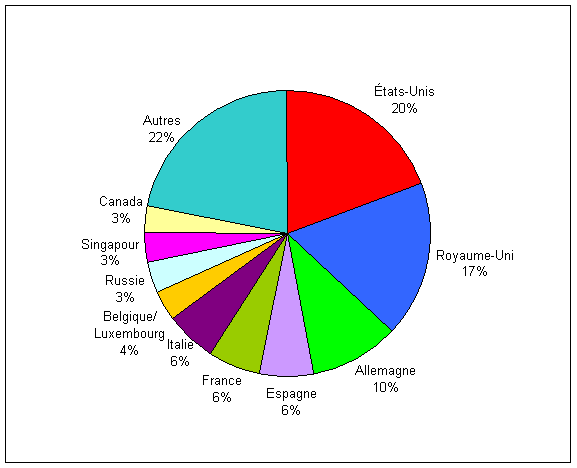
Source : UNESCO
(2000a)
A côté de réussites comme celle de l’industrie indienne du logiciel, on trouve
également des pays en développement qui offrent une protection du droit
d’auteur depuis plusieurs décennies en leur qualité de membres de la Convention
de Berne (comme le Bénin ou le Tchad qui y ont adhéré en 1971) et n’ont
enregistré aucune amélioration significative de leurs industries nationales du
droit d’auteur ou du niveau de la création d’œuvres protégées par le droit
d’auteur au sein de leur population.
Les données probantes suggèrent
donc que la disponibilité de la protection du droit d’auteur pourrait être une
condition nécessaire mais insuffisante du développement d’industries nationales
viables dans les secteurs de l’édition, des
divertissements et des logiciels dans les pays en développement.
Beaucoup d’autres facteurs sont importants pour le développement durable de
telles industries du droit d’auteur. Prenons l’exemple de l’industrie de
l’édition en Afrique : des facteurs comme le caractère imprévisible des
achats de manuels par les pouvoirs publics et bailleurs de fonds, la faiblesse
des compétences de gestion des sociétés locales, les coûts élevés du matériel
d’impression et du papier, et le mauvais accès au financement resteront sans
doute à court terme de très fortes contraintes dans de nombreux pays.[277]
Par ailleurs, étant donné la
taille réduite du marché de nombreux pays en développement, la disponibilité de
la protection du droit d’auteur pourrait jouer un rôle commercial
particulièrement important sur les marchés d'exportation, plutôt que sur les
marchés intérieurs, et ce nonobstant le fait que les auteurs et sociétés des
pays en développement risquent de se trouver confrontés à des coûts
insurmontables lorsqu’ils doivent engager une action pour faire valoir leurs
droits sur ces marchés. Bien entendu, dans les grands pays en développement
comme l’Inde, la Chine, le Brésil ou l’Egypte, la protection du droit d’auteur
sur le marché intérieur revêt clairement une importance considérable pour les
industries nationales de l’édition, du cinéma, de la musique et des logiciels.
Néanmoins, comme nous l’avons déjà observé, les Etats-Unis ont cherché au XIXe
siècle à encourager le développement de leur industrie de l’édition nationale
en ne reconnaissant pas les droits des titulaires de droits d’auteur étrangers.
Sociétés
de perception
En vue de
réaliser les avantages potentiels du droit d’auteur, certains pays en
développement ont créé des sociétés de gestion collective, qui représentent les
droits des artistes, des auteurs et des interprètes ou exécutants et perçoivent
les redevances issues de la concession de licences sur les œuvres protégées par
le droit d’auteur figurant dans leurs répertoires. A l’heure actuelle, seule
une minorité de pays en développement a suivi cette approche et les avis
divergent quant aux mérites de la création de sociétés de gestion collective.
L’OMPI et d’autres organismes bailleurs de fonds les encouragent et les
soutiennent activement, ainsi que les gouvernements de certains pays en
développement (dans les Caraïbes par exemple). Des groupes représentant les
industries du droit d’auteur dans les pays développés avancent également que la
création d’organismes gérant les droits de reprographie dans les pays en
développement faciliterait l’élargissement de l’accès aux œuvres protégées, et
ce au moyen de la photocopie à des taux adaptés au marché local.
D’autre part,
certains commentateurs allèguent que, bien que ces organisations des pays en
développement puissent percevoir des redevances pour les auteurs et artistes
locaux, il est probable qu’elles en perçoivent bien davantage pour les
titulaires de droits étrangers des pays développés qui risquent souvent de
dominer le marché des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ainsi, en Afrique
du Sud, où l’équilibre est sans doute plus favorable que dans les pays en
développement à plus faible revenu, l’Organisation des droits dramatiques,
artistiques et littéraires (Dramatic,
Artistic and Literary Rights Organisation - DALRO) a distribué un
total d’environ 74 000 euros aux titulaires de droits nationaux, dont
environ 20 000 euros ont été reçus de sociétés de perception
étrangères, tandis que sur la même période elle a distribué environ
137 000 euros aux titulaires de droits étrangers.[278] Il est important
également de reconnaître que les organisations de gestion collective ont le
potentiel d’exercer un pouvoir significatif sur le marché et d’agir de manière
anticoncurrentielle. Cette question est particulièrement préoccupante dans les
pays en développement dont les capacités institutionnelles et les cadres
réglementaires sont faibles.
En fin de compte, les pays en
développement devront se forger leur propre opinion des avantages de la
création d’organisations de gestion collective. Dans les pays en développement
possédant de grands marchés pour les produits de leurs industries du droit
d’auteur, au niveau national et international, la création de ces institutions
pourrait générer des avantages financiers en faveur des titulaires de droits
d’auteur. Dans d’autres pays, les avantages nets pour les citoyens du pays, par
opposition aux ressortissants de pays étrangers, signifient qu’il risque d’être
plus difficile d’en justifier les coûts. En tout cas, il semble impératif que
la totalité des coûts d’établissement et de fonctionnement de ces organisations
dans les pays en développement soient exposés avec transparence dès le départ
et qu’ils soient assumés par les titulaires des droits d’auteur en leur qualité
de bénéficiaires directs. En outre, il ne devrait sans doute être créé aucune
organisation de gestion collective à moins que des tribunaux spécialisés dans
le droit d’auteur et la concurrence, et fonctionnant régulièrement, ne puissent
être établis simultanément.
Bien que les avantages potentiels
du développement d’industries du droit d’auteur dans certains pays en
développement puissent être attirants dans certains cas, il est difficile de ne
pas conclure, d’après les témoignages de l’ensemble du monde en développement,
que les impacts négatifs du renforcement de la protection du droit d'auteur
seront sans doute plus immédiats et significatifs pour la majorité des pauvres
du monde. Aujourd’hui, il existe un « écart du savoir » énorme entre
les pays les plus riches et les plus pauvres. Ainsi que l’a observé la Banque
mondiale :
« Si l’écart se creuse, le monde sera encore plus
divisé non seulement par la disparité des ressources financières et autres,
mais aussi par les inégalités face au savoir. Les capitaux et autres ressources
se dirigeront de plus en plus vers les pays où le patrimoine de connaissances est
plus solide, aggravant le retard. Les disparités risquent aussi de s'accentuer
à l'intérieur même des pays, surtout en développement, où une élite fortunée
file sur les autoroutes de l’information, alors que le reste de la population
est prisonnier de l’analphabétisme. Mais inversement, si l’on parvient à
corriger ces décalages et ces imperfections, ... les revenus et niveaux de vie
pourraient s’améliorer beaucoup plus vite qu’on ne le pense. »[279]
A long terme, le renforcement de
la protection du droit d’auteur pourrait contribuer à stimuler les industries
culturelles locales des pays en développement, si d’autres conditions
influençant le succès de ces industries sont également satisfaites. Mais à
court et moyen termes, ce renforcement réduira sans doute la capacité des pays
en développement et des populations pauvres à réduire cet écart en obtenant à
un coût abordable les manuels, les informations scientifiques et les logiciels
informatiques dont ils ont besoin.
LES REGLES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR PERMETTRONT-ELLES
AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT DE REDUIRE L'ECART DU SAVOIR ?
En théorie, les règles
internationales relatives au droit d’auteur devraient permettre de résoudre les
problèmes d’accès car elles accordent aux pays la faculté d’inclure dans
leur législation nationale, dans certains cas, des exemptions et des
assouplissements du droit d’auteur. Ainsi, les articles 9 et 10 de la
Convention de Berne donnent aux pays la faculté de permettre la reproduction
sans autorisation d’œuvres protégées, dans certaines limites et à certaines
fins définies dans la législation nationale, comme l’enseignement, la recherche
et l’usage personnel, pour autant que cette reproduction ne porte pas atteinte
à l’exploitation normale de l’œuvre par le titulaire du droit d’auteur (voir
Encadré 5.1).
Encadré 5.1 Utilisation
équitable (« Fair Use » et
« Fair Dealing ») à l’ère
numérique
Dans le cadre de l’équilibre entre les droits exclusifs des
auteurs, artistes et autres créateurs d’une part, et l’objectif social de
grande diffusion du savoir d’autre part, les règles internationales relatives
au droit d’auteur autorisent les pays à imposer des limites au droit
d’interdire l’utilisation et la reproduction
non autorisées dans certains cas prescrits. Ainsi, l’article 9 alinéa 2 de la
Convention de Berne stipule : « Est
réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la
reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle
reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne
cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. »
Par conséquent, dans la plupart des pays, les lois
nationales sur le droit d’auteur intègrent des exceptions portant sur la
reproduction à des fins personnelles, de recherche, d’enseignement,
d’archivage, d'utilisation par les bibliothèques et de journalisme, sur le
fondement des principes de l’utilisation équitable (théorie du « fair dealing » au Royaume-Uni et du
« fair use » aux
Etats-Unis). La portée, la force et la souplesse de ces exceptions varient
grandement d’un pays et d’une région à l’autre, en partie du fait des
divergences entre les doctrines nationales, mais elles se concentrent
généralement sur les conditions suivantes :
·
L’objet
et le caractère de l’utilisation – la reproduction doit être destinée à des
fins personnelles et non commerciales. Une seule copie ou un petit nombre de
copies seulement est autorisé.
·
La
part de l’œuvre qui est reproduite – seules les copies partielles de l’œuvre
sont autorisées. La reproduction d'œuvres intégrales n’est permise que lorsque
aucun original n’est disponible sur le marché.
·
Seule
la reproduction par reprographie est généralement autorisée pour les œuvres sur
support papier. Une certaine liberté est
également accordée concernant la reproduction d’œuvres en format électronique,
par exemple, pour la programmation d’émissions télévisées ou l’archivage de
logiciels informatiques.
·
S’il
existe des exemptions en faveur des bibliothèques et archives, ces institutions
doivent être accessibles au public et s’abstenir d’activités commerciales.
·
L’intérêt
légitime du titulaire du droit doit être pris en compte – l’effet sur le marché
potentiel de l’œuvre.
Toutefois, le développement et la
diffusion de la technologie numérique permettent maintenant la création non
autorisée de copies illimitées, parfaites et gratuites, et la distribution mondiale presque instantanée d’œuvres
protégées. Les industries du droit d’auteur
réagissent en utilisant la technologie numérique, sous forme de cryptage
et de mesures de lutte contre le contournement, complétée par le droit des
contrats et des formes de protection sui
generis de la propriété intellectuelle des bases de données. Leurs
opposants avancent que ces mesures limitent de fait l’utilisation équitable et
pourraient réduire la capacité des enseignants, étudiants, chercheurs et
consommateurs à accéder à l’information,
dans les pays en développement notamment. A ce sujet, de nouvelles approches
sont nécessaires pour assurer que les exceptions adéquates au titre de
l’utilisation équitable puissent être préservées dans ce contexte numérique.[280]
En 1967, lors de la Conférence de
Stockholm de la Convention de Berne, les pays en développement ont présenté des
arguments en faveur d’un assouplissement des règles internationales relatives
au droit d’auteur, en raison de leurs besoins en matière d’éducation de masse.
La Conférence a produit un Protocole permettant aux pays en développement de
prévoir une durée de protection inférieure (25 ans), ainsi que des licences
obligatoires sur les œuvres pour leur traduction dans la langue locale et, ce
qui est particulièrement controversé, pour toute utilisation protégée à des
fins éducatives, scientifiques ou de recherche. Mais le Protocole de Stockholm
n’a jamais été ratifié à défaut de consensus entre les pays développés et en
développement. Finalement, les pays sont parvenus à un accord en 1971, à Paris,
sur une série allégée d’exemptions pour les pays en développement, leur donnant
principalement la faculté d’imposer, dans certaines limites, des licences
obligatoires sur les œuvres pour leur traduction dans la langue locale. Ces
exemptions sont exposées dans l’Annexe de la Convention, mais ont produit très
peu d’avantages directs dans les pays en développement, comme l’illustre le
fait que seuls quelques pays en développement aient transposé ces dispositions
spéciales dans leur législation nationale.[281]
Il est
essentiel de savoir si les exemptions et limitations existant dans le cadre
actuel des règles internationales donnent aux pays en développement la faculté
d’établir un juste équilibre entre la protection du droit d’auteur et la
satisfaction de leurs besoins particuliers en matière de développement. On peut
certainement en douter. Comme l’a dit un expert reconnu du droit d’auteur
international :
« Lorsqu’un pays en développement décide de s’engager
dans des relations internationales relatives au droit d’auteur, il observera
généralement qu’un écart subsiste entre ce qui est nécessaire pour répondre à
ses besoins [en matière d’éducation et de transfert du savoir] et les normes de
protection exigées par un acte multilatéral comme la Convention de
Berne. »[282]
En réalité, nos consultations
avec les parties prenantes et la lecture des éléments probants suggèrent que
ces questions sont particulièrement sérieuses en ce qui concerne l’accès au
matériel éducatif, lorsque la demande n’est pas satisfaite par les industries
locales de l’édition ou par les programmes financés par des bailleurs de fonds,
et l’accès aux logiciels informatiques, condition préalable de l’accès à
l’information et de la compétitivité dans l’économie mondiale. L’arrivée de
l’ère numérique offre aux pays en développement de grandes opportunités d’accès
à l’information et au savoir. A titre d’exemple, nous citerons le développement
de bibliothèques et d’archives numériques, de programmes d’enseignement à
distance basés sur l'Internet, et la faculté des scientifiques et chercheurs à
accéder en temps réel à des bases de données informatisées scientifiques
complexes comprenant des informations techniques. Cependant, l’avènement de
l’ère numérique présente également des menaces nouvelles et graves pour l’accès
au savoir et sa diffusion. En particulier, il existe un risque réel que le
potentiel de l’Internet dans le monde en développement ne se réalise pas car
les titulaires de droits utilisent la technologie pour interdire l’accès public
au moyen de systèmes de paiement à la séance.
INDUSTRIES
DU DROIT D’AUTEUR ET REPRODUCTION D’ŒUVRES PROTEGEES
Comme nous l’avons observé au
début de ce chapitre, les industries du droit d’auteur comme l’édition et les
logiciels informatiques jouent un rôle majeur dans l’économie mondiale fondée
sur le savoir, et les produits et services qu’elles offrent jouent un rôle
central dans l’encouragement de l’innovation et du développement social et
économique en général. Le succès de ces industries est illustré par leur
croissance extraordinaire, qui a produit des millions d’emplois bien payés et
des milliards de recettes, y compris dans certains pays en développement.
L’industrie des logiciels informatiques est également en elle-même une source
très importante d’innovation et ses participants se targuent d’avoir apporté
d’énormes gains de performance et de fonctionnalité à de nombreux produits
logiciels commerciaux de ces dix dernières années environ, tandis que leurs
prix sont restés stables ou ont même baissé.
Des représentants de ces
industries nous ont signalé l’importance des lois sur le droit d’auteur et
d’une bonne protection contre la reproduction non autorisée pour encourager les
investissements dans la créativité et l’innovation, ainsi que dans le
développement de produits et technologies. L’échelle de ces investissements
dans le développement d’œuvres créatives et leur mise sur le marché est sans
aucun doute considérable. Par exemple, selon l’Association des éditeurs
britanniques (Publishers’ Association),
600 000 livres environ sont actuellement disponibles au Royaume-Uni. Cela
représente une source de savoir extrêmement utile pour les industries
innovantes et la société au sens large. Et bien entendu, les industries doivent
pouvoir récupérer ces investissements pour financer de nouvelles générations de
produits fondés sur le savoir. Ainsi, par exemple, l’industrie des logiciels informatiques
avance que la facturation de droits de licence pour ses produits permet aux
sociétés de produire des bénéfices qui financeront la R&D future.
La prévention de la reproduction
non autorisée a toujours été le principal objectif sous-tendant le développement
des règles internationales relatives au droit d’auteur, ce qui reste vrai
aujourd’hui. La reproduction non autorisée d’œuvres protégées par le droit
d’auteur (généralement décrite de manière péjorative comme de la
« piraterie » par les titulaires de droits d’auteur) existe depuis
longtemps et demeure un phénomène international, aussi bien dans le monde
développé que dans les pays en développement. Les Etats-Unis, par exemple, ont
justifié leur refus persistant d’accorder une protection par le droit d’auteur
à des auteurs étrangers au XIXe siècle par la nécessité de répondre
aux besoins de la nation en matière de savoir et de connaissance. Nous avons
également noté avec intérêt que, bien que selon l’industrie, c’est dans
certains pays en développement et certaines économies en transition que les
taux actuels de reproduction non autorisée sont les plus élevés,[283]
les pertes financières les plus importantes des titulaires de droits
proviennent encore des pays développés, car la taille de leur marché est bien
plus grande.[284] L’arrivée
de l’ère numérique a fait craindre aux industries du droit d’auteur de ne plus
pouvoir vendre « qu’un seul exemplaire » des nouveaux livres
électroniques, films sur DVD, CD de musique ou programmes d'ordinateur avant
qu’ils soient reproduits illicitement, parfaitement et gratuitement, et
puissent être aisément distribués dans le monde entier par l'intermédiaire des
réseaux informatiques et de l'Internet.
Dans le passé toutefois, les
données factuelles signalent que les faibles niveaux de respect du droit
d’auteur ont eu un impact majeur sur la diffusion dans l’ensemble du monde en
développement du savoir et des produits fondés sur le savoir dans certains
domaines, comme les logiciels informatiques. En effet, on peut avancer que de
nombreuses personnes pauvres des pays en développement n’ont pu avoir accès à
certaines œuvres protégées par le droit d’auteur qu’en ayant recours à des
copies non autorisées, disponibles à une fraction du prix de l'original. Nous
craignons donc que l’un des effets non intentionnels du renforcement de la
protection et du respect des règles internationales relatives au droit
d’auteur, ainsi que l'exige, autre autres, l’Accord sur les ADPIC, soit
simplement la réduction de l’accès aux produits fondés sur le savoir dans les
pays en développement, avec des conséquences préjudiciables pour les pauvres.
En réponse à cette préoccupation,
des représentants des industries du droit d’auteur mentionnent les initiatives
spéciales qu’ils mettent en œuvre en faveur des pays en développement, comme
les programmes de dons et les éditions « à bas prix » de livres et
programmes d'ordinateur pour les utilisateurs sensibles aux coûts. Ils
considèrent cette démarche comme la voie du futur, de préférence à un affaiblissement
des règles internationales relatives au droit d’auteur et/ou des mesures de
respect dans le monde en développement. Par exemple, l’industrie de l’édition
soutient à présent un nombre croissant d’initiatives visant à améliorer l’accès
abordable aux livres et périodiques dans les pays en développement et à créer
des partenariats avec les éditeurs des pays moins avancés pour encourager le
développement d’industries locales de l’édition.[285]
De la même manière, dans l’industrie des logiciels informatiques, une grande
société de logiciels met gratuitement plusieurs de ses produits logiciels à la
disposition des 32 000 écoles publiques d’Afrique du Sud. Cette société
aide ainsi les élèves et les enseignants sud-africains à acquérir des
compétences informatiques, tout en contribuant au développement de ses futurs
marchés.
Mais en définitive, les sociétés
commerciales sont responsables devant leurs actionnaires. Ce ne sont pas des
organismes caritatifs et ce n’est pas leur objet. Les sociétés estiment donc
que ce sont les pouvoirs publics des pays développés et les organismes de
développement qui doivent répondre aux besoins des pays en développement
concernant l’accès subventionné à des œuvres protégées par le droit d’auteur à
un prix abordable, nécessaire pour satisfaire leurs exigences en matière
d’éducation et de transfert du savoir. Comme l’ont observé un rapport présenté
au Parlement britannique en 1977 et une décision récente du tribunal
britannique compétent en matière de droit d’auteur (UK Copyright Tribunal), personne n’a encore suggéré que les
fabricants de blocs-notes, compas ou règles doivent les fournir gratuitement
aux établissements scolaires.[286]
Dans ce cas, pourquoi les industries du droit d’auteur devraient-elles tolérer
la reproduction non autorisée à grande échelle de leurs livres, revues,
logiciels informatiques ou bases de données scientifiques ?
Nous avons étudié ces arguments
minutieusement. Nous reconnaissons les mérites des initiatives volontaires
entreprises par l’industrie en faveur des pays en développement et nous
estimons que davantage d’efforts pourraient être faits dans ce domaine. De
manière plus générale, nous ne sommes pas convaincus, sur le fondement de nos
observations dans différents pays en développement, que, même du point de vue des
titulaires de droits d’auteur, la politique de prix des produits soit optimale.
Dans la mesure où la reproduction, notamment à l’échelle commerciale, est
poussée par le rapport entre le prix de vente et le coût de production des
copies, il doit bien exister une marge de manœuvre permettant l’utilisation de
prix plus différenciés dans les pays en développement sans réduire les
bénéfices, voire même en augmentant les revenus des industries productrices. Le
fait que les éditeurs soient prêts à soutenir divers programmes d’accès à
faible coût ou gratuit aux publications en ligne en faveur des institutions des
pays en développement indique qu’ils reconnaissent la possibilité de prix
différenciés, assortis des garde-fous correspondants. Si nous admettons tout à fait
que les titulaires de droits d’auteur sont fondés à l’obtention d’un retour
approprié sur leur investissement, comme c’est le cas dans les autres
industries, nous estimons que du point de vue de la politique publique
générale, il est tout aussi important en définitive de veiller à ce que les
populations des pays en développement aient un meilleur accès au savoir, que de
veiller à ce qu’elles aient accès à d’autres éléments essentiels au
développement comme la nourriture, l’eau et les médicaments. Nous ne sommes pas
certains que les éditeurs et les producteurs de logiciels aient trouvé le juste
équilibre pour faciliter l’accès dans les pays en développement tout en
s’acquittant de leurs obligations envers leurs actionnaires.
Les
éditeurs de livres et périodiques, disponibles sur support papier et en ligne,
et les producteurs de logiciels devraient revoir leurs politiques de fixation
des prix pour aider à réduire le nombre de copies non autorisées et pour
faciliter l’accès à leurs produits dans les pays en développement. Les
initiatives prises par des éditeurs pour élargir l’accès à leurs produits dans
les pays en développement sont louables, et nous encourageons leur extension.
Elargir les initiatives permettant aux pays en développement d’avoir un accès en
ligne gratuit à toutes les revues scientifiques est un bon exemple de ce qui
pourrait être réalisé.
DROIT D'AUTEUR ET ACCES
Matériel
éducatif
Ces dernières années, on a
assisté à l’expansion bienvenue de l’enseignement primaire et secondaire dans
les pays en développement et à une concentration, à juste titre, de l’aide sur
ces secteurs. S’il reste de grands défis à relever pour atteindre l’objectif de
« l’éducation pour tous », les pays en développement et leurs
partenaires bailleurs de fonds font des progrès significatifs.[287]
L’accès aux livres et matériels de lecture aux niveaux primaire et secondaire
s’est également amélioré dans certains pays. Ce progrès est le résultat d’une
augmentation des niveaux de dépenses publiques pour l’enseignement primaire et
des programmes internationaux de dons de livres, comme Book Aid International.
Il faut aussi noter que, dans certains pays, cette progression est également
due à la capacité des industries locales de l’édition, bien que souvent
embryonnaires, à produire à faible coût des livres de classe et du matériel de
lecture.[288]
Toutefois, l’accès aux livres et
aux matériels pédagogiques reste un vrai problème dans beaucoup de pays en
développement. En 1999, une étude réalisée par l’Association pour le Développement
et l’éducation en Afrique (ADEA), consortium de bailleurs de fonds et de pays
en développement, a révélé que les pénuries de livres pertinents à faible coût,
à usage scolaire et en dehors de l’école continuent à entraver la fourniture
d’un enseignement de qualité. En effet, les conclusions de l’étude de l’ADEA
dressent un tableau très déprimant :
« L’accès inégal aux matériels
éducatifs, des ratios livres/élève excessivement faibles et l’insuffisance de
matériels de lecture continuent de prédominer. Les éditeurs africains restent
désavantagés dans un contexte économique qui tend à favoriser l’importation de
livres étrangers au détriment des ouvrages publiés au niveau des pays. »[289]
Mais l’accès aux livres et
matériels est également important dans d’autres segments du système éducatif.
Les pays en développement ont besoin de personnels qualifiés, comme des
médecins, des infirmiers, des avocats, des scientifiques, des chercheurs, des
ingénieurs, des économistes, des enseignants et des comptables. En l’absence de
personnel compétent dans ces professions et de systèmes d'éducation et de
formation tout au long de la vie, les pays en développement seront moins à
mêmes d’absorber les nouvelles technologies, d’engendrer des innovations et de
se montrer compétitifs dans l’économie mondiale fondée sur le savoir. Par
exemple, même si les pays en développement peuvent obtenir des médicaments bon
marché, ils auront quand même besoin de médecins et infirmiers qualifiés pour
les administrer correctement afin de sauver des vies.
Cependant, dans bon nombre de
pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne, le secteur de
l’enseignement supérieur a plongé à des niveaux auxquels il ne pourra bientôt
plus assurer de bases minimales d’enseignement et de recherche, et ce au moment
d’une croissance de la demande d’admissions d’étudiants en premier cycle.[290]
Comme de nombreux pays en développement dépensent déjà une part significative
de leur produit national brut (PNB) pour l’éducation, ils peuvent avoir du mal
à trouver les ressources supplémentaires nécessaires pour simplement maintenir
les niveaux actuels d’inscriptions dans l’enseignement tertiaire, sans même
parler d’améliorer sa qualité. Il est clair que le droit d’auteur n'est pas la
seule question à laquelle est confrontée la faible infrastructure tertiaire,
mais le prix élevé des livres et matériels et l’accès limité aux ressources
basées sur l’Internet restent des éléments importants d’une crise qui va en
empirant.
Dans l’enseignement tertiaire,
les éléments probants indiquent que l’accès aux livres et aux autres matériels
éducatifs et de recherche reste un problème crucial pour beaucoup de pays en
développement, en particulier pour les plus pauvres. La plupart des pays en
développement restent très tributaires des manuels et ouvrages de référence
importés, car la pénétration de ce secteur est rarement viable sur le plan
commercial pour les éditeurs locaux en difficulté. Le prix de ces livres
dépasse les moyens de la plupart des étudiants.
Bibliothèques
Les bibliothèques universitaires
devraient jouer un rôle clé pour soutenir la recherche et assurer aux étudiants
pauvres des pays en développement l’accès aux livres, périodiques et matériels
en ligne protégés par le droit d’auteur, mais elles sont généralement en très
mauvais état. Les organismes bailleurs de fonds ont offert à plusieurs pays un
financement pour moderniser les bibliothèques et reconstituer leurs stocks,
dont la fourniture d’une connectivité Internet et d’installations de
photocopie.[291]
Davantage d’assistance de ce type est nécessaire de toute urgence. Mais les
systèmes des bailleurs de fonds sont tout simplement trop lents et
bureaucratiques pour permettre aux bibliothèques de tenir à jour les
collections de manuels. En général, la situation des bibliothèques
universitaires des pays en développement les plus pauvres reste très mauvaise[292],
en Afrique notamment, ainsi que l’a observé un récent rapport de
l’UNESCO :
« Toutefois, la détérioration de la situation
économique des pays africains depuis une décennie environ a eu des conséquences
désastreuses sur la qualité des services de bibliothèque dans les institutions
universitaires, qui sont presque toutes financées par les pouvoirs publics. La
plupart ne sont plus en mesure d’acheter de nouveaux ouvrages et ont dû mettre
fin à une grande partie de leurs abonnements à des périodiques. Incapables, par
ailleurs, d’adopter les nouvelles technologies de l’information, les
bibliothèques universitaires africaines, en particulier, et les universitaires
africains, en général, font face à un avenir des plus sombres. »[293]
Nos consultations ont également
révélé que les bibliothèques universitaires des pays en développement dotés de
meilleures ressources, comme l’Afrique du Sud, ont parfois de grandes
difficultés à obtenir l’affranchissement des droits d’auteur et à payer des
redevances sur les matériels dont ont besoin les enseignants et les étudiants.
Les données factuelles que nous avons examinées indiquent que même ces
bibliothèques mieux financées ont dû considérablement réduire leurs abonnements
aux revues universitaires en raison des coûts élevés du maintien à jour de
leurs collections. En fait, même les bibliothèques dotées de bonnes ressources
dans les pays développés connaissent des difficultés extrêmes pour continuer à
stocker la gamme complète des revues qu’attendent leurs enseignants et
étudiants. Dans les pays développés, l’augmentation rapide des prix
d’abonnement des revues universitaires et la concentration en cours de
l’industrie de l’édition ont nourri un débat actif sur la manière dont les
chercheurs peuvent préserver l’accès aux matériels dont ils ont besoin et sur
le développement de modèles alternatifs d’édition en ligne comme BioMed
Central.[294]
Mais les pays en développement
ont également besoin d’une plus grande liberté pour assouplir les règles
internationales relatives au droit d’auteur, afin de répondre à leurs besoins
en matière d’éducation et de recherche. Comme nous l’avons déjà mentionné, les
participants à la Conférence de Stockholm ont proposé une série de
modifications de la Convention de Berne en 1967. Les pays développés ont rejeté
ces propositions car ils estimaient qu’elles imposaient des limitations trop
radicales à la protection par le droit d’auteur. En examinant les pièces trente
ans plus tard, il nous semble clair que les dispositions particulières
concernant les pays en développement qui ont été ajoutées à la Convention de
Berne en 1971 (dans son Annexe) n’ont pas été efficaces. De nouvelles réformes
sont donc nécessaires, et différentes mesures joueront un rôle plus ou moins
important selon les besoins particuliers de chaque pays. Comme l’a dit un
commentateur :
« Dans
certains cas, l’accès aux livres et revues scientifiques à des prix
subventionnés pour une période limitée serait d’une grande aide. Dans d’autres,
les éditeurs locaux dont les marchés sont limités ont besoin d’un accès facile
et bon marché à des livres étrangers afin de les faire traduire dans la langue
locale. Dans un contexte différent, l’autorisation de réimprimer des livres des
pays industrialisés en langue originale est nécessaire pour satisfaire une
population autochtone lisant l’anglais ou le français, mais incapable de payer
le coût élevé des livres importés. Et dans certains pays, la plupart des
éléments d’une industrie autochtone de l’édition font défaut et une
reconstruction totale est nécessaire. Le droit d’auteur peut ne pas être le
facteur crucial de toutes ces situations, mais il joue un rôle. »[295]
Afin
d’améliorer l’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur et de réaliser
leurs objectifs en matière d’éducation et de transfert des connaissances, les
pays en développement devraient adopter des mesures en faveur de la concurrence
dans leur législation sur le droit d’auteur. Ils devraient être autorisés à
conserver ou à adopter dans leur législation nationale sur le droit d’auteur de
larges exemptions applicables aux utilisations dans l’enseignement, la
recherche et les bibliothèques. Avant d’appliquer les normes internationales du
droit d’auteur dans le monde en développement, il faudra apprécier à sa juste
mesure la nécessité constante d’améliorer disponibilité de ces produits et leur
importance cruciale pour le développement social et économique.
DROIT D’AUTEUR ET LOGICIELS INFORMATIQUES
Comme d’autres l’ont observé, il
existe une fracture numérique entre les pays développés et le monde en
développement. Dans l’économie mondiale fondée sur le savoir, les technologies
informatiques sont une condition essentielle pour accéder aux informations et
les utiliser, accélérer les transferts de technologie et stimuler la croissance
de la productivité. Parallèlement, les produits logiciels informatiques sont
peut-être les plus protégés de toutes les formes de produits fondés sur le
savoir. Aux termes de l’Accord sur les ADPIC, les programmes d'ordinateur
peuvent maintenant bénéficier de la protection par le droit d’auteur, comme
toute autre œuvre littéraire, ainsi que d’autres formes de protection de la PI,
dont les brevets dans certains pays comme les Etats-Unis.
Les pays en développement, bien
entendu, ont des besoins divers d’applications logicielles informatiques dans
leurs industries, hôpitaux, écoles et services administratifs. Mais le plus
souvent, ils ont besoin d’un accès à un prix abordable aux progiciels de
gestion prêts à l’emploi, comme les produits de traitement de texte, les
tableurs, la messagerie électronique et la navigation sur l’Internet. Les
sociétés européennes et nord-américaines, Microsoft étant l’intervenant
principal, dominent le marché mondial de ces produits. Les industries du
logiciel des pays en développement, même en Inde, sont quasiment absentes du
secteur des programmes d'ordinateur prêts à l’emploi.[296]
Dans l’industrie des logiciels
informatiques, le droit d’auteur est tout particulièrement important pour le
secteur des applications de gestion prêtes à l'emploi. A la différence des
applications logicielles personnalisées, ces produits s’adressent à un marché
de masse et peuvent être facilement reproduits. La protection du droit d’auteur
permet aux sociétés d’interdire la reproduction, de limiter la concurrence et
de facturer des prix monopolistiques pour ces produits. Dans les pays en
développement, cela pose deux problèmes principaux.
En premier lieu, comme la
reproduction généralisée s’accompagne actuellement d’un pouvoir d’achat faible
dans les pays en développement, on craint que le renforcement de la protection
et du respect du droit d’auteur entraîne une diffusion plus limitée de ces
technologies. Ce risque peut être particulièrement aigu en raison des effets de
réseau des applications de gestion, qui ont tendance à renforcer la domination
des produits logiciels existants. En examinant les éléments probants toutefois,
nous concluons que ce problème n’est pas insurmontable pour les pays en
développement, si les mesures appropriées sont prises. Par exemple, les
gouvernements et les organismes bailleurs de fonds pourraient revoir leurs
politiques d’acquisition de logiciels en vue d’accorder une plus grande
attention aux produits logiciels de gestion à faible coût, y compris les
produits génériques et libres (« open source ») qui sont largement disponibles.[297]
Le second
problème est que la protection du code source du logiciel peut rendre plus
difficile l’adaptation des produits aux besoins locaux. Elle peut également
restreindre la concurrence en matière de développement d’applications
interopérables par l’innovation ultérieure utilisant l'ingénierie inverse. En
vertu de l’Accord sur les ADPIC, les pays en développement ont la faculté
d’autoriser l'ingénierie inverse des logiciels, aussi ce problème peut-il être
évité si les lois nationales sur le droit d’auteur sont rédigées en
conséquence. Une autre mesure pratique pourrait être envisagée :
l’utilisation plus généralisée des divers produits logiciels libres[298], dont le code source est mis à disposition, à
la différence des logiciels propriétaires.[299]
Ou bien encore, certains membres de l’industrie avancent que le renforcement du
respect du droit d’auteur pourrait inciter les concepteurs de logiciels
propriétaires non libres à mettre le code source à la disposition des
concepteurs de logiciels des pays en développement.
Il ne relève clairement pas de
notre compétence de recommander le type de politiques que les pays en
développement devraient suivre en matière d’acquisition de logiciels
informatiques. Ainsi, si les logiciels à faible coût ou libres offrent a priori
des avantages en termes de coûts et autres par rapport aux logiciels
propriétaires, de nombreux facteurs extérieurs aux droits de licence logicielle
influent sur le coût total d’un système informatique, comme l'adaptation du
système aux besoins spécifiques de l’utilisateur, ainsi que l’entretien et la
maintenance du système. Cela dit, compte tenu des besoins considérables des pays
en développement en matière de technologies de l’information et de la
communication et des fonds limités disponibles, il semblerait raisonnable que
les gouvernements et bailleurs de fonds envisagent de soutenir des programmes
visant à accroître la notoriété des options à faible coût, dont les logiciels
libres, dans les pays en développement.
Les pays en développement et leurs
partenaires bailleurs de fonds devraient réexaminer les politiques
d’acquisition des logiciels informatiques, en vue de veiller à ce que soient
correctement prises en compte les options d’utilisation de produits logiciels à
faible coût et/ou libres (« open source ») et à ce que leurs coûts et avantages
soient évalués avec soin. Les pays en développement devraient faire en sorte que
leur législation nationale sur le droit d’auteur autorise l'ingénierie inverse
des logiciels au-delà des exigences d’interopérabilité, selon des modalités
compatibles avec les traités internationaux pertinents qu’ils ont signés en
matière de PI.
REALISER LE POTENTIEL DE L’INTERNET POUR LE DEVELOPPEMENT
Nous avons des raisons d’espérer
que la révolution des technologies de l’information a le potentiel d’augmenter
l’accès à l’information et au savoir dans les pays en développement. Les
progrès rapides de deux technologies fondamentales – le stockage/traitement
numérique de l’information et les communications par satellite/fibre optique –
créent des moyens plus rapides et moins chers d’accéder au savoir et de
l’utiliser dans le monde entier. La croissance de l’Internet en est un exemple
parfait. Au milieu de 1993, il existait moins de 200 sites web sur l’Internet,
mais fin 2000 on en recensait 20 millions ; et le nombre
d’utilisateurs de l’Internet devrait atteindre un milliard d’ici 2005, bien
que la plupart d'entre eux se trouveront toujours dans les pays développés
(PNUD 2001). Le Tableau 5.1 illustre les contrastes frappants en matière
d’utilisation de l’Internet entre les pays développés, en développement et les
moins avancés.
Tableau
5.1 Connectivité Internet dans le monde développé et en développement en 2000
|
|
Utilisateurs
de l’Internet
(millions)
|
Population
(millions)
|
Utilisateurs
de l’Internet par 10 000 personnes
|
|
Pays développés
|
253,2
|
860
|
2 944
|
|
Pays en
développement
|
107,0
|
4 500
|
238
|
|
Pays les moins
avancés
|
0,7
|
780
|
9
|
|
Total
|
360,9
|
6 140
|
588
|
Source :
UIT (2001), cité dans Story (2002), Annexe 4
La croissance de l’Internet offre
de vraies opportunités d’amélioration de l’accès au savoir et de son transfert
pour les pays en développement. Par exemple, la taille et le nombre croissants
des bibliothèques numériques créent des types d’accès, jamais vus auparavant, à
toutes les informations publiées n’importe où dans le monde. A l’avenir, les
pays en développement pourraient être mesure de construire un réseau numérique
national pour offrir à tous les villages isolés l’accès aux ressources des
bibliothèques du monde entier, comme c’est le cas en Australie.[300]
De la même manière, des initiatives comme l’Université virtuelle africaine
(UVA) démontrent le potentiel de l’Internet en tant qu’outil et ressource
d’enseignement à distance dans le monde en développement. Depuis son lancement
en 1997, plus de 24 000 étudiants de 17 pays africains ont suivi
des cours d’un semestre en technologie, ingénierie, commerce et sciences par
l’intermédiaire de l’UVA. L’Université offre également aux étudiants l’accès à
une bibliothèque numérique en ligne comprenant plus de 1 000 revues
en texte intégral et le site web de l’UVA reçoit actuellement plus d’un million
de visiteurs par mois.[301]
Restrictions technologiques
Mais ces
évolutions technologiques menacent également l’accès au savoir et aux
technologies et leur diffusion. Il existe une tendance croissante au sein des
industries de l’édition et du logiciel à la distribution de contenus en ligne
assortis de restrictions d’accès appliquées au moyen de systèmes de gestion des
droits numériques, comme les technologies de cryptage. Cette forme sophistiquée
de protection technologique révoque les droits traditionnels d’« utilisation
équitable » portant sur la consultation, le partage ou la réalisation de copies
privées d’œuvres numériques protégées par le droit d’auteur, puisque ces œuvres
pourraient être inaccessibles sans paiement, même pour des usages légitimes.
Pour les pays en développement, où la connectivité Internet est limitée et où
les abonnements à des ressources en ligne sont d'un prix inabordable, cette
protection peut exclure entièrement l’accès à ces matériels et imposer une
lourde charge qui retardera la participation de ces pays à la société mondiale
fondée sur le savoir.
En termes de
rapports entre cette tendance et les règles de PI et le potentiel de l’Internet
pour le développement, trois facteurs sont particulièrement importants pour les
pays en développement.
Premièrement,
le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur établit de nouvelles règles qui
pourraient bientôt devenir la norme internationale.[302] Il clarifie les droits
exclusifs des titulaires de droits d’auteur sur les matériels en ligne et
enjoint expressément aux pays d’offrir des recours juridiques efficaces contre
le contournement des mesures de protection technologique restreignant les types
d’accès non autorisés par le titulaire du droit d’auteur ou par la législation
nationale. En avril 2002, 35 pays avaient ratifié le Traité, dont le
Burkina Faso, le Mali et le Gabon. Dans ce domaine, la préoccupation majeure
est que des pressions pèseront sur les pays en développement, par exemple dans
le cadre d’accords bilatéraux avec des pays développés (voir le Chapitre 8),
les incitant à adhérer au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ou même à
adopter des interdictions plus strictes contre le contournement des systèmes de
protection technologique, réduisant ainsi de fait la portée du principe
traditionnel d’utilisation équitable des médias numériques.
Aux Etats-Unis,
la loi du millénaire sur le droit d’auteur numérique (DMCA) de 1998 a transposé
le Traité de l’OMPI, mais l’a dépassé. En particulier, cette loi donne un bon
coup de pouce à l’utilisation de la protection technologique en rendant illégal
le contournement de la protection technologique utilisée par les éditeurs, ou
le développement et la distribution de dispositifs à cet effet. Ces actes sont illégaux, même pour des
utilisations qui jusque-là n’auraient pas constitué une atteinte à un droit
d’auteur (ce qui n’est pas le cas du Traité de l’OMPI). Ces dispositions
compromettent gravement les principes d’utilisation équitable établis aux
termes du droit d’auteur, ainsi que le principe de première vente. Pour les
livres, la revente à autrui est autorisée librement ; la protection
technologique pourrait interdire les actes équivalents concernant les contenus
numériques. Enfin, la protection technologique est à durée illimitée, tandis
que le droit d’auteur est limité dans le temps (même si la période de
protection semble constamment augmenter).
Deuxièmement,
certains segments des industries des « contenus » demandent aux
gouvernements d’adopter des législations exigeant que les fabricants de
technologies informatiques intègrent des mécanismes visant à interdire la
reproduction non autorisée des œuvres numériques. Par exemple, Michael Eisner,
président-directeur général de la société Walt Disney, a affirmé dans un
article paru dans le Financial Times
le 25 mars 2002 que :
« Nous sommes maintenant à la croisée des chemins.
L’objectif premier doit être que les créateurs de contenu et les créateurs de
technologie informatique se réunissent pour convenir de technologies
appropriées afin d’empêcher la reproduction et la transmission non autorisées
de matériels protégés par le droit d’auteur. Le gouvernement américain doit
jouer un rôle important, en fixant un délai raisonnable à l’expiration duquel,
si aucun progrès n’a été réalisé, il interviendra pour ordonner la
rédaction de normes technologiques visant à protéger contre les exploitations
illicites les œuvres protégées par le droit d’auteur. »
Troisièmement, en ce qui concerne
spécifiquement les bases de données électroniques scientifiques ou techniques,
il est possible que les pays en développement soient encouragés à adopter un
régime spécial de protection de la PI, outre la protection limitée déjà offerte
aux termes de l’Accord sur les ADPIC et de la Convention de Berne (voir Encadré
5.2). Un tel régime de protection sui
generis a été introduit en 1996 dans les 15 pays de l’Union
européenne.[303] Le
fait que le régime applicable aux bases de données dans l’UE ne prévoit la
protection des étrangers que sur le fondement de la réciprocité a contribué à
la présentation au Congrès américain de propositions similaires depuis
plusieurs années (par exemple, le projet de loi de 1996 sur l’investissement
dans les bases de données et la lutte contre la piraterie en matière de
propriété intellectuelle (Database
Investment and Intellectual Property Anti-Piracy Act)). L’UE et les
Etats-Unis ont également déposé des propositions de traité international
portant sur la protection des bases de données à la Conférence diplomatique de
l’OMPI de 1996.
Encadré 5.2
Protection de la PI en matière de bases de données
Etant
donné la prolifération mondiale des services informatisés d’information, la
protection de la PI en matière de bases de données est une question très
importante pour la science, la recherche, l’innovation et la créativité. Les
progrès des technologies de l’information et de la communication ont fait des
bases de données numériques contenant des informations factuelles une ressource
essentielle pour accélérer la croissance du savoir et produire de nouvelles
découvertes. Et l’expansion de l’Internet facilite leur large diffusion et leur
utilisation. En même temps, les mêmes technologies rendent les utilisations non
autorisées et l’appropriation illicite de masse de ces bases de données
précieuses relativement simples. Ici, la question centrale est, d’une part,
l’obtention d’un équilibre entre apaiser les inquiétudes des créateurs de bases
de données concernant la fourniture d’incitations et protéger les
investissements dans de nouveaux produits et services de bases de données et,
d’autre part, protéger l’accès coutumier aux données qu’elles contiennent par
les utilisateurs des communautés scientifiques et éducatives et des
bibliothèques.
Dans
la plupart des pays, les bases de données sont éligibles pour une protection de
la PI au moyen de la législation relative aux marques et au droit d’auteur
(elles peuvent également être protégées de fait par des contrats entre les
utilisateurs de la base de données et le prestataire de service). Toutefois, la
protection des bases de données aux termes de la législation en matière de
droit d’auteur est limitée. La Convention de Berne protège les compilations ou
collections d’œuvres, mais ne parle pas de la protection des collections de
matériels autres que des œuvres elles-mêmes susceptibles d’être protégées par
le droit d’auteur. En 1991, dans la célèbre affaire Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., la Cour
suprême des Etats-Unis a refusé la protection à un annuaire téléphonique au
motif que la collecte de noms, d’adresses et de numéros de téléphone n’était
pas une œuvre de création originale.
Aux
termes du régime sui generis de l’UE,
introduit en 1996, les créateurs de bases de données ont le droit d’interdire
l’extraction de la totalité ou d’une partie substantielle des contenus des
bases de données pour une période de 15 ans, bien que la durée de cette
protection soit renouvelable lorsque des modifications substantielles sont
apportées (par exemple, l’ajout de nouvelles données). L’argument selon lequel
le régime de l’UE est conçu pour protéger l’investissement plutôt que
l’expression créative originale est appuyé par le fait que, pour bénéficier de
la protection, il suffit aux créateurs de démontrer qu’ils ont fait un
« investissement substantiel » dans le développement de la base de
données.
La numérisation et la possibilité
de communications mondiales instantanées à faible coût ont ouvert de nouvelles
opportunités immenses pour la diffusion et l’utilisation de bases de données
scientifiques et techniques dans les pays en développement, tout comme dans le
reste du monde. En fait, la capacité à accéder à des bases de données
existantes et à en extraire et recombiner des parties sélectionnées pour la
recherche est devenue un élément crucial du processus scientifique. Toutefois,
les entités commerciales du secteur privé propriétaires de bases de données
cherchent généralement à contrôler l’accès non autorisé à celles-ci de manière
à maximiser les revenus issus des abonnements, même lorsqu’une partie des
données qu’elles contiennent appartiennent au domaine public ou ont été
collectées au moyen de recherches financées par le secteur public. Nous
craignons donc principalement que le renforcement de la protection de la PI en
matière de bases de données au niveau international, tout en encourageant
davantage d’investissements dans de nouveaux produits et services de bases de
données commerciales, risque simultanément de beaucoup réduire l’accès des
scientifiques et chercheurs des pays en développement aux données qu’elles
contiennent, parce qu’ils n’auront souvent pas les moyens financiers de payer
les abonnements nécessaires.
Il est clair que les questions
entourant l’accès à l’information et au savoir sur l’Internet sont encore au
stade de l’émergence. A certains égards, elles n’ont qu’une importance
immédiate limitée dans de nombreux pays en développement, compte tenu de la
connectivité Internet limitée de ces nations. Toutefois, les questions liées à
l’Internet sont cruciales pour les universités et la recherche scientifique dans
le monde en développement et pourraient bientôt devenir centrales pour
l’enseignement secondaire, voire primaire, dans les pays en développement
puisque l’accès à l’Internet sera bien moins cher que la construction de
bibliothèques et la constitution de leurs stocks. L’Internet présente un
potentiel remarquable de développement et il est impératif que ce potentiel ne
soit pas perdu.
Il est nécessaire d’analyser
davantage les meilleurs moyens de protéger les contenus numériques et les
intérêts des titulaires de droits, tout en honorant les principes qui assurent
un accès adéquat et une utilisation équitable aux consommateurs. Plus
précisément, les décideurs doivent
chercher à mieux comprendre les impacts sur les pays en développement de la
tendance à la distribution en ligne et à la protection technologique des
contenus. Il est possible qu’une grande partie de ces matériels soit protégée
par des dispositifs technologiques ou au moyen de dispositions contractuelles
imposées à titre de condition de l’accès aux matériels. Et nous ne sommes pas
certains de la manière dont les exigences raisonnables d’utilisation équitable
seront garanties dans un tel environnement.
En gardant à l’esprit ce niveau
considérable d’incertitude, nous concluons qu’il est à l’heure actuelle
prématuré d’exiger des pays en développement qu’ils dépassent les normes de
l’Accord sur les ADPIC dans ce domaine. Nous estimons que les pays en
développement seraient sans doute malavisés d’adopter le Traité de l’OMPI sur
le droit d’auteur, à moins qu’ils n’y soient poussés par des raisons très
particulières, et devraient conserver leur liberté de légiférer en matière de
mesures technologiques. Il s’ensuit que les pays en développement, comme
d’ailleurs d’autres pays développés, ne devraient pas suivre l’exemple de
la DMCA en interdisant tous les contournements de la protection technologique.
En particulier, nous sommes d’avis que des législations comme la DMCA font trop
pencher la balance en faveur des producteurs de matériels protégés par le droit
d’auteur, au détriment des droits historiques des utilisateurs. Imiter cette
loi à l’échelon mondial pourrait être très préjudiciable aux intérêts des pays
en développement en matière d’accès à l’information et au savoir dont ils ont
besoin pour leur développement. De la même manière, nous avons conclu que la
directive de l’UE sur les bases de données va trop loin en offrant une
protection aux assemblages de matériels et restreint indûment l’accès aux bases
de données scientifiques dont on besoin les pays en développement.
Les
utilisateurs d’informations disponibles sur l’Internet dans les pays en
développement devraient pouvoir faire usage des droits d’utilisation équitable,
comme la réalisation et la distribution à partir de sources électroniques de
copies imprimées en nombre raisonnable pour des objectifs éducatifs et de
recherche, et l’utilisation d’extraits dans une mesure raisonnable pour les
commentaires et les critiques. Lorsque les fournisseurs d’informations
numériques ou de logiciels tentent de restreindre les droits d’utilisation
équitable en imposant des clauses contractuelles associées à la distribution du
matériel numérique, la clause contractuelle en question peut être considérée
comme nulle et non avenue. Si l’on tente d’imposer une restriction semblable
par des moyens technologiques, dans ce cas les mesures prises pour passer outre
les moyens technologiques de protection ne devraient pas être considérées comme
illégales. Les pays en développement devraient bien réfléchir avant d’adhérer
au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et les autres pays devraient se
garder de suivre l’exemple des Etats-Unis et de l’Union européenne et ne point
adopter de législation analogue à la DMCA ou à la directive sur les bases de
données.
Chapitre 6
REFORME DU BREVET
INTRODUCTION
Dans sa
conception « moderne » initiale, le système des brevets visait, selon
la Constitution américaine, à « encourager le progrès de la Science et de
l’Art utile, en assurant pour une période limitée, aux auteurs et aux inventeurs,
un droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes ». L’objectif était de stimuler l’invention, en
récompensant les inventeurs par le droit d’interdire aux autres l’utilisation
de leur invention, cette récompense devant s’inscrire dans le cadre de
l’utilité de l’invention pour la société. La divulgation des informations
contenues dans le brevet était également considérée comme facilitant le progrès
technique.
Au fil du
temps, l’accent a glissé vers une conception du système des brevets en tant que
moyen de création des ressources nécessaires au financement de la R&D et à
la protection des investissements. Puisque le système des brevets offre un
niveau standard de protection dans tous les domaines qu’il couvre, on ne peut
pas établir de lien direct entre la valeur du droit octroyé pour une invention
particulière et les coûts de R&D encourus. Un lien existe peut-être entre
la valeur du monopole et son utilité sociale, si l’on considère la demande du
marché comme un indicateur fiable de l’utilité sociale. Mais, pour les pays en
développement en particulier, c’est très loin d’être le cas. Le système des
brevets ne peut pas encourager des inventions utiles pour la société si les
bénéficiaires potentiels ne sont pas en mesure de les payer ou si personne
d’autre ne veut en payer le prix pour leur compte.
Comme
nous l’avons observé dans la section « Vue d’ensemble », la manière
dont le système a évolué suscite des inquiétudes s’appliquant aussi bien aux
pays développés qu’aux pays en développement. Ces préoccupations concernent
notamment l’application du système des brevets à la nouvelle génération de
technologies, en particulier dans les domaines des sciences de la vie et des
technologies de l'information. Le développement de la biotechnologie s’est
accompagné de brevets plus nombreux sur les organismes vivants, dont la
brevetabilité a été confirmée en 1980 aux Etats-Unis par la Cour suprême dans
l’affaire Diamond contre Chakrabarty.[304] De la même manière, le développement et la
sophistication croissante des technologies de l’information et de la
communication se sont accompagnés aux Etats-Unis de l’extension des brevets aux
logiciels informatiques.
Cette extension
aux nouvelles technologies s’est assortie d’un recours accru au système des
brevets. Aux Etats-Unis, et dans une moindre mesure, dans le monde entier, le
nombre de brevets délivrés a augmenté rapidement. Entre 1981 et 2001, le nombre
de brevets délivrés aux Etats-Unis est passé de 71 000 à plus de
184 000, soit une augmentation de 159 %. Ces cinq dernières années,
cette progression s’est accélérée et le nombre de brevets délivrés a augmenté
de plus de 50 %, contre une progression de moins de 14 % au cours des
cinq années précédentes. Cette progression semble illustrer une croissance de
l’intensité des brevets (par exemple, en termes de dollar dépensé sur la
recherche), plutôt qu’une augmentation de 50 % du nombre d’inventions.
Dans les années 90, les dépenses américaines de R&D ont progressé de près
de 41 % en termes réels, tandis que le nombre de brevets délivrés
augmentait de plus de 72 % entre 1991 et 2001.[305]
Le système des brevets est conçu en tant qu’outil
d’incitation au progrès technique. Son
efficacité en la matière sera tributaire de l’adéquation entre la nature de
l’incitation et les processus selon lesquels se déroule le développement
technologique. Mais si le système des brevets dispose de critères uniformes
pour apprécier les demandes de brevets, le modèle du progrès technique peut
considérablement varier d’un domaine à l’autre. Le système des brevets convient
le mieux à un modèle de progrès dans lequel le produit breveté, qui peut être
développé pour la vente aux consommateurs, est le résultat distinct d’un
processus de recherche linéaire. On peut citer, à titre d’exemples, le rasoir
pour barbe et le stylo à bille ; et les nouveaux médicaments partagent
également certaines de ces caractéristiques.
En revanche, dans de nombreuses industries, et en
particulier dans les secteurs fondés sur le savoir, le processus d’innovation
peut être cumulatif et itératif, s’inspirant d’un éventail d’inventions
précédentes inventées distinctement et nourrissant de nouveaux processus de
recherche indépendante par d’autres.[306] Le savoir évolue grâce à
la réflexion de nombreux esprits, se développant souvent progressivement à
partir du travail d’autres personnes. Ainsi que l’a écrit autrefois avec
modestie Sir Isaac Newton : « Si j’ai pu voir un peu plus loin que
d’autres, c’est que je me suis hissé sur les épaules de géants. »[307] En outre, une grande partie de la recherche
consiste en un développement relativement routinier de technologies existantes.
Ainsi, le séquençage de gènes, autrefois technique manuelle à forte intensité
de travail, est maintenant entièrement automatisé et n’implique que peu de créativité.
La création de logiciels, quant à elle, consiste souvent en un développement
progressif de ce qui existe déjà. En effet, le Mouvement des logiciels libres
se fonde précisément sur cette caractéristique pour impliquer un réseau de
programmeurs indépendants dans le développement itératif de logiciels, selon le
principe du retour du produit amélioré à la communauté.
Dans la pratique, il est souvent difficile de
faire la différence entre les processus de recherche « distincts » et
« progressifs » ou « cumulatifs », car la recherche
s’effectue de beaucoup de manières différentes et comporte souvent un élément
fortuit. Mais pour l’essentiel, le modèle « cumulatif » semble
maintenant concerner une plus grande part de la recherche que le modèle
« distinct ». Un système des brevets ayant évolué dans l’esprit de ce
dernier concept peut ne pas être optimal pour le premier. Ainsi, comme le signalent Merges et
Nelson :
« En fin de compte,
il est important de ne pas oublier que tous les inventeurs potentiels sont
également des contrevenants potentiels. Ainsi, un « renforcement »
des droits de propriété n’accentuera pas toujours les incitations à
l’invention ; ce sera peut-être le cas pour certains pionniers, mais le
renforcement augmentera également considérablement le risque que l’inventeur
d’un perfectionnement se débatte au milieu de litiges… Lorsqu’un brevet large
est délivré … son champ réduit les incitations à l’invention pour les autres,
par rapport, une fois encore, à un brevet dont les revendications sont plus
étroitement limitées aux résultats réels de l’inventeur. Cette situation ne
serait pas indésirable s’il était prouvé que le contrôle des développements
ultérieurs par une partie améliorait l’efficacité des activités inventives
futures. Mais, à notre avis, les éléments probants suggèrent l’inverse. »[308]
Il est ici
crucial de savoir dans quelle mesure le système des brevets, tel qu’il a
maintenant évolué dans le monde développé et tel que le monde en développement
est sous pression d’adopter, offrira des incitations appropriées à l’invention.
L’un des dilemmes fondamentaux à ce sujet porte sur le grand nombre de brevets
de technologies susceptibles d’être l’aboutissement d’un processus de
recherche, mais qui forment la base potentielle d’un ou de plusieurs processus
en aval. A titre d’exemple, on peut citer la question des brevets sur les
« instruments de recherche ».[309]
De concert avec l’expansion
des brevets dans le secteur privé, les instituts de recherche publics ont
accéléré le transfert des technologies qu’ils développent au moyen des brevets.
Aux Etats-Unis, cette approche a été encouragée par l’introduction de la loi
Bayh-Dole (Bayh-Dole Act) en 1980, et
cette politique s’est étendue depuis aux autres pays développés et, de plus en
plus, aux pays en développement plus avancés du point de vue technologique. Les
brevets délivrés chaque année aux universités américaines se sont presque
multipliés par dix, passant de moins de 350 dans les années 70 à plus de
3 000 en 2000. La part des brevets délivrés aux universitaires aux
Etats-Unis est passée de 0,5 % à 2 % du total sur la même période.[310] Cette politique, selon
certains, a encouragé le flux d’inventions depuis les universités et a facilité
leur commercialisation, pour le plus grand bénéfice économique de la société.
Pour d’autres, elle fait naître des inquiétudes au sujet de la restriction
éventuelle de l’accès aux résultats de la recherche ou de leur utilisation par
d’autres, du détournement éventuel des
priorités de la recherche dans le secteur public, et de la validité de
l’augmentation du nombre de brevets déposés en tant qu’indicateur de
l’accélération du transfert de technologie. Nous examinons ce que ces
préoccupations au sujet du système des brevets signifient pour les pays en
développement.
En premier
lieu, afin d’éviter de rencontrer des problèmes similaires à ceux que connaît
le monde développé, les pays en développement devraient essayer de concevoir
des systèmes de brevets qui tiennent compte de leurs circonstances économiques
et sociales particulières. Les offices des brevets et les législatures des pays
en développement doivent avoir pleinement conscience de l’impact commercial et
social de l’approche qu’ils choisissent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique en matière de brevets. Les pays en
développement plus avancés du point de vue technologique souhaiteront sans
doute adopter des systèmes qui permettent une protection étendue par brevet
pour encourager la R&D. Par contre, ils souhaiteront peut-être aussi éviter
certains aspects du système qui pourraient constituer des mesures dissuasives
pour la R&D, et en particulier pour l’innovation de suivi. Ils souhaiteront
éviter le détournement des ressources vers des procédures judiciaires et des
litiges concernant des brevets de validité douteuse et le comportement de
« recherche de rente »[311] parmi les titulaires de
droits présentant un avantage social douteux. Ces systèmes devront comporter
des garde-fous adéquats pour assurer un environnement concurrentiel et
minimiser les coûts pour le consommateur. Comme une grande partie des
compétences scientifiques et technologiques des pays en développement est
concentrée dans le secteur public, il sera nécessaire de réfléchir avec soin
aux implications des brevets déposés par les instituts de recherche et les
universités. Les pays dont l’infrastructure scientifique et technologique est
faible auront moins de raisons d’adopter une protection étendue par brevet,
puisqu’une grande partie de leur technologie est importée.
En second lieu,
une question très difficile se pose : comment les intérêts des pays en
développement devraient-il être conciliés avec les pressions actuelles à
l’harmonisation du système international des brevets avec les normes des pays
développés ? Cette question naît de l’augmentation du nombre de demandes
de brevets, qui fait peser de lourdes charges sur les ressources de nombreux
offices des brevets, et de l’admission d’une répétition considérable des
efforts dans le système, du fait notamment de la nécessité de déposer plusieurs
demandes pour une seule invention dans différents pays. Il serait possible
d’éviter cette répétition par l’harmonisation des différents critères et normes
dans les procédures de recherche et d’examen.
Pour certains, l’objectif ultime est un brevet international, valable
dans le monde entier et fondé sur un processus de demande unique. Mais si,
comme nous l’avançons, les pays en développement doivent être encouragés à
élaborer des systèmes de brevets adaptés à leurs situations et objectifs
particuliers, eux-mêmes variables en fonction de leur stade de développement,
comment ces pays doivent-ils alors procéder ?
Les questions
essentielles pour les pays en développement, issues de la discussion qui
précède, sont les suivantes :
·
Comment
les pays en développement devraient-ils élaborer leur législation et leur
pratique en matière de brevets ? Quelles mesures les pays en développement
peuvent-ils adopter en général pour minimiser les effets négatifs potentiels
des régimes de brevets ?
·
Les
pays en développement devraient-ils encourager leurs instituts de recherche
publics à breveter leurs inventions ?
·
Dans
quelle mesure le système des brevets entrave-t-il la recherche présentant un
intérêt pour les pays en développement ? Les brevets sur les instruments de
recherche représentent-ils un problème pour les pays en développement ?
·
Quelle
serait l’approche optimale pour les pays en développement dans le cadre de
l’harmonisation des brevets ?
ELABORATION DE SYSTEMES DE
BREVETS DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
Introduction
Nous pensons
que, lorsqu’ils réfléchiront à la forme de leurs systèmes de brevets, les pays
en développement devraient adopter une stratégie favorable à la concurrence
qui, ainsi que le suggère un observateur, privilégie les seconds arrivants
plutôt que les titulaires de brevets lointains.[312] Ceci est
particulièrement important dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique
ou l’agriculture où, comme nous l’avons déjà vu, le coût d'une protection
étendue sera vraisemblablement le plus élevé. Le meilleur moyen de réaliser une
telle stratégie favorable à la concurrence est de chercher à limiter la portée
de la protection par brevet accordée.
Ce système devrait être obtenu, dans les limites
des obligations internationales et bilatérales, en :
·
limitant la portée de la matière
brevetable
·
appliquant des normes telles que seuls les
brevets qui satisfont à de strictes conditions de brevetabilité sont délivrés
et que la portée de chaque brevet est proportionnelle à la contribution
inventive et à la divulgation effectuée
·
facilitant la concurrence par la
limitation de la capacité des titulaires de brevets à interdire aux autres de
développer des inventions brevetées ou de concevoir autour de celles-ci
·
intégrant des garanties étendues contre
l’usage abusif des droits de brevet
·
envisageant le caractère approprié
d’autres formes de protection pour encourager l’innovation locale.
Nous examinons
ci-dessous la manière dont ces objectifs peuvent être atteints.
Historiquement,
comme nous l’avons vu, les pays ont adapté leur régime de brevets pour
encourager, décourager ou plus souvent interdire le dépôt des brevets dans
certains domaines technologiques. La signature de l’Accord sur les ADPIC, avec
son exigence d’approche plus cohérente dans les différents domaines
technologiques,[313] a réduit les options
ouvertes aux législateurs en matière de brevets. Néanmoins, les rédacteurs de
législations relatives aux brevets disposent encore d’une gamme d’outils
considérable, même si certains d’entre eux ont été émoussés par l’Accord sur
les ADPIC. De nombreux livres et textes donnant le détail de l’éventail des
options disponibles en vertu de l’Accord sur les ADPIC ont été publiés.[314] Dans les paragraphes qui
suivent, nous décrivons certaines de ces options et examinons leur adéquation
au type de régime de brevets favorable à la concurrence que nous préconisons
pour la majorité des pays en développement. Nous étudions également comment
certaines des recommandations relatives à la politique en matière de brevets, énoncées
dans les chapitres précédents sur la santé et l’agriculture, peuvent être mises
en œuvre.
Champ des brevets
Inventions
brevetables
L’Accord sur les
ADPIC prescrit qu’un « brevet pourra être obtenu pour toute invention, de
produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition
qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive (non évidente)
et qu'elle soit susceptible d'application industrielle (utile) ».[315]
Cependant, il ne définit pas le terme « invention » et ne précise pas
comment les trois critères de brevetabilité doivent être définis. En effet, nous observons qu’il n’est pas rare
que différents tribunaux européens, même lorsqu’ils appliquent des lois
identiques, parviennent à des conclusions différentes sur la question de savoir
si un brevet est évident ou non. Les pays en développement disposent d’une
marge de manœuvre considérable pour fixer par eux-mêmes le degré d’application
des normes communes de l’Accord sur les ADPIC et la manière dont la charge de
la preuve doit être attribuée.
Historiquement, les
pays développés et en développement prévoient que certaines choses ne
constituent pas des inventions aux fins de la protection par brevet. Parmi
elles, on citera notamment celles qui sont exposées, par exemple, à l’article
52 de la Convention sur le brevet européen (CBE) :
a) les découvertes
ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations
esthétiques ;
c) les plans,
principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière
de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes
d'ordinateurs ;
d) les
présentations d'informations.
L’article 52,
paragraphe 4, de la CBE prévoit également que les méthodes de traitement
chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne doivent pas être considérées
comme des inventions susceptibles d’application industrielle. L’article 53 b)
de la CBE prévoit qu’il ne doit pas être délivré de brevets sur les variétés
végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
Même si la pratique
et la doctrine ultérieures de l’OEB ont, dans une certaine mesure, dilué la
portée de ces articles,[316]
il semblerait tout à fait raisonnable que la plupart des pays en développement
adoptent cette liste d’exclusions à titre de minimum. En effet, nous sommes
même déjà allés plus loin en concluant au Chapitre 3 que les pays en développement
ne devraient en principe pas délivrer de brevets sur les végétaux et les
animaux.[317] Plusieurs pays en
développement ont également cherché à limiter encore ce qui constitue une
invention brevetable. Par exemple, le régime commun concernant la propriété
intellectuelle des pays du Pacte andin prévoit que ne sont pas considérées
comme des inventions :
« Tout ou partie des
êtes vivants tels qu'ils existent dans la nature, les processus biologiques
naturels et le matériel biologique existant dans la nature ou pouvant être
isolé, y compris le génome ou le matériel génétique de tout être vivant
naturel. »[318]
On trouve des
dispositions similaires dans la législation du Brésil et de l’Argentine. Nous
examinons plus avant ci-dessous la question des règles qui devraient
s’appliquer à la brevetabilité du matériel génétique.
Exclusion d’inventions pour des
raisons morales ou éthiques
Il est clair que le
débat entourant la protection par brevet de certaines inventions, notamment
celles qui couvrent des matières biologiques, porte sur d’autres éléments que
l’économie. Pour un grand nombre de
personnes, dans les pays développés et en développement, l’idée de la
délivrance de brevets sur des organismes vivants est contraire aux bonnes
mœurs. Cette notion est souvent associée à l’opinion que les organismes vivants
ne devraient pas être brevetés parce qu’ils peuvent, par définition, n’être que
découverts et non inventés. Des groupes s’opposant aux brevets sur « la
vie » ont participé activement aux discussions récentes en Europe sur la
protection à accorder aux inventions biotechnologiques.[319]
Le texte définitif de la directive européenne qui en a résulté[320]
exclut certains groupes d’inventions[321]
de la protection par brevet pour des raisons morales, mais autorise toujours
les brevets sur les végétaux et animaux et le matériel génétique. Un débat
similaire dans un pays en développement où l’intérêt économique en faveur des
brevets sur les organismes vivants est sans doute plus faible, et où les
valeurs culturelles et religieuses sont souvent différentes, pourrait conduire
à des conclusions différentes. Dans ce
cas, il serait possible de décider de refuser les brevets pour des raisons
éthiques dans le cas des inventions portant sur des matières génétiques comme
les gènes humains. Toutefois, une exclusion de ce type ne serait viable sur le
fondement de l’exception de moralité de l’article 27.2 de l’Accord sur les
ADPIC que si l’interdiction de « l’exploitation commerciale »
de l’invention à laquelle le brevet est refusé était jugée nécessaire. Il n’est
donc pas certain qu’il soit possible d’appliquer l’exclusion tout en permettant
la vente ou toute autre exploitation commerciale de l’invention.
Certaines
préoccupations d’ordre éthique concernant les technologies fondées sur les gènes
peuvent s'étendre seulement à l’éventualité où une personne demanderait un
monopole sur la technologie, plutôt qu'à son exploitation commerciale. Dans ce
cas, le meilleur moyen de parvenir à l’obtention d’une exclusion de la
protection par brevet peut être une application stricte des critères de
brevetabilité. Ces critères impliquent, comme nous l’avons mentionné plus haut,
une définition claire de ce qui constitue une invention brevetable, par
opposition à une découverte non brevetable, et l’application régulière des
concepts de nouveauté, d’activité inventive et d’utilité industrielle. Nous
reconnaissons qu’en pratique, la distinction entre une découverte et une
invention peut être difficile à identifier, ce qui pose un défi constant aux
législateurs.
Des questions de
moralité peuvent également naître au sujet de brevets autres que ceux relevant
du domaine de la biotechnologie. Par exemple, le Royaume-Uni et le Kenya ont
récemment décidé de rejeter, pour des raisons morales, les brevets sur les
mines antipersonnel.
Normes de brevetabilité
Conditions
de nouveauté, d’activité inventive et d’utilité
Au Chapitre 4, nous
recommandons qu’une norme absolue de nouveauté
soit prévue, de sorte que l’état de la technique au regard duquel la
nouveauté est appréciée comprenne la divulgation par voie d’utilisation dans
toute partie du monde. Au Chapitre 2, nous avons également fait état du risque
que les pays en développement tirent simplement de la doctrine européenne
relativement récente la notion contre-nature qu’un produit peut être considéré
comme nouveau en cas d’identification d’une nouvelle utilisation le concernant.
L’Accord sur les ADPIC n’exige pas une telle approche et on peut
raisonnablement adopter des avis divergents sur la question de savoir s’il est
ou non souhaitable d’étendre la protection de cette manière, ce que les pays en
développement devraient étudier avec soin.
Dans certains pays, la divulgation d’une invention par l’inventeur pendant la
période, généralement de 12 mois, précédant le dépôt d’une demande de brevet
correspondante n’éliminera pas la nouveauté du brevet. Ce délai de grâce, qui peut se limiter aux divulgations effectuées
uniquement lors de salons reconnus au niveau international ou peut couvrir
toute divulgation, entend permettre au titulaire du brevet de chercher un
financement ou de tester le marché pour son invention. Toutefois, en l’absence
d’harmonisation internationale des délais de grâce, un inventeur risque de
perdre ses droits de brevet dans un pays qui ne reconnaît pas les délais de
grâce en raison de la divulgation dans un pays qui les reconnaît. Pour les pays
en développement qui ont peu de titulaires de brevet potentiels, l’octroi d’un
délai de grâce peut donc ne présenter que peu d’intérêt.
A l’heure actuelle,
une invention est généralement considérée comme inventive si elle n’est pas évidente pour un homme du métier.[322]
Certains avancent que cette norme telle qu’elle est appliquée actuellement, par
exemple par l’USPTO ou l’OEB, est trop faible et entraîne une prolifération de
brevets pour des inventions triviales qui peuvent ne pas contribuer à
l’objectif primordial du système des brevets, c’est-à-dire le progrès de la
science dans l’intérêt public.
Nous n’avons pas connaissance de l’application actuelle de normes beaucoup
plus élevées ailleurs. Toutefois, l’histoire fait état de normes plus strictes
appliquées dans le passé. Ainsi, pendant la première moitié du XXe
siècle, les Etats-Unis appliquaient la norme de « l’éclair de génie
créatif » qui rendrait sans doute nulle la majorité des brevets délivrés
actuellement.
Pour les pays en
développement, la domination actuelle de la faible norme de l’activité
inventive soulève deux préoccupations. La première est que, telle qu’elle est
appliquée dans les pays développés, cette norme pourrait entraver des
recherches importantes pour les pays en développement. La seconde préoccupation
est que les pays en développement seraient tenus d’appliquer une norme
similaire dans leurs propres régimes. Nous demandons aux pays en développement
de réfléchir avec soin avant d’appliquer une telle norme et de chercher à
savoir si une autre norme plus stricte est préférable. Il a été suggéré que le
déposant soit tenu de démontrer que l’invention proposée fait preuve d’un
niveau d’inventivité supérieur à ce qui est normal dans l’industrie concernée.[323]
L’objectif de toute norme devrait être de veiller à ce que les progressions
routinières du savoir, impliquant un minimum de création, ne soient en général
pas brevetables.
Les pays en
développement devront tenir compte de l’impact potentiel de toute norme plus
stricte d’activité inventive sur la capacité des entreprises nationales à
protéger leurs propres innovations. Nous reviendrons sur cette question lorsque
nous examinerons l’importance d’une protection de second rang comme les modèles
d’utilité.
La condition d’application industrielle (ou d’utilité aux Etats-Unis) de l’invention
est sans doute le seul critère de brevetabilité devenu plus strict ces derniers
temps. Cette évolution est due essentiellement à la difficulté de déterminer si
certaines inventions liées à la biotechnologie, comme celles qui couvrent
les gènes ou les protéines, ont réellement une application industrielle.
Souvent cette application n’est pas apparente à partir de l’invention
elle-même. L'USPTO a récemment publié des directives sur la manière dont
l’utilité devait être appréciée dans les cas impliquant des séquences d’ADN.[324]
En pareil cas, l’utilité ne peut être établie que si la demande de brevet
divulgue une utilité particulière, substantielle et crédible. Cette exigence
est maintenant, dans une certaine mesure, appliquée également par l’OEB.[325]
Il faut espérer que cette nouvelle norme empêchera la délivrance de brevets sur
des inventions pour lesquelles seule une application spéculative est divulguée,
mais il se peut qu’elle n’aille pas assez loin et l’impact des nouvelles
directives devra donc être surveillé de près.
Les pays en développement qui prévoient la protection des
inventions biotechnologiques par des brevets devraient apprécier si celles-ci
sont réellement susceptibles d’application industrielle, compte tenu des
directives de l'USPTO le cas échéant.
Condition
de divulgation
Le contrat
passé avec la société pour la délivrance d’un brevet est qu’une période de monopole
limitée sera accordée, en échange de quoi le demandeur du brevet divulgue
intégralement son invention. La mesure de la divulgation considérée comme
nécessaire pour satisfaire aux obligations contractuelles du demandeur varie
d’un pays à l’autre. Dans certains pays, y compris les Etats-Unis, le demandeur
est tenu non seulement de divulguer intégralement son invention pour permettre
à un tiers de la mettre en pratique, mais aussi de divulguer la meilleure manière de le faire. La
sanction du non-respect est généralement la déchéance du brevet.
Les pays en développement devraient adopter la
disposition relative à la meilleure manière d'exécuter une invention afin de
veiller à ce que le demandeur de brevet ne s’abstienne de divulguer des
informations qui seraient utiles aux tiers.
Une autre question
concernant la divulgation porte sur les exigences possibles de divulguer
l'origine de toute matière biologique utilisée dans l’invention, que nous avons
examinées au Chapitre 4.
La relation entre
la mesure de la divulgation et la portée ou l’ampleur de la protection
recherchée est un autre point important. Les régimes de brevets exigent
généralement que l’invention soit divulguée dans la demande de brevet d'une
manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse
l'exécuter. Les revendications exposées doivent également être appuyées par la
description de l’invention. Selon la norme appliquée au Royaume-Uni, par
exemple, une revendication juste est celle qui n’est pas large au point de dépasser
l’invention ni si étroite pourtant qu’elle prive le demandeur du brevet d’une
juste récompense pour la divulgation de son invention.[326] Les tribunaux britanniques ont également
récemment déclaré que la divulgation devait être suffisante pour permettre la
réalisation de tous les aspects de l’invention revendiquée et que la
divulgation d’une seule manière d'exécuter l’invention ne sera pas toujours
suffisante.[327]
Mais qu’entend-on
par revendication large ? Prenons l’exemple de l’inventrice d’un nouveau
composé pour le traitement des maux de tête. Elle divulgue l’utilisation
potentielle de son composé dans sa demande, mais ses revendications vont
au-delà de cette utilisation du composé, et de toutes ses utilisations
potentielles. Pendant la durée du brevet, quelqu’un d’autre établit que le
composé est aussi utile pour traiter les maladies de cœur. Est-il juste que la
titulaire du brevet puisse empêcher l’utilisation de son composé, sans son
autorisation, à des fins qu’elle n’avait pas prévues ? Des revendications
si larges sont-elles réellement justifiées sur le fondement de la divulgation
limitée ?
Les législations en
matière de brevets des pays développés ont généralement justifié ce type de
revendication large par le fait que l’inventrice a mis à la disposition des
autres deux choses : le composé lui-même et sa première utilisation. Si la
question du champ des revendications est générique, on la retrouve notamment
dans le cadre des brevets sur les gènes. Comme nous l’avons déjà observé,
certains sont d’avis qu’un gène isolé (même lorsque l’une ou plusieurs de ses
fonctions ont été déterminées) ne devrait pas être brevetable parce qu’il
préexiste dans la nature et constituerait donc une découverte plutôt qu’une
invention. Toutefois, si un pays opte pour
l’autorisation des brevets sur les gènes, il est crucial de définir le champ
potentiel de la protection. A l’heure actuelle, si une chercheuse isole un gène
et obtient un brevet, par exemple, sur l’utilisation de ce gène en tant que
diagnostic d’une maladie particulière, selon les termes exacts de la
revendication et l’approche adoptée par le droit local concernant
l’interprétation du brevet, elle peut prétendre à des droits sur toutes les
utilisations de ce gène, même celles qui n’ont pas encore été découvertes.
Etant donné que la procédure d’isolation et d’identification d’un gène relève
maintenant plutôt de la routine depuis le séquençage du génome humain et
d’autres génomes, la chercheuse pourrait obtenir un niveau de protection
considérablement supérieur à sa contribution. En outre, comme il est difficile
pour d’autres « d’inventer autour » d’un gène, la chercheuse pourrait
exercer un monopole puissant.
Un rapport récent
sur les brevets concernant l’ADN, après avoir examiné la question en détail, a
suggéré qu’il « convenait de réfléchir au concept de limitation aux
utilisations mentionnées dans les revendications de la portée des brevets de
produits qui revendiquent des droits sur des séquences d’ADN existant dans la
nature, lorsque l’inventivité ne concerne que l’utilisation de la séquence et
non l’obtention ou l’élucidation de la séquence elle-même ».[328]
Une telle limitation conduirait à n’octroyer à la chercheuse des droits que sur
les utilisations qu’elle a exposées dans la description, et non sur toutes les
utilisations.
Cette question est
tout aussi pertinente pour les pays en développement qu’elle l’est pour les
pays développés. Nous suggérons donc que les pays en développement mènent leurs
propres enquêtes sur les moyens de veiller à ce que la portée des demandes de
brevets sur leur territoire soit proportionnelle à la divulgation. Les pays en
développement pourraient également vouloir faire pression pour un examen de
cette question à l’OMPI, peut-être dans le cadre des discussions en cours sur une
meilleure harmonisation des brevets.
Si les pays en développement autorisent les brevets
portant sur les gènes en tant que tels, les règlements ou les lignes
directrices devraient préciser que les revendications sont limitées aux
utilisations effectivement divulguées dans le brevet, afin d’encourager la
recherche ultérieure et les applications commerciales ultérieures de nouvelles
utilisations du gène.
Mais les mesures
visant à résoudre les questions de portée, comme nous l’avons observé,
s’étendent au-delà des brevets sur les gènes et devraient englober les brevets
larges dans tous les domaines technologiques. Si l’Accord sur les ADPIC
interdit la discrimination en termes de domaines technologiques, il est
également souhaitable, d’un point de vue plus général, de veiller à ce que les
revendications larges n’entravent indûment la recherche et la concurrence dans
aucun domaine.
Application
des normes
Jusqu’ici, nous avons suggéré que les pays en développement devraient
envisager des normes plus strictes que celles que prévoient actuellement la
plupart des pays développés. Mais il ne suffit pas d’intégrer ces normes dans
la législation. Il est également nécessaire de les appliquer. Au Chapitre 7,
nous abordons les questions relevant des capacités, comme le manque de
personnel qualifié qui peut empêcher un pays en développement d’appliquer une
politique efficace en matière de brevets.
Nous examinons aussi le type de mesures, comme l’externalisation de
l’examen des brevets, qui pourraient être utilisées pour résoudre certains de
ces problèmes. Nous parlons également de la possibilité de réenregistrement de
brevets délivrés ailleurs, bien que dans ce cas il soit nécessaire de veiller à
ce que des normes suffisamment strictes soient appliquées lors de l’examen du
brevet.
Quel que soit le type de système adopté, il pourrait être souhaitable
que les pays en développement envisagent de prévoir une forme de procédure
d’opposition ou de réexamen à faible coût.[329] Au Chapitre 4, nous avons mis en avant
l’intérêt de ces procédures pour révoquer des brevets nuls portant sur des
savoirs traditionnels connus. Le type de procédure d’opposition ou de réexamen
qu’un pays en développement pourrait envisager d’adopter pourrait être un
croisement des types de système actuellement disponibles dans certains pays en
développement, aux Etats-Unis et en Europe. Ainsi pourrait être souhaitable un
système qui autorise le dépôt d’une opposition avant la délivrance, et la
contestation du brevet à tout moment de la durée du brevet par une procédure de
type administratif sur le fondement de toute question relative à la
brevetabilité.
Lorsqu’ils examinent les demandes de brevets, les pays en développement
devraient sérieusement envisager d’exiger que le demandeur divulgue toutes les
informations pertinentes concernant les autres demandes correspondantes
déposées pour l’invention dans d’autres pays. Ils devraient également envisager
de compléter l’appréciation des examinateurs de brevets en invitant d’autres
experts disponibles à donner leurs commentaires sur les demandes de brevets. Au
Brésil, les demandes portant sur des brevets liés aux produits pharmaceutiques
sont transmises pour évaluation au ministère de la Santé qui peut être mieux
placé pour apprécier, par exemple, l’inventivité de l’invention revendiquée.
Exceptions aux
droits de brevet
Au Chapitre 2, nous
recommandons que les pays en développement introduisent ce qu’on appelle
« l’exception Bolar » aux droits de brevet, afin de faciliter la
pénétration rapide de la concurrence générique dans le domaine
pharmaceutique. Nous avons également
suggéré que l’établissement d’un régime international d’épuisement
(c’est-à-dire l’autorisation d’importations parallèles de produits brevetés)
pourrait être avantageux pour les pays en développement. Ces exceptions ne sont
toutefois pas les seules que les pays en développement devraient envisager. La
plupart des pays européens, par exemple, prévoient que certains actes, comme
ceux qui sont effectués à des fins privées et non commerciales ou ceux qui
portent sur des expériences sur l’objet du brevet (y compris à des fins
commerciales), ne sont pas considérés comme des contrefaçons. L’intention de
ces exceptions, qui concerne généralement les pays en développement, est
d’encourager l’innovation ultérieure en permettant à d’autres de développer
l’invention brevetée ou de concevoir autour de celle-ci.
Une autre
exception, qui existe déjà dans quelques pays en développement, prévoit la
liberté d’utilisation d’inventions brevetées à des fins éducatives. La
justification de cette exception pourrait venir du domaine du droit d’auteur où
« l’utilisation équitable » à des fins éducatives d’œuvres protégées
par droit d’auteur est bien établie. En fait, avec la pénétration croissante
des brevets dans des domaines relevant autrefois exclusivement du droit
d’auteur, par exemple les programmes d’ordinateur, la pertinence d’une
exception éducative dans le domaine des brevets pourrait croître.
Prévision de garde-fous dans la
politique en matière de brevets
Nous avons examiné
jusqu'ici les conditions d’obtention des brevets et les limitations possibles
des droits des titulaires de brevets. Nous étudions maintenant les instruments
permettant de veiller à ce que ces droits ne soient pas utilisés de manière
irrégulière. Nous examinons nombre de
ces questions en détail au Chapitre 2, mais nous complétons ici nos propos.
Licences
obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics
Dans les cas où il
est considéré que le titulaire du brevet agit de manière irrégulière, les
pouvoirs publics peuvent intervenir pour régler la situation. Cette
intervention pourrait émaner du régime général de la concurrence, ou du système
des brevets lui-même. La possibilité que les pouvoirs publics utilisent,
ou autorisent des tiers à utiliser, une invention brevetée sans le consentement
du titulaire du brevet est bien établie dans le droit des brevets et dans
l’Accord sur les ADPIC, comme nous l’observons au Chapitre 2. L’Accord sur les
ADPIC prescrit la satisfaction de plusieurs conditions en cas d’utilisations
« non autorisées » de la sorte, mais il n’identifie pas les
fondements de cette faculté d’utilisation. Les pays en développement peuvent
donc établir leurs propres fondements pour l’autorisation de licences
obligatoires, ou pour d’autres exceptions aux droits des titulaires de brevets
(comme l’utilisation par la Couronne ou les pouvoirs publics dans les pays
développés). Lorsqu’ils envisagent l’introduction ou la révision de leur
législation, ils pourraient chercher une orientation dans les lois sur les
brevets d’autres pays. Par exemple, les Etats-Unis ont utilisé les licences
obligatoires dans plus de 100 affaires de lutte contre la concurrence.[330]
Le Royaume-Uni prévoit que des licences obligatoires peuvent être octroyées
pour les motifs suivants :
·
la demande du produit breveté au
Royaume-Uni n'est pas satisfaite à des conditions raisonnables
·
l’exploitation au Royaume-Uni de
toute autre invention brevetée, qui implique un progrès technique important
présentant un intérêt économique considérable, est empêchée ou entravée
·
il est porté préjudice injustement
à l’établissement ou au développement d’activités commerciales ou industrielles
au Royaume-Uni.
Bien entendu, les
pays en développement ne sont pas obligés de suivre les pas de pays comme le
Royaume-Uni. Certains pays en
développement ont adopté d’autres fondements, dont « l’intérêt
public » et l’impossibilité pour un tiers d’obtenir une licence à des
conditions raisonnables.[331]
Le Brésil et d’autres pays[332]
ont prévu ou envisagent de prévoir la faculté d'octroyer une licence
obligatoire dans les cas où la demande de l’invention brevetée est
essentiellement satisfaite par l’importation.
Comme nous l’observons au Chapitre 1, les pays développés ont utilisé ce
type de mesures aux XIXe et XXe siècles pour limiter les
préjudices potentiels causés à l’industrie nationale par la délivrance de
brevets à des étrangers. Des questions
se posent toutefois au sujet de la compatibilité de cette mesure avec l’Accord
sur les ADPIC, qui prescrit la jouissance des droits de brevet sans
discrimination, que le produit soit importé ou d'origine nationale.[333]
Les pays développés, dont le Royaume-Uni, ont généralement supprimé cette
disposition de leur droit écrit, sur le fondement de leur propre interprétation
de l’Accord sur les ADPIC.
Dans l’idéal,
la simple possibilité de l'octroi de licences obligatoires devrait suffire à
encourager le titulaire du brevet à modifier son comportement. Nous observons
au Chapitre 2 que ce ne sera sans doute le cas que lorsque la menace est
crédible, dans le sens où il existe un concessionnaire de licence potentiel
capable de fournir le produit breveté de manière économique à un prix plus bas
que le titulaire du brevet.
Une utilisation
étendue des licences obligatoires dans les pays en développement est peu
probable, étant donné la complexité des procédures du système. Nous pensons
néanmoins qu’un système de licences obligatoires efficace et crédible, comme
nous l’avons recommandé au Chapitre 2, est un élément essentiel de toute
politique en matière de brevets. Et c’est particulièrement le cas pour les pays
auxquels fait défaut une politique de la concurrence générale efficace.
Différends
portant sur la propriété des brevets
Lors de notre
visite au Kenya, nous avons pris connaissance de la controverse entourant un
brevet relatif à un vaccin contre le VIH, déposé par le Conseil de la recherche
médicale (Medical Research Council -
MRC) au Royaume-Uni. En particulier, des inquiétudes ont été exprimées selon
lesquelles la contribution des chercheurs de l’Université de Nairobi à
l’invention revendiquée dans ce brevet n’avait pas été suffisamment reconnue.
En conséquence, en partie, des pressions publiques entourant cette affaire, les
parties sont parvenues à un accord en vertu duquel le MRC, l’Université de
Nairobi et l’Initiative internationale pour un vaccin contre le SIDA (IAVI)
seraient titulaires conjoints du brevet en question et de tous brevets futurs
impliquant le développement en question.[334] En l’absence d’un tel
accord, les chercheurs du Kenya auraient dû envisager d’intenter une action en
justice pour obtenir toute droit équitable qu’ils avaient sur le brevet ou sur
tous avantages issus de son exploitation possible.
La plupart, si
ce n’est l’ensemble, des lois sur les brevets présument que celui qui dépose la
demande de brevet est fondé à se voir délivrer un brevet. Par exemple, selon le
droit des brevets britannique, un déposant qui ne prétend pas être l’inventeur
doit déclarer son droit sur le brevet. Les offices des brevets, en général,
s’abstiennent de remettre en question les déclarations apparemment fondées
relatives aux droits ou à la qualité d’inventeur, bien qu’un tiers puisse
engager une procédure de contestation avant et après la délivrance du brevet. Pour
obtenir gain de cause, le tiers doit prouver qu’il est l’inventeur ou le
co-inventeur de l’invention brevetée ou qu’il jouit d’un droit en vertu d’un
contrat ou de la loi. La charge de la preuve pèse presque toujours sur le
demandeur.
Il a été
suggéré qu’il pourrait être avantageux d’introduire l’obligation pour les
déposants de démontrer comment ils ont réalisé une invention dans les cas où la
voie de l’invention peut ne pas être immédiatement apparente (par exemple, dans
les cas revendiquant des matières biologiques).[335] Une telle condition, qui
semble permise aux termes de l’Accord sur les ADPIC, s’écarte de l’exigence
actuelle de description de la manière d'exécuter l’invention.[336] Si l’adoption d’un rôle plus proactif dans
les recherches portant sur les questions de revendications risque de placer une
charge supplémentaire sur les offices des brevets déjà débordés, nous estimons
néanmoins que cette suggestion mérite d’être étudiée plus avant.
Encourager l’innovation nationale
Nombre des
suggestions que nous avons faites dans ce chapitre reflètent le fait que les
ressortissants des pays en développement à faible revenu déposent très peu de
demandes de brevets. Il ne faut considérer que cela indique une absence
d’activité d’innovante dans ces pays ; le problème réside plutôt dans le
fait que le système des brevets actuel ne prévoit aucun moyen convenable pour
protéger leurs efforts. L’une des raisons possibles de cette situation est que
les types d’inventions réalisées peuvent ne pas présenter le degré d’inventivité
nécessaire. On compte également parmi les raisons importantes de cette
situation la complexité et les coûts de l’acquisition de droits, notamment sur
les marchés étrangers, et, surtout, du respect de ces droits devant les
tribunaux.
Beaucoup de pays,
développés et en développement, ont reconnu la nécessité de protéger les
inventions qui résultent ce qu’on peut appeler un type d’innovation
« inférieure aux seuils de brevetabilité » et ont donc introduit un
second niveau de protection comparable aux brevets. On appelle généralement ces
systèmes des systèmes de modèles
d’utilité ou de « petits brevets ».[337]
Par rapport au système normal de brevets, les systèmes de modèles d’utilité ou
de petits brevets exigent généralement un niveau inférieur d’activité
inventive, offrent une période de protection plus courte et, en ce qu’ils ne
sont pas soumis à un examen quant au fond avant la délivrance, sont moins chers
à obtenir.[338]
Ces
caractéristiques sont destinées à rendre le système plus attirant pour les
petites et moyennes entreprises (PME) qui n’ont généralement ni la volonté ni
la capacité d’utiliser le système des brevets normal. Le type d’activité
innovante dans ces organisations peut être plus axé sur des améliorations
progressives de produits existants par étapes relativement petites, plutôt que
sur la mise au point de produits entièrement nouveaux. Ces améliorations, si
elles ne possèdent pas nécessairement le degré d’inventivité requis pour la
protection normale par brevet, contribuent néanmoins au progrès technique et
devraient être encouragées. Ces modèles d’utilité sont sans doute les plus
avantageux pour des produits comme les articles mécaniques, d’un type
susceptible d’être fabriqué au niveau national. Ils ne doivent certainement pas
être utilisés en tant que substitut des brevets normaux (pour lesquels nous
recommandons des normes plus strictes).
Il est difficile de
trouver des éléments probants portant sur le degré de réussite des systèmes de
modèles d’utilité en matière de stimulation de l’innovation dans les pays en
développement.[339] Lors de notre visite au Kenya, nous avons été
informés que le niveau d’intérêt parmi les sociétés kenyanes pour le système de
modèles d’utilité, récemment introduit, avait été décevant. C’est également le
cas dans d’autres pays en développement. Les chiffres compilés par l’OMPI
indiquent qu’en Argentine, 38 modèles d’utilité seulement avaient été
enregistrés en 2000, et 32 uniquement au Vietnam.
En dehors des
systèmes utilisés actuellement, d’autres propositions variées ont été suggérées
pour encourager l’innovation inférieure aux seuils de brevetabilité ou
progressive. L’une de ces propositions se fonde sur l’octroi d’un droit à une
faible redevance lorsque l’invention est utilisée par d’autres, mais ne permettrait
pas l’interdiction de cette utilisation. Cette approche cherche à offrir une
récompense pour l’innovation, tout en réduisant les effets qui pourraient
décourager l’innovation de suivi. Mais les conditions d’administration et
d’application de ce système doivent être testées afin d’en évaluer la
faisabilité dans les pays en développement.[340]
Plutôt que d’affaiblir les normes de brevetabilité pour
englober les innovations progressives qui prédominent dans nombre de pays en
développement, les législateurs et les décideurs de ces pays devraient
envisager d’instituer une protection par le modèle d’utilité pour encourager et
récompenser ces innovations. Des études plus poussées semblent nécessaires pour
évaluer le rôle précis que la protection par le modèle d’utilité ou d’autres
systèmes ayant des objectifs similaires pourraient jouer dans les pays en
développement.
Un autre type de
protection est disponible dans certains pays[341]
pour permettre au titulaire d'un brevet d’obtenir la protection des
améliorations qu’il apporte à sa propre invention. Ces brevets d’addition ou certificats
d’addition, qui expirent généralement à la même date que le brevet
d’invention initial, sont destinés à couvrir les améliorations ne présentant
pas le degré nécessaire d’inventivité qui leur permettrait de faire l’objet
d’une demande distincte. L’insécurité juridique qui pourrait survenir si un
titulaire de brevet était autorisé à élargir la portée réelle de sa protection
à tout moment de la durée du brevet pourrait décourager d’autres inventeurs de
développer l’invention brevetée ou de concevoir autour de celle-ci. Un système
des brevets prévoyant de tels brevets d’addition parallèlement à un niveau
relativement élevé d’activité inventive serait toutefois susceptible d’empêcher
l’extension injuste de la durée de la protection par brevet qui résulte parfois
de la délivrance de brevets distincts pour des améliorations relativement
mineures.
Conclusions
Pour résumer,
nous exposons ici les éléments d’un modèle de droit des brevets favorable à la
concurrence que les pays en développement pourraient envisager, en y incluant
les recommandations des autres chapitres. Une synthèse de ces éléments figure
dans l’Encadré 6.1.
Encadré 6.1 Synthèse des recommandations relatives
au système des brevets
Pays en
développement*
·
Exclure totalement de la
brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour
le traitement des êtres humains et des animaux
·
Exclure de la brevetabilité les
végétaux et animaux, et adopter une définition restrictive des micro-organismes
·
Exclure de la brevetabilité les
programmes d’ordinateur et les méthodes commerciales
·
Eviter la délivrance de brevets
pour de nouvelles utilisations de produits connus
·
Eviter l’utilisation du système
des brevets pour protéger les variétés végétales et, chaque fois que possible,
le matériel génétique
·
Prévoir l’épuisement
international des droits de brevet
·
Prévoir un système efficace de
licences obligatoires et des dispositions adéquates d’utilisation par les
pouvoirs publics
·
Prévoir les exceptions les plus
larges possibles aux droits de brevet, dont des exemptions adéquates à des fins
de recherche et une « exception Bolar » explicite
·
Appliquer des normes strictes
de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle ou utilité
(envisager des normes plus élevées que celles qui sont appliquées actuellement
dans les pays développés)
·
Utiliser des conditions
strictes de brevetabilité et de divulgation pour empêcher les revendications
indûment larges dans les demandes de brevets
·
Prévoir une procédure
d’opposition ou de réexamen à relativement faible coût
·
Prévoir les moyens d’empêcher
la délivrance ou l’application de brevets contenant des matières biologiques ou
des savoirs traditionnels associés obtenus en contravention de la législation
relative à l’accès ou aux dispositions de la CDB
·
Envisager la mise en place
d’autres formes de protection pour encourager l’innovation locale inférieure au
seuil de brevetabilité.
Pays
développés et en développement
·
Appliquer une norme absolue de
nouveauté telle que toute divulgation dans toute partie du monde puisse être
considérée comme faisant partie de l’état de la technique
·
Tenir compte davantage des
savoirs traditionnels lors de l’examen des demandes de brevets
·
Prévoir la divulgation
obligatoire dans la demande de brevet d’informations sur l’origine géographique
des matières biologiques dont l’invention est dérivée.
Pays
les moins avancés
§
Retarder la mise en place d’une protection pour les
produits pharmaceutiques, au moins jusqu’en 2016. Les pays qui prévoient
actuellement une protection pour ces produits devraient réfléchir avec soin à
la modification de leur législation.
*Ces
recommandations sont considérées comme adaptées à la majorité des pays en
développement. Toutefois, pour les pays en développement cherchant à promouvoir
certains secteurs de la technologie, une approche plus sélective pourrait être
souhaitable.
UTILISATION DU SYSTEME DES BREVETS DANS LA
RECHERCHE PUBLIQUE
Introduction
Une évolution
majeure a marqué le monde développé : l’encouragement des brevets dans les
instituts de recherche ou universités financés par l'Etat. La loi Bayh-Dole aux
Etats-Unis a permis aux universités de faire breveter des inventions fondées
sur des recherches financées par l’Etat fédéral, au motif que cela faciliterait
la commercialisation de la recherche et accélérerait l’innovation. Par la
suite, la majeure partie du monde développé a adopté des politiques similaires.
Dans les pays en développement plus avancés du point de vue technologique, on
trouve également un grand nombre d’indications de ce type de brevets. Dans
certains pays en développement, les demandes internationales de brevets (par
l'intermédiaire du système du PCT) proviennent de plus en plus d’universités ou
d'entreprises créées par essaimage. Par exemple, en 2000, les universités et
les instituts de recherche scientifique chinois représentaient 13,2 % des
demandes de brevets du pays.[342] Et en mai 2002, la Chine
a annoncé que les instituts de recherche allaient être encouragés à déposer des
demandes de brevets relatifs aux recherches financées par les pouvoirs publics.[343] En 2001, la principale
organisation scientifique de l’Inde, le Conseil de la recherche scientifique et
industrielle, était le deuxième déposant PCT des institutions des pays en
développement. Parmi les 30 premiers déposants PCT venant de pays en
développement, huit émanaient d’universités ou d’instituts de recherche du
secteur public.[344]
Selon la
théorie appuyant ces politiques, les brevets des institutions du secteur public
et les licences exclusives (ou limitées) sur les technologies concédées au
secteur privé stimulent le nombre d’applications commerciales du savoir. A
moins de négocier l’accès exclusif à ces technologies, allègue cette théorie, les
sociétés n’auraient aucune incitation à investir les ressources nécessaires
pour transformer la technologie en un produit commercialisable. Les opposants
de cette théorie avancent que les
intérêts du transfert de technologie et de l’application commerciale seraient
mieux servis par la diffusion la plus large possible du savoir, au moyen de la
publication.
Il n’est pas
vraiment possible d’affirmer que l’un ou l’autre point de vue est entièrement
vrai ou faux. Tout dépend en grande partie des situations particulières. Traditionnellement, les sciences
« fondamentales » étaient considérées comme l’activité principale du
secteur public/universitaire et les sciences « appliquées » comme
l’activité du secteur privé. Dans le secteur public/universitaire, les incitations
au progrès technique résident dans les systèmes établis de libre divulgation,
de publication, d’examen par les experts et de promotion, et dans le prestige
associé au statut de pionnier pour une découverte. Dans le secteur privé, les
incitations et systèmes de récompenses sont commerciaux et financiers, passant
par différentes formes de protection de la propriété intellectuelle. Il
existait une relation symbiotique et à l’équilibre subtil entre ces deux
systèmes.[345]
Le secteur universitaire apportait non seulement le savoir permettant de faire
avancer le progrès de la science, mais aussi le personnel qualifié nécessaire
au secteur privé.
Dans le monde
moderne, l’innovation est maintenant considérée comme un processus beaucoup
plus complexe et interactif. Jeter le savoir par les fenêtres des universités
et espérer que tout ira pour le mieux n’est plus perçu comme suffisant pour
encourager l’application de ce savoir dans un but d’avantage économique et
social. Ainsi, l’introduction de brevets a été considérée comme le moyen de
modifier la structure des incitations dans le secteur public, afin de remédier
à cette carence. On a également assisté à une érosion de la division, jamais
très claire, entre les sciences fondamentales et les sciences appliquées. Du
fait du développement de la biotechnologie, certains domaines des sciences
fondamentales, comme la génomique, sont maintenant perçus comme présentant une
grande valeur commerciale potentielle. La combinaison de ces deux facteurs a
provoqué, aux Etats-Unis notamment, une augmentation rapide du nombre de
brevets déposés par les universités, notamment dans le domaine biomédical.
Eléments probants des Etats-Unis
Jusqu’ici, les
éléments probants émanant des Etats-Unis sur l’impact de la loi Bayh-Dole en
termes de transfert de technologie ne sont pas conclusifs. Bien qu’une
expansion rapide des brevets des universités se soit produite, comme nous
l’avons observé, cette indication à elle seule ne démontre pas que la
commercialisation des inventions a progressé. Il n’existe pas de preuve
conclusive indiquant que les chercheurs des universités américaines produisent
plus d’inventions ou de meilleures inventions qu’ils l’auraient fait en
l’absence de la loi Bayh-Dole ou, si c’est en réalité le cas, qu’un plus grand
nombre de ces inventions sont commercialisées et appliquées. Les partisans de
la loi Bayh-Dole signalent l’augmentation indéniable non seulement du
brevetage, mais aussi des recettes de licences et du nombre de nouvelles
entreprises créées par essaimage des universités. En 2000, on estimait que les
recettes brutes de redevances des universités américaines s’élevaient à
678 millions de dollars et que plus de 3 000 nouvelles entreprises
avaient été créées depuis 1980.[346] Toutefois, l’augmentation
du nombre de brevets déposés et de licences concédées peut également être
imputée à la croissance de la biotechnologie, combinée au résultat de l’affaire
Diamond contre Chakrabarty, qui a dû contribuer à la progression de l’activité
en matière de brevets à mesure que les universités effectuaient davantage de
recherche à potentiel commercial.[347] En outre, le financement
de la recherche, provenant notamment des Instituts nationaux de la santé (NIH),
a considérablement augmenté entre 1980 et 2000. Et les dépenses de R&D des
institutions universitaires américaines ont progressé de 150 % en termes
réels entre 1980 et 2000.[348] Il est donc difficile de
déterminer avec précision le rôle de la loi Bayh-Dole dans l’expansion des
brevets et, ce qui est plus important, de savoir si son adoption a réellement
fait une différence en termes de croissance du transfert de technologie et de
l’application de la technologie.
Dans le secteur public, les brevets et les licences peuvent constituer des
incitations, aussi bien que des entraves, à l’application des technologies.
L’incitation à la commercialisation repose sur la concession d’une licence exclusive à un partenaire commercial,
au motif que l’exclusion des autres offre une incitation nécessaire au
titulaire de la licence pour supporter le risque d’investir des fonds dans le
développement et la commercialisation. Mais 50 % des licences concédées
aux Etats-Unis en 2000 étaient non
exclusives.[349] Dans la mesure où les
universités brevètent la technologie à titre non exclusif, ces brevets ne
présentent donc, apparemment, aucun avantage en termes de transfert de
technologie, puisque le nombre des utilisateurs potentiels de la technologie en
vue de son développement ultérieur est limité par le contrat de licence et les
coûts, par opposition à la simple publication des résultats de la recherche.
Mais l’incitation au développement et à la commercialisation ultérieurs, qui
repose sur la concession d’une licence exclusive, disparaît. Pour l’essentiel,
la concession de licences non exclusives constitue une taxe sur les
utilisateurs de la technologie.[350] La concession de
licences exclusives semblerait être un facteur important de la mise au point de
technologies naissantes qui demandent un travail de développement ultérieur
considérable. Dans ce contexte, la concession d’une licence exclusive implique
par sa nature la « sélection des gagnants ». Dans certains cas
documentés, le concessionnaire n’a pas commercialisé une technologie que d’autres développeurs
potentiels auraient été peut-être mieux placés pour exploiter. Lorsqu’une
université développe une technologie « prête à l’emploi » pour
laquelle il existe une demande évidente, il est alors clair qu’elle sera en
mesure de recevoir des recettes au titre de son brevet. Mais là encore, le
brevet ne présente aucun avantage supplémentaire en termes de transfert de
technologie puisque la technologie aurait été reprise par le secteur privé de
toute manière.[351]
Pour les
universités qui créent de nouveaux produits et procédés, les brevets peuvent offrir
une source utile de recettes supplémentaires, bien qu’il convienne de mettre
celles-ci en regard des coûts de fonctionnement substantiels d’un bureau de
transfert de technologie, ainsi que des coûts des demandes et du maintien des
brevets. Ainsi, en 1999, l’Université de
Californie (University of California - UC)
a perçu des recettes brutes de 74 millions de dollars en redevances et
droits de licence, contre des charges brutes de 24 millions de dollars
pour le bureau de transfert de technologie. Sur les 50 millions de dollars
de « bénéfices », près de 30 millions de dollars ont été
restitués aux inventeurs de l’université, et le solde restant a servi à
financer la recherche de l’université.[352] Bien entendu, l'UC est l’une des premières
universités de recherche du monde, et le rendement financier moyen des brevets
et des licences aux Etats-Unis est bien plus faible. On estime que, dans les
universités américaines, le financement de nouvelles recherches à partir des
recettes de licences s’élevait à 149 millions de dollars seulement en
1999, contre des dépenses totales de R&D dans les institutions
universitaires américaines de 30 milliards de dollars en 2000.[353]
Eléments probants des pays en développement
Aux Etats-Unis,
il est rare de trouver des preuves de la manière dont les brevets des
universités influencent les priorités de recherche, si c’est effectivement le
cas. Dans les pays en développement, on en trouve encore moins puisque
l’activité en matière de brevets est très faible. Néanmoins, nous estimons
qu’il existe un risque considérable de tensions entre la nécessité d'assurer la
protection de la PI pour les produits des instituts de recherche et la
réalisation de leurs objectifs sociaux plus larges, en particulier ceux qui se
rapportent aux besoins des producteurs pauvres.
Vu
l’insuffisance des éléments probants publiés, nous utilisons à titre d’exemple
l’un des grands instituts de recherche agricole du monde en développement, que
nous avons visité, afin d’illustrer la série de questions auxquelles les pays
en développement seront confrontés lors de l’élaboration de politiques pour le
recours à la PI dans les institutions financées par l’Etat. Nous avons été
frappés à la fois par la vigueur de l’introduction de la protection de la PI et
par l’effort conscient entrepris pour transformer la culture de la recherche,
traditionnellement ouverte. Ce changement de politique envisage la protection
de tous les actifs produits par l’Institut, dans l’objectif de pouvoir concéder
des licences sur ceux-ci afin de produire des revenus, ou de les concéder
gratuitement aux petits agriculteurs participant aux programmes du
gouvernement. Si les directives de l’institut stipulent que cette politique
doit être mise en œuvre sans sacrifier à sa mission sociale, elles précisent
clairement que ne pas rechercher la protection sera l’exception plutôt que la
règle, et que les exceptions devront être examinées par son comité de propriété
intellectuelle. Ce changement de politique est sous-tendu par une exigence du
gouvernement, celle du financement des coûts totaux de l’institution par des
sources non gouvernementales à hauteur de 30 %. L’accent est également
mis, plus ou moins explicitement, sur l’amélioration de la compétitivité
globale de l’agriculture commerciale et à l’exportation, grâce à une
coopération avec le secteur agroalimentaire. En particulier, le développement
de cultures transgéniques est un domaine crucial parce que les grandes sociétés
multinationales détiennent une part considérable de la technologie brevetée nécessaire.[354]
Il est
évidemment trop tôt pour apprécier exactement la manière dont cette politique,
introduite récemment, est susceptible d’influencer les résultats de la
recherche et ses priorités. Nous observons que la politique insiste sciemment
sur l’apport d’avantages financiers aux chercheurs, et à l’institut dans son
ensemble, dans le but d’offrir des incitations. Toutefois, nous pensons qu’il
est très important, lors de l’introduction d’une modification de cette ampleur
des incitations à la recherche et de la culture de la recherche, de veiller à
ne pas compromettre la mission sociale d’un institut de recherche. Le fondement
de la loi Bayh-Dole était la promotion de l’accélération du transfert et de
l’application des technologies, plutôt que la levée de fonds pour les
institutions et les chercheurs du secteur public. Lorsque la raison première
est financière, le gouvernement peut être tenté de réduire ses financements aux
motifs qu’un institut est en mesure de trouver d’autres sources de financement.
Ou bien, les gouvernements pourraient offrir d’égaler le financement
supplémentaire issu des licences de PI. Dans l’un et l’autre cas, il existe un
risque que les priorités de recherche se transforment pour se concentrer sur
les marchés potentiels les plus grands, c’est-à-dire en l’espèce le secteur
agricole commercial, au détriment possible des agriculteurs plus pauvres.
Sur le fondement de ce qui précède, nous estimons
que la propriété intellectuelle a un rôle à jouer au sein des instituts de
recherche publics pour ce qui est d'encourager le transfert et l’application
des technologies. Il est important néanmoins de tenir compte des points
suivants :
·
La création d’autres sources de
financement n’est pas considérée comme l’objectif principal, qui est au contraire
d’encourager les transferts de technologie.
·
Il faut veiller à ce que les priorités de
la recherche, notamment en ce qui concerne les besoins des pauvres en matière
de technologie, que ce soit dans le domaine de l’agriculture ou de la santé, ne
soient pas détournées de leur objectif par la recherche de recettes de licences
plus importantes ;
·
Les instituts de recherche devraient
limiter le dépôt de brevets et l'octroi de licences aux cas où ceux-ci sont
jugés nécessaires pour encourager le développement du secteur privé et
l’application des technologies.
·
il faut envisager soigneusement la
nécessité de délivrer des brevets « défensifs » pour certaines
inventions importantes, notamment afin de les utiliser comme moyen de
négociation lorsque des technologies complémentaires sont la propriété
d’entités du secteur privé et que des concessions réciproques de licences sont
exigées pour avoir accès à ces technologies.
·
il faut développer les compétences en PI
au sein des institutions du secteur public, qui traditionnellement n’en ont
pas, sans perdre de vue les objectifs de la politique officielle de la
recherche.
COMMENT LE SYSTEME DES BREVETS POURRAIT ENTRAVER
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
Les questions dans les pays développés
A mesure que le
système des brevets est appliqué à de nouveaux domaines technologiques, nous
avons vu que la question première est celle de savoir s’il est possible de
trouver un équilibre entre l’encouragement de l’invention réelle de
technologies utiles et la protection de technologies ou procédés mineurs ou
intermédiaires susceptible d’entraver les recherches d’autres personnes.
Nombreux sont ceux qui avancent que les normes de délivrance de brevets, en
particulier aux Etats-Unis, ont été excessivement abaissées, de sorte que trop
de brevets sont délivrés pour des inventions triviales, ou qu'en raison des
pressions pesant sur les examinateurs de brevets, trop de brevets sont délivrés
qui se révèleront nuls devant les tribunaux en cas de contestation.[355]
Le problème qui
se pose aux Etats-Unis a été décrit de la manière suivante :
« … notre système
des brevets, s’il stimule assurément l’innovation dans l’ensemble, risque
d’imposer une charge trop lourde sur l’innovation en permettant aux titulaires
de droits multiples de « taxer » les nouveaux produits, moyens, voire
procédés commerciaux. Le très grand nombre de brevets délivrés actuellement
crée un risque très réel qu’un seul produit ou service porte atteinte à
plusieurs brevets. Pire encore, de nombreux brevets couvrent des produits ou
procédés déjà largement utilisés au moment de la délivrance du brevet, ce qui
rend la tâche plus difficile pour les sociétés qui développent réellement leur
activité et fabriquent des produits lorsqu’elles souhaitent inventer autour de
ces brevets. Si l’on ajoute à cela le fait que le titulaire d’un brevet peut
demander une injonction, c’est-à-dire qu’il peut menacer de fermeture les
opérations de la société contrevenante, la possibilité de « hold-up »
ne devient que trop réelle. »[356]
Cette situation
pourrait entraîner un comportement des sociétés ou institutions publiques qui
semble pervers du point de vue social. Les organisations pourraient faire
breveter des produits ou procédés afin d’interdire aux autres l’accès à
certains domaines de la recherche, ou pour s’assurer que d’autres organisations
ne peuvent pas bloquer leur propre recherche. Elles pourraient aussi développer
des portefeuilles de brevets en tant qu’outil de négociation, grâce auquel
elles pourront obtenir l’accès à des technologies appartenant à d’autres
sociétés, par le biais de la concession réciproque de licences. Cette
caractéristique concerne notamment les petites sociétés de haute technologie.
Nous notons au Chapitre 3 l’importance de ce type de stratégie dans le secteur
de la biotechnologie agricole, et la mesure dans laquelle elle pourrait
déboucher sur des litiges et des procès coûteux en matière de brevets et aurait
des répercussions possibles sur la concurrence et la concentration.
Le problème a
été bien exprimé récemment par un cadre de CISCO, dans une soumission à la
Commission fédérale du commerce américaine :
« Ainsi, l’obtention de brevets est devenue
pour beaucoup de personnes et de sociétés une fin en soi, non pas pour protéger
un investissement dans la recherche-développement, mais pour produire des
recettes en accordant des licences aux (en tenant en « hold-up » les)
autres sociétés qui fabriquent et vendent de fait des produits sans avoir
connaissance de leurs brevets. Elles essaient de faire breveter des éléments
que d’autres personnes ou sociétés contreferont involontairement et attendent
ensuite que ces sociétés réussissent à introduire ces produits sur le marché.
Elles placent des mines dans un champ de mines. Les personnes et sociétés … qui
déposent ces brevets et extraient des droits de licence d’entreprises prospères
conçoivent le système des brevets comme une loterie… Les longs retards de
l’office des brevets servent leurs intérêts en maintenant illimitée la
couverture finale de leurs brevets, tandis que d’autres produisent les
produits. Elles tirent parti du coût élevé des litiges en demandant des droits
de licence inférieurs au coût des litiges, dans l’espoir que les gens paieront,
même s’ils ne portent pas atteinte à des brevets, ou, s'ils le font, qu'il leur
sera trop coûteux de modifier le produit. Cette situation offre des
opportunités aux avocats engagés en vertu d’un contrat à commission finale, aux
sociétés concédantes de licences et aux sociétés de conseil qui prétendent
aider les gens à « extraire » de leurs portefeuilles des brevets dont
ils ne se savaient même pas titulaires. Il est difficile de voir comment une
telle situation contribue au progrès de la science et de l’art utile. »[357]
Bien entendu,
certains avancent que cette situation est le prix à payer en échange l’effet
stimulant des brevets, et qu’il est possible d’appliquer des stratégies de
concession de licences pour atténuer les effets négatifs les plus graves.
Toutefois, si l’échelle du problème et le degré d’entrave quant aux incitations
à la recherche sont discutables, notre souci principal est que les pays en
développement évitent chaque fois que possible la création de problèmes
similaires dans leur propre régime de DPI.
Le problème des
instruments de recherche s’applique aux secteurs public et privé. Les instruments de recherche ont été définis
comme englobant « l’éventail complet des ressources que les scientifiques
utilisent dans les laboratoires, bien que, sous un autre angle, ces mêmes
ressources puissent être considérées comme des produits finals ».[358] Dans le secteur public,
ils sont considérés comme un problème, en particulier lorsqu’une université
souhaite accéder, par exemple, à la technologie brevetée d’une autre à des fins
de recherche, ce que certains considèrent comme un effet pervers lorsque les
deux sont financées par des fonds publics. Mais il s’agit d’une conséquence
logique de l’introduction des brevets sur la scène universitaire. Et ce problème potentiel existe dans tous les
sens : les universités peuvent souhaiter avoir accès à des technologies du
secteur privé et inversement. Comme nous l’avons vu, les sociétés du secteur
privé peuvent avoir du mal à accéder aux technologies les unes des autres, ce
qui conduit à plusieurs stratégies défensives visant à tenter de surmonter ces
difficultés.
Des études
récentes exécutées aux Etats-Unis permettent de penser que, malgré
l’augmentation des brevets sur les instruments de recherche (comme les
séquences de gènes) nécessaires à la découverte de médicaments, il n’est pas
manifeste que la découverte de médicaments ait été substantiellement perturbée.[359] Diverses stratégies ont
été adoptées pour atténuer les problèmes éventuels. Parmi ces stratégies, on
compte la souscription de licences sur des brevets susceptibles de bloquer la
recherche, l’invention autour des brevets, le déplacement vers des domaines de
la recherche dans lesquels la liberté de fonctionnement est plus grande, le
transfert de la recherche à l’étranger ou, simplement, la contrefaçon (ou
l’invocation informelle d’une exemption de recherche). Ainsi, les organisations
ont généralement trouvé des moyens de contourner ces problèmes. Néanmoins, les
coûts de transaction de la recherche ont augmenté et des retards se produisent.
Il faut en effet identifier les brevets interdisant l’accès, organiser des
négociations avec les parties concernées et acquitter des coûts de licence et
de justice. Toutefois, des adaptations du cadre institutionnel sont
intervenues. Comme nous l’avons mentionné, l'USPTO a publié de nouvelles directives
sur les brevets, qui relèvent le seuil d’utilité pour les brevets sur les
gènes.[360]
Les NIH ont également introduit de nouvelles directives conçues pour atténuer
les problèmes dans la recherche biomédicale.[361] Les études auxquelles
nous nous référons ici ont conclu que, si les instruments de recherche
généraient un coût social, il était toutefois peu probable que celui-ci dépasse
les avantages de l’incitation émanant de la protection des instruments de
recherche.[362]
Intérêt pour les pays en développement
Bien sûr, cela
ne veut pas dire qu’il ne serait pas souhaitable de réduire les coûts sociaux
issus des instruments de recherche en cas d’impact négatif sur les avantages du
système. Comme nous l’avons observé plus haut, les pays en développement peuvent
atténuer ces difficultés en adoptant un système des brevets adapté, assorti de
limitations aux brevets sur les gènes et d’exemptions adéquates pour la
recherche. Mais cela ne suffira pas entièrement à régler le problème. Une
grande partie de la recherche présentant un intérêt pour les pays en
développement peut être effectuée dans les pays développés ou en collaboration
avec des chercheurs des pays développés. En pareil cas, les règles s’appliquant
dans les pays développés seront pertinentes.
S’il est possible
que, dans l’ensemble, l’impact total des brevets sur les instruments de
recherche ne soit pas substantiel, une grande partie des priorités de recherche
intéressant les pays en développement est axée sur des domaines de recherche
relativement étroits, où il peut être difficile de contourner un problème
suscité par les instruments de recherche. A titre d’exemple de cette situation,
rattachant également le problème général à celui des pays en développement, on
peut citer le brevet sur le récepteur CCR5, ultérieurement identifié comme un
élément important de la transmission du virus VIH/SIDA.
Encadré 6.2 Le brevet sur le gène CCR5
La société américaine Human
Genome Sciences Inc. (HGS) a isolé le gène CCR5 lors de son séquençage du
génome humain. La société a cherché dans
des bases de données des homologues présentant des séquences génétiques connues
et a conclu qu’elle avait trouvé un gène appartenant à la famille des
récepteurs membranaires, et a déposé une demande de brevet.
En février 2000, le brevet
américain n° 6.025.154 pour « le polynucléotide HDGNR10 (maintenant appelé
CCR5) codant le récepteur chimiokine protéine G humain » a été délivré à
HGS, brevet qui contenait une revendication large couvrant le gène et toutes
ses utilisations médicales, comme les
thérapies de blocage ou d’activation de la fonction du récepteur.
Par la suite, des
scientifiques de divers centres universitaires (dont le Centre de recherche sur
le SIDA Aaron Diamond (Aaron Diamond AIDS
Research Centre) et les Instituts nationaux de la santé) ont découvert que
le gène CCR5 produisait un récepteur protéique que le virus VIH utilisait pour
accéder à une cellule immunitaire.
Le récepteur est une
molécule transmembranaire que l’on trouve à la surface des cellules du système
immunitaire et qui les relie au site de tissus endommagés ou de maladies. Le
virus VIH tire parti de ces récepteurs pour s’attacher à la cellule et y
accéder.
Une certaine mutation du
gène CCR5, contenant une délétion d’une séquence de 32 paires de bases,
provoque une mutation de changement de phase sur les bases de la séquence
d’ADN. Cela entraîne un récepteur
protéique tronqué, qui est alors incapable d’atteindre la surface de la
cellule, empêchant ainsi le virus VIH d’infecter les cellules ou ralentissant
le rythme d’infection.
Les personnes présentant une
mutation du gène CCR5 sont beaucoup moins vulnérables à l’infection par le VIH.
Le gène pourrait être le moyen d’identifier une nouvelle catégorie de
traitement pour les patients souffrant du VIH/SIDA, comme un médicament qui
pourrait bloquer le récepteur protéique.
Au moment où HGS a isolé le
gène CCR5 et a demandé son brevet, la société ne savait pas que le récepteur
était l’un des points d’entrée du virus VIH dans les cellules humaines.
Toutefois, l’ampleur des revendications du brevet signifie que HGS a des droits
sur toute utilisation du gène, ce qui lui permet de demander des redevances par
voie de contrats de licence.
Bien que HGS soit en fait
déjà convenue de plusieurs licences pour l’utilisation du gène récepteur CCR5
dans la recherche de nouveaux médicaments, l’exemple illustre les dangers
possibles de la délivrance de brevets sur des inventions qui ne sont en réalité
que des découvertes, dans lesquelles l’utilisation revendiquée est simplement
spéculative et se fonde sur une connaissance incomplète de la fonction du gène.
Nous avons
également examiné en détail une affaire impliquant l’utilisation de séquences
d’ADN brevetées dans la recherche sur le paludisme. L’Initiative Vaccin contre
le paludisme (MVI) a identifié une protéine antigène particulière (MSP-1) qui
pourrait être cruciale dans la mise au point d’un vaccin efficace contre le
paludisme. La propriété des brevets
relatifs à cette protéine a été étudiée, révélant des résultats
surprenants :
·
Les
brevets des séquences d’ADN de l’antigène sont très complexes. Jusqu’à
39 familles de brevets pourraient concerner la mise au point du vaccin à
partir de MSP-1.
·
Au
début de la recherche sur MSP-1, des brevets ont été accordés sur le fondement
de bases scientifiques que la recherche ultérieure a révélée comme étant
inexactes.
·
Les
mentions de l’état de la technique paraissent incomplètes dans nombre de
demandes de brevets, aussi est-il difficile de relier un brevet à un autre.
·
Sur
ce fondement, plusieurs des revendications des brevets semblent invalides (ce
qui ne peut être confirmé que par des recours judiciaires ou un réexamen). En général, la portée des revendications
faites (qui détermine le potentiel de contrefaçon) semble plus large qu’elle ne
devrait l’être.[363]
Face à cette
situation, une organisation de recherche commerciale pourrait décider de passer
à un autre domaine de recherche. Dans le
cas de la MVI (qui a été créée avec un financement caritatif pour accélérer la
mise au point de vaccins contre le paludisme), il n’y a pas d’autre option que
de chercher à comprendre et à gérer cette complexité, avec les coûts de
transaction élevés (en temps et en argent) que cela implique. Ce faisant, la
MVI a découvert que, bien qu’il soit peu probable que le vaccin contre le
paludisme ait une valeur commerciale significative, les titulaires des brevets
intermédiaires accordent souvent une valeur excessive à leurs
technologies. Il est possible de résoudre
cette situation en cédant une part des redevances aux titulaires des brevets
intermédiaires, mais cela entraîne ensuite un problème éventuel de
« concentration des redevances », dans lequel les redevances qui
doivent être versées aux intermédiaires pourraient être excessives par rapport
aux redevances perçues sur le produit final.
Des problèmes
similaires sont apparus dans le domaine agricole. Ces problèmes surgissent
principalement dans le contexte du GCRAI. Le principal problème est apparu en
matière d’accès à des technologies particulières dont les centres du GCRAI ont
besoin pour entreprendre des recherches.[364] Dans plusieurs cas, la
question centrale a porté sur les conditions auxquels les titulaires de brevets
concéderont les licences. Ces conditions comprennent des contrats qui précisent
qu’une technologie peut être utilisée pour « la recherche
uniquement » et des conditions de « licences croisées » (reach through) qui ont des implications
pour toutes nouvelles inventions développées au moyen de l’application de la
technologie. Dans un cas particulier, la négociation d’une licence a demandé
plusieurs années car le titulaire du brevet avait accordé une licence exclusive
à une société. Dans un autre cas, les conditions de licence exigées pour
l’accès à une base de données propriétaire sur le génome d’une variété de riz
étaient inacceptables. Le GCRAI a également rencontré des restrictions, ou des
coûts excessifs, à l’accès aux bases de données scientifiques dont il a besoin
pour son travail. Ces problèmes ont été exacerbés par l’entrée en vigueur de la
directive européenne sur les bases de données. Enfin, on trouve l’affaire
célèbre du riz doré (Golden Rice)
(voir Encadré 6.3).
L’affaire du
riz doré illustre également la prédominance des malentendus quant à la nature
territoriale des DPI. Les chercheurs de centres de recherche nationaux ou
internationaux situés dans les pays en développement peuvent s’inquiéter
inutilement de brevets sur des technologies qui sont valables à l’étranger,
mais qui ne s’appliquent pas dans le pays où se trouve le centre. Dans certains
cas, leur souci peut provenir d’un désir de ne pas irriter les fournisseurs de
technologie dont le savoir et les compétences peuvent être nécessaires, ou les
bailleurs de fonds des pays développés qu’ils peuvent percevoir comme souhaitant
protéger les DPI.
Encadré 6.3 Riz doré
Les cultures de subsistance
ou les cultures vendues aux consommateurs pauvres des pays en développement
présentent peu d’intérêt commercial pour les sociétés multinationales, et on a
observé des cas où les sociétés ont accordé des licences sans redevance à des
institutions de recherche agricole du secteur public travaillant avec leurs
technologies brevetées pour le compte des agriculteurs pauvres du monde en
développement. L’affaire du riz doré est un exemple célèbre de ce type de
situations.
Le riz doré contient des
niveaux accrus de vitamine A, ce qui peut offrir de grands avantages en matière
de santé dans les pays en développement, où 100 millions de personnes
(surtout des enfants) souffrent de carences en vitamine A (condition qui
provoque la cécité). En août 1999, lors
d’une collaboration sur un projet de recherche financé par la Fondation
Rockefeller, les scientifiques Ingo Potrykus (Institut fédéral suisse de technologie)
et Peter Beyer (Université de Fribourg) sont parvenus à insérer trois gènes
(deux provenant de la jonquille et un d’une bactérie) dans le génome du riz, de
sorte que le bêta carotène, précurseur de la vitamine A, soit exprimé dans le
grain de riz.
Toutefois, selon un rapport
de 2000 de l'ISAAA[365],
70 brevets sur des procédés et produits étaient associés à la technologie
du riz doré ; les gènes et méthodes utilisés étaient la propriété
intellectuelle de 32 sociétés et universités. Les complexités de la navigation
dans ce réseau de brevets, afin que le riz puisse être développé plus avant,
testé et commercialisé, se sont révélées très onéreuses pour les scientifiques
qui, en mai 2000, ont négocié un accord avec AstraZeneca (appartenant
maintenant à Syngenta, première société mondiale de biotechnologie agricole).
Syngenta a acquis les droits
sur le riz doré, lui permettant d’exploiter le potentiel commercial de la
technologie, et en échange, a accepté de permettre la distribution du riz sans
redevance aux agriculteurs qui gagnent moins de 10 000 dollars par an et
vivent dans des pays en développement. Elle a ensuite continué à collaborer
pendant toute l’année 2000, contactant les sociétés (dont Bayer et Monsanto)
titulaires de brevets essentiels à la technologie du riz doré, pour obtenir des
« dons » de licences sans redevance similaires.
Toutefois, dans les pays où une
technologie ne fait pas l’objet d'une protection locale de la PI, n’importe qui
est libre de l’utiliser, à des fins de subsistance ou commerciales et que cette
technologie fasse ou non l'objet d'une protection de la PI dans un autre pays.
D’autres études sur les DPI entourant la technologie indiquent que la plupart
des pays en développement ont peu ou pas de brevets associés au riz doré.[366]
Ainsi, les chercheurs et les agriculteurs de ces pays auraient, de toute
manière, été libres de développer, cultiver et vendre le riz doré sans porter
atteinte aux DPI ou risquer de procès, même sans les dons de licences très
médiatisés des multinationales. Bien entendu, la situation serait différente
pour les producteurs qui souhaitent exporter vers des marchés où la technologie
est soumise à une protection par brevet.
Plusieurs
initiatives en cours cherchent à identifier l’intérêt personnel réciproque des
différentes parties, de manière à minimiser les problèmes d’accès à des
technologies protégées, et à abaisser les coûts de transaction et autres. Les
sociétés pharmaceutiques, bien que très soucieuses des brevets sur leurs
produits commercialisés, sont généralement désireuses d’éviter les brevets sur
des technologies qui entrent dans leur travail de recherche. Ainsi, en 1999,
dix grandes entreprises pharmaceutiques et la Fondation Wellcome (Wellcome Trust) du Royaume-Uni ont créé
un consortium[367]
pour identifier et établir la carte de 300 000 SNP communs.[368] Le consortium a produit
une carte largement acceptée, de haute qualité, extensive et mise à disposition
du public, qui utilise les SNP en tant que marqueurs distribués régulièrement
dans le génome humain, dont la plupart seront utilisés afin de localiser des
cibles pour la recherche sur les médicaments.
Plus récemment, l'International Genetics Consortium,[369] financé par un grand
groupe d'entreprises pharmaceutiques, d’universités et de fondations, a annoncé
la construction de grandes installations visant à réaliser l’expression de
séquences de gènes à grande échelle sur des échantillons de tissu, en
commençant par un projet majeur sur le cancer. Là encore, les résultats seront
portés à la connaissance du public.
Plusieurs
partenariats public-privé (PPP) ont développé des stratégies de propriété
intellectuelle cherchant à concilier les intérêts des titulaires de brevets et
l’objectif de mise à disposition des produits à des prix abordables dans le
monde en développement. Ces stratégies
impliquent généralement des accords contractuels relatifs à la propriété
intellectuelle éventuellement créée. Ainsi, les droits de commercialisation sur
le marché du monde développé pourraient être cédés à un partenaire commercial
en échange d’une licence sans redevance pour le monde en développement en
faveur de l’entité PPP. Nombre d’autres stratégies peuvent être envisagées pour
équilibrer les objectifs de l’entité PPP et la nécessité d’offrir des
incitations valables au partenaire commercial. Une expertise considérable dans
ces domaines a été développée, entre autres, par l’Alliance mondiale pour la
mise au point de médicaments antituberculeux, l’Initiative internationale pour
un vaccin contre le SIDA et l’opération Médicaments antipaludiques.[370] Une nouvelle institution,
le Centre pour la gestion de la propriété intellectuelle en matière de
recherche et de développement pour la santé (Centre for the Management of Intellectual Property in Health Research
and Development - MIHR), est en cours de constitution et cherchera à
identifier les « meilleures pratiques » dans ce domaine et à offrir
des services de formation et d’assistance.
Dans le secteur agricole, deux organisations
offrent des services similaires d’assistance et d’information en matière de PI
pour la biotechnologie en faveur des pays en développement. CAMBIA en Australie
est, entre autres, en train de développer des bases de données conviviales qui
permettront aux chercheurs d’identifier plus facilement des partenaires
pertinents dans leur domaine d’intérêt.[371]
Le Service international pour l'acquisition des applications
d'agro-biotechnologie (ISAAA) est une organisation à but non lucratif qui vise
à apporter les avantages des nouvelles biotechnologies agricoles aux pauvres
des pays en développement. Il est
parrainé par des institutions des secteurs public et privé et a pour objectif
le transfert et l’apport d’applications de biotechnologie adaptées aux pays en
développement, la création de partenariats entre les institutions du Sud et le
secteur privé du Nord, et le renforcement de la collaboration Sud-Sud.[372]
De nouvelles initiatives visant à encourager l’accélération de la recherche
biotechnologique dans l’agriculture ont été proposées.[373]
Il est nécessaire de poursuivre le développement
d’institutions et de stratégies comme celles-ci, qui chercheront à faciliter le
développement et l’acquisition des technologies nécessaires pour la recherche
intéressant les pays en développement, à exploiter au mieux les opportunités
offertes par la PI et à contribuer à régler les difficultés associées à la
prolifération des brevets sur les instruments de recherche. Nous estimons
également que, lors de l’élaboration de ces initiatives, il est important de
continuer à porter l’attention sur les possibilités d’amélioration des systèmes
de brevets, tant dans les pays développés que dans les pays en développement,
afin de prévenir l’apparition de certains des problèmes que ces initiatives
cherchent à résoudre. Les règles du jeu, tout comme la manière dont il se
déroule, sont des considérations importantes pour les pays en développement.
HARMONISATION INTERNATIONALE DES BREVETS
Contexte
L’internationalisation
croissante du commerce, alliée à l’harmonisation internationale croissante des
législations et des pratiques en matière de brevets et à la simplification des
procédures de demande dans le cadre du système du PCT, a conduit à une
augmentation rapide du nombre de demandes de brevets. L’augmentation de la demande, illustrée dans
la Figure 6.1, s’est poursuivie au XXIe siècle.
Cette flambée de la
demande a conduit, ce qui n’est pas étonnant, à une augmentation de l'arriéré
de demandes de brevets en attente de traitement dans les offices des brevets et
à une extension des délais d’obtention des brevets. Ainsi, le délai moyen à
l’Office chinois des brevets est maintenant de 46 mois environ, comparable
à celui des autres grands offices. A court terme, tous les grands offices des
brevets recrutent de nouveaux examinateurs de brevets (l'USPTO a embauché
460 nouveaux examinateurs en 2001 et prévoit d’en engager encore 600
environ en 2002). Même lorsque de nouveaux examinateurs ont été nommés, il
reste peu probable que le système des brevets satisfera les demandes de
délivrance rapide et relativement bon marché de brevets de bonne qualité.
Figure 6.1 La demande de droits
de brevet dans le monde, 1995-1999
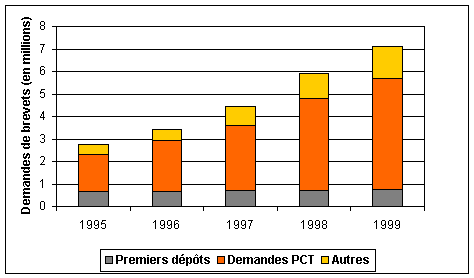
Reproduit à partir du site
web trilatéral OEB/JPO/USPTO. Source : http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/tsr2000/graph3-1.htm
A court et moyen
termes, il est peu probable que les offices des brevets se mettent à
reconnaître le travail effectué par d’autres offices sur des demandes
correspondantes (demandes revendiquant le même objet pour l’essentiel). Par
exemple, si une demande de brevet est déposée et examinée aux Etats-Unis, une
demande correspondante déposée à l’OEB pourrait ne pas exiger de nouvelle
recherche par l’OEB, mais pourrait plutôt se fonder sur celle exécutée aux
Etats-Unis. Les avantages, en termes de réduction des coûts pour le déposant et
de réduction de la charge de travail pour les offices, rendent une telle
reconnaissance mutuelle intéressante pour tous.
Lors de la
Conférence de l’OMPI sur le système international des brevets en mars 2002,[374]
il était clair que la question de la reconnaissance mutuelle attirait une plus
grande attention. Des comparaisons de la qualité des recherches offertes par
les grands offices sont en cours et il semble inévitable qu’une forme de reconnaissance
mutuelle ou unilatérale (selon laquelle un pays décide simplement d’accepter
les résultats de la recherche exécutée par un autre office) des recherches
entre les grands offices se produira prochainement. Toutefois, les différences
majeures des conditions de brevetabilité, notamment dans les domaines de haute
technologie comme la biotechnologie et les logiciels informatiques, signifient
que la reconnaissance mutuelle des rapports d’examen entre les grands offices
des brevets peut demander une harmonisation plus poussée. Cette harmonisation
pourrait également constituer un petit pas important vers le but ultime de
certains acteurs du monde des brevets : un brevet mondial unique, valable
en toute partie du monde.
Traité de l’OMPI sur le droit matériel des brevets
Des débats sur une
harmonisation plus poussée du droit matériel des brevets sont actuellement en
cours à l’OMPI, et nous avons déjà eu un avant-goût de ce que pourrait être le
résultat de ces discussions. En 1991, un traité sur le droit matériel des
brevets avait presque été convenu à l’OMPI. Tandis que les pays en
développement avaient déposé plusieurs propositions lors des négociations, le
traité définitif était, pour l’essentiel, un hybride des législations en
vigueur dans plusieurs pays développés, notamment aux Etats-Unis et dans l’UE.
Comme le délégué d’un pays en développement l’a observé, il était paradoxal
que, par un processus d’harmonisation, la majorité des pays soit priée
d’aligner son droit sur les dispositions d’une minorité.
L’échec de ces
négociations a été, toutefois, suivi de près par un accord sur le texte de
l’Accord sur les ADPIC, qui représentait un progrès considérable en matière
d’harmonisation du droit matériel des brevets dans le monde. Mais même avec
l’Accord sur les ADPIC, il reste des différences entre les législations en
matière de brevets de nombreux pays, dont celles des Etats-Unis et de l’UE. Les
nouvelles discussions au sein de l’OMPI, qui ont commencé au début de 2001,
cherchent à supprimer ces écarts. Mais quelle est la forme probable que
revêtira le traité et comment les pays en développement devraient-ils aborder
ces discussions ?
Bien que les
discussions ne fassent que commencer, il semble probable, sur le fondement des
projets déjà élaborés par l’OMPI[375]
et des indications de certaines des grandes nations, que tout traité reposera
essentiellement sur le système du premier déposant[376],
assorti d’un délai de grâce adéquat. Il est aussi possible qu’il soit tenté de
supprimer plusieurs assouplissements actuellement prévus par l’Accord sur les
ADPIC, dont nous avons parlé plus haut. Par exemple, le traité pourrait
chercher à définir ce qui constitue une invention brevetable et comment les
conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle
doivent être déterminées.
Il est clair que
les pays en développement doivent se soucier de veiller à ce que ces
assouplissements ne soient pas abandonnés, à moins qu’il puisse être démontré
qu’il est dans leur intérêt d’adopter de nouvelles règles internationales
limitant leur liberté de concevoir des politiques de PI appropriées. Nous avons
suggéré ci-dessus le type de système des brevets qui, selon nous, serait adapté
aux intérêts des pays en développement. Les pays en développement, comme nous
l’expliquons au Chapitre 7, sont confrontés à des obstacles formidables
dans la mise en œuvre des systèmes de brevets. S’ils cherchent à adopter des
normes de brevets plus strictes, les problèmes institutionnels et
administratifs se révèleront sans doute encore plus lourds.
Il faut que les pays en développement définissent une
stratégie permettant de faire face au risque qu’une nouvelle harmonisation de
l’OMPI conduise à l’élaboration de normes qui ne tiennent aucun compte de leurs
intérêts. Une telle stratégie pourrait viser une norme mondiale qui prenne en
compte les recommandations du présent rapport. Elle pourrait conserver certains
assouplissements dans les normes de l’OMPI. Ou bien encore rejeter le processus
de l’OMPI, s’il s’avère que les résultats vont à l’encontre des intérêts des
pays en développement.
Mais nous
pensons que nombre de nos suggestions visant à l’amélioration du système des
brevets sont également pertinentes pour les pays développés, en raison
précisément des préoccupations concernant la surcharge du système par le
traitement des demandes de brevets, dont une part significative ne serait sans
doute pas brevetable aux termes des réformes que nous proposons.
Les discussions
sur la réforme des brevets et l’harmonisation se sont concentrées jusqu'ici sur
la manière d’améliorer l’efficacité du système mondial actuel des brevets par
la rationalisation des procédures, l’élimination des doubles emplois et la
poursuite de l’harmonisation de manière plus générale.[377] Mais il été accordé peu
de réflexion à la qualité des brevets délivrés, aux ressources utilisées pour
faire valoir et contester les droits de brevet, et à la mesure dans laquelle
les avantages du système en termes d’encouragement du progrès technique
dépassent ses coûts économiques, administratifs et d’application. La demande
constamment croissante de brevets est considérée comme un droit qui doit être
satisfait par l’augmentation de la productivité du processus de délivrance au
détriment d’une nouvelle réduction potentielle de la qualité. Nous estimons que
les législateurs des pays développés et en développement devraient chercher à
s’écarter de la quantité et à faire de nouveau pencher l’équilibre vers la
qualité. Moins de brevets et des brevets de meilleure qualité, qui restent
valables devant les tribunaux, serait à long terme le moyen le plus efficace de
réduire la charge des grands offices des brevets et, ce qui est plus important,
d’assurer un large soutien au système des brevets.
Chapitre 7
CAPACITES INSTITUTIONNELLES
INTRODUCTION
Les pays en
développement sont confrontés à des défis institutionnels formidables lors de
la mise en œuvre d’une protection de la PI, ainsi que l'exige l’Accord sur les
ADPIC. Puisque la majorité des pays en développement ayant des capacités
technologiques et scientifiques limitées retireront peu d’avantages à moyen
terme de l’exécution de leurs obligations au titre de l’Accord sur les ADPIC,
il leur faut tout particulièrement veiller à limiter le coût humain et en
ressources de l’instauration de régimes de PI. Parallèlement, ces nations
doivent s’assurer que leur régime national de PI opère dans l’intérêt public et
que sa réglementation est efficace. Les pays en développement plus avancés du
point de vue technologique souhaiteront aussi s'assurer que leur régime de PI
complète et stimule leurs politiques plus larges d’encouragement du
développement technologique et de l’innovation.
Parmi ces défis,
nous pouvons citer la formulation d'une politique et d'une législation
appropriées, l’administration des DPI en conformité avec les obligations
internationales ainsi que la sanction et la réglementation des DPI d’une
manière favorable à la concurrence et adaptée aux niveaux nationaux de
développement. Bien entendu, nombre de ces défis politiques et institutionnels
liés à la PI sont communs à tous les pays, mais ils sont particulièrement aigus
pour de nombreux pays en développement. Il est d’ailleurs important de ne pas
oublier que le cadre économique et réglementaire des pays en développement dont
les régimes de PI sont en cours de révision, conformément à l’Accord sur les
ADPIC, est souvent très différent de celui des pays développés.
Ceci implique des
choix difficiles. Un pays en développement devrait-il, à défaut de ressources
propres, se satisfaire du réenregistrement de brevets qui ont été délivrés dans
un pays développé ? Ou devrait-il tenter de développer des capacités
nationales en matière d’examen des brevets, afin d’appliquer les normes de
brevetabilité différentes qui, selon nous, seraient appropriées ? Dans la
situation actuelle, il s’agit d’une tâche très difficile pour les institutions
chargées de l’administration des DPI dans la plupart des pays en développement.
Dans ce chapitre, nous examinons les questions suivantes :
·
Quelles sont les conditions
nécessaires pour rendre efficaces la politique et la législation en matière de
PI dans les pays en développement ?
·
Comment les pays en développement
devraient-ils aborder la mise en œuvre de la politique de PI et la sanction des
DPI ?
·
Comment les pays développés et les
institutions internationales peuvent-ils apporter une assistance technique
efficace aux pays en développement ?
ELABORATION DE POLITIQUES ET LEGISLATIONS EN MATIERE DE PI
Comme la majorité
des pays en développement, dont les PMA, sont membres de l’OMC ou sont en train
de le devenir, la mise en œuvre de l’Accord sur les ADPIC exige une
modification de leur législation relative à la propriété industrielle et au
droit d’auteur. Dans certains domaines, les modifications seront relativement
mineures. Dans d’autres, une législation entièrement nouvelle est nécessaire.
Nombre de pays en développement ont déjà modifié leur législation en matière de
PI pour se conformer à l’Accord sur les ADPIC et respecter la date limite de
janvier 2000. Jusqu’ici, beaucoup moins de PMA ont procédé aux réformes
juridiques et institutionnelles nécessaires pour la mise en pratique de
l’Accord sur les ADPIC. En dehors de l’Accord sur les ADPIC, les pays qui ne
sont pas déjà parties à des traités internationaux comme les Conventions de
Paris et de Berne peuvent choisir d'y adhérer, ce qui entraînera de nouvelles
modifications de la législation.
Les pays en
développement se trouvent également face à des choix concernant d’autres
réformes liées à la PI, comme la conception de systèmes de protection
appropriés pour les variétés végétales et les matières phytogénétiques, la
protection éventuelle des savoirs traditionnels au sein du système de PI formel
et les moyens de l'assurer ainsi que la réglementation de l’accès et la mise en
œuvre du partage des avantages issus des ressources biologiques nationales,
tels qu’envisagés par la CDB. A l’heure actuelle, peu de pays ont adopté des
législations dans ces domaines. En dehors des questions de législations ou de
capacités, cette situation reflète peut-être aussi un défaut de consensus
politique quant aux politiques à adopter. Outre la modification de la
législation en matière de PI, les pays en développement doivent également
envisager des réformes complémentaires dans des domaines connexes du cadre
réglementaire intérieur, comme la politique en matière de science et de
technologie et la législation relative à la concurrence.
Elaboration de politiques intégrées
Souvent, les pays
en développement sont confrontés à des problèmes particuliers pour élaborer une
politique exhaustive et coordonnée en matière de PI qui, pour beaucoup,
constitue un domaine politique relativement nouveau.[378]
Le stimulant des changements de politique de PI provient généralement des
accords internationaux que le pays a signés sans nécessairement avoir une idée
précise de la manière dont ils peuvent être mis en œuvre au plan national (par
exemple, l’Accord sur les ADPIC ou la CDB). Au sein du gouvernement, la PI est
une « question interdisciplinaire » classique, touchant les intérêts
de plusieurs ministères aux positions différentes qu’il s’agira de concilier.
En général, les groupes sectoriels et autres organisations de la société civile
ayant un intérêt à la question ou une opinion particulière sur celle-ci feront
également pression sur les ministères. Des gouvernements étrangers peuvent en
outre exercer des pressions formelles ou informelles, lorsqu’ils estiment que
leurs intérêts sont en jeu. Aussi le processus d’élaboration de politiques
est-il compliqué.[379]
Dans l’idéal, la formulation de la politique de PI dans un pays en
développement serait fondée sur une appréciation juste de la manière dont le
système de PI pourrait être utilisé pour favoriser la réalisation des objectifs
de développement. Cette appréciation devrait reposer sur une analyse de la
structure industrielle du pays, des modes de production agricole et des besoins
en matière de soins de santé et d’éducation. Toutefois, les connaissances
spécialisées et les données factuelles nécessaires pour entreprendre cette
tâche sont souvent très insuffisantes.
En réalité, dans
beaucoup de pays en développement, les capacités institutionnelles sont en
général faibles, et on observe en particulier une pénurie de fonctionnaires
expérimentés et qualifiés. La majorité des pays en développement affichent une
grande dépendance à l’égard de l’assistance technique offerte par l’OMPI et
d’autres organismes, qui prend la forme de projets de lois, de conseils
d’experts et de commentaires sur les nouveaux projets de législation.[380]
Selon un observateur :
« Les PMA en
particulier ne disposent pas d’experts locaux capables d’évaluer l’adéquation
des législations modèles internationales avec les conditions économiques,
sociales et culturelles locales. Les PMA manquent souvent de connaissances
spécialisées en matière de rédaction et sont tributaires de rédacteurs
législatifs externes, qui peuvent être importés des systèmes juridiques
occidentaux avec lesquels le PMA a des liens historiques, à titre de
consultants ou sur une base contractuelle pour une période déterminée. Ce
problème est particulièrement grave dans le cas de la PI, puisque très peu de
personnes possèdent à la fois les connaissances techniques spécialisées de
rédaction législative et une expertise en droit de la PI. » [381]
Ainsi, comme le
processus d’élaboration de politiques est complexe et technique, les
gouvernements peuvent chercher à le court-circuiter, notamment lorsque des
dates limites ont été convenues au niveau international. Ils peuvent donc
laisser à leurs propres experts en PI, le cas échéant, le soin d’élaborer la
législation avec le minimum de consultations au sein du gouvernement. Ou bien,
ils peuvent se fier à l’expertise étrangère. Dans l’un et l’autre cas, la
conformité de la législation en matière de PI avec les politiques de
développement risque de ne pas faire l’objet d’une réflexion adéquate.
La capacité des pays en développement à coordonner la politique au niveau
de l’ensemble du gouvernement lors de l’exécution de réformes liées à la PI est
donc cruciale. Les données factuelles suggèrent que certains pays ont établi
des mécanismes visant à améliorer la coordination de l’élaboration des
politiques et des conseils, les principaux intervenants étant les ministères
clés les plus impliqués, c’est-à-dire la santé, la justice, la science,
l’environnement, l’agriculture, l’éducation ou la culture (pour le droit
d’auteur et les droits connexes). Toutefois, ces mécanismes ne sont souvent
qu’embryonnaires et leur degré d’efficacité n’est pas encore apparent, en
particulier en ce qui concerne l’intégration des questions de PI aux autres
domaines de la politique économique et de développement. Souvent, cette
situation traduira le fait que les organes de coordination n’ont pas facilement
accès à une source dans laquelle ils pourraient puiser les conseils et les
connaissances techniques spécialisées nécessaires, mais elle reflétera aussi
les intérêts divergents au sein du gouvernement.
Un aspect de la
réforme de la PI dans les pays en développement a été insuffisamment
étudié : l’importance du processus d’élaboration de politiques en lui-même
et la capacité des parties prenantes, au sein du gouvernement et ailleurs, à
participer à la formulation de la politique et de nouvelles lois. A un extrême,
un pays comme l’Inde dispose d’un système étendu et développé de consultations
et de débats publics (y compris des ateliers publics sur des thèmes
controversés comme la protection de la biodiversité et des savoirs
traditionnels), ainsi que de niveaux élevés de savoir-faire au sein des
communautés universitaires, commerciales et juridiques. A l’autre extrême, dans
un pays en développement de l’Afrique subsaharienne que nous avons étudié, une
nouvelle loi sur le droit d’auteur a été adoptée après un simple processus de rédaction
technique, avec des consultations ou débats publics minimaux.
Encadré 7.1 L’élaboration participative de politiques en
action : l’Afrique du Sud
(i)
Depuis la fin des années 90,
le gouvernement sud-africain envisage des réformes de la législation nationale
sur le droit d’auteur. Dans le passé, l’industrie de l'édition était le
principal groupe d’intérêt participant au processus d’influence de la politique
du gouvernement en matière de droit d’auteur. Toutefois, ces dernières années,
le secteur éducatif a joué un rôle de plus en plus actif, demandant des
modifications de la législation afin de tenir compte du droit d’auteur
électronique et d’inclure des dispositions relatives à l’enseignement à
distance, aux programmes éducatifs spéciaux et aux besoins des personnes
handicapées (par exemple, les aveugles).
En 1998, le ministère du
Commerce et de l’Industrie a publié un projet de règlement modifiant le
règlement actuel joint à la loi sur le droit d’auteur. Le secteur éducatif a
réagi en créant le Groupe de travail sur le droit d’auteur (Copyright Task Team), sous les auspices
de l’Association sud-africaine des recteurs (South African Vice-Chancellors’ Association - SAUVCA) et du Comité
des directeurs des Technikons (Committee
of Technikon Principals - CTP). Les parties prenantes ont été invitées
à présenter des exposés de principe sur le projet de règlement, puis à
soumettre des commentaires sur celui-ci. Comme le projet de règlement était
limité à l’éducation, le Groupe de travail sur le droit d’auteur a soumis un
document consolidé de commentaires et d’objections émanant du secteur éducatif.
En conséquence, le projet de règlement a été suspendu.
En mai 2000, le ministère du
Commerce et de l’Industrie a de nouveau publié des propositions de modification
de la loi sur le droit d’auteur. Le Groupe de travail sur le droit d’auteur
électronique de SAUVCA/CTP (SAUVCA/CTP
Electronic Copyright Task Team) fut créé pour examiner les modifications
proposées, ainsi que d’autres questions non incluses dans les propositions (par
exemple, celles qui sont mentionnées au paragraphe un ci-dessus). Les
modifications proposées étaient une fois encore limitées à l’éducation. A
l’issue de débats entre le Groupe de travail et quatre ministères, à savoir
ceux du Commerce et de l’Industrie, de l’Education, de la Communication, et des
Arts, de la Culture, de la Science et de la Technologie, plusieurs
modifications parmi les plus contestées ont été retirées.
En janvier 2001, les deux
groupes de travail ont été dissous pour créer deux autres Commissions
permanentes sur la propriété intellectuelle qui représentent le secteur
éducatif, à savoir la Commission de la propriété intellectuelle de la SAUVCA (SAUVCA IP Committee) et la Commission de
la propriété intellectuelle du CTP (CTP IP
Committee). Depuis, ces Commissions ont organisé des discussions avec le
ministère du Commerce et de l’Industrie, l’Association des éditeurs d’Afrique
du Sud (Publishers’ Association of South
Africa), l’Union internationale des éditeurs et la Business Software
Alliance. La Commission de la propriété intellectuelle de la SAUVCA prépare
actuellement un document de travail sur « l’utilisation équitable »
et « la reproduction multiple à des fins éducatives », pour une
discussion ultérieure avec les parties prenantes.
Les pays en développement, comme le Kenya par exemple, qui ont de plus
longues traditions d’élaboration de politiques de PI et une plus grande
population de juristes et d’universitaires spécialistes de la PI, et
d’organisations de la société civile intéressées, se situent entre ces deux
extrêmes. Ainsi, lors de notre visite, nous avons pu rencontrer le sous-comité
sur les ADPIC, récemment constitué, chargé d’étudier la manière dont le Kenya
met en œuvre l’Accord sur les ADPIC. Ce sous-comité incluait des représentants
de divers ministères, ainsi que du secteur privé. Dans beaucoup de pays en
développement toutefois, nous pensons qu’une amélioration considérable est
nécessaire en termes de constitution d’un processus réellement participatif de
réforme de la politique de PI. Les gouvernements et bailleurs de fonds
devraient insister davantage sur cet objectif.
Les pays en développement et les bailleurs de
fonds devraient unir leurs forces que les processus de réforme nationale de la
PI soient correctement intégrés aux autres domaines connexes de la politique de
développement. De même, il faut intensifier les efforts pour encourager une
plus grande participation des parties prenantes nationales aux réformes de la
PI. Lorsqu’ils fournissent une assistance technique, les bailleurs de fonds
devraient contribuer au renforcement de la capacité des institutions locales à
entreprendre des travaux de recherche en matière de PI et à établir un dialogue
avec les parties prenantes, en plus de la fourniture d'experts internationaux
et de conseils juridiques.
ADMINISTRATION DES DPI ET INSTITUTIONS COMPETENTES EN LA
MATIERE
Introduction
Il existe de grands
écarts en matière de volume des demandes et des délivrances de DPI traités par
les pays en développement (voir Tableau 7.1.), ce qui a un impact considérable
sur les besoins institutionnels en matière d’administration des DPI. Les
demandes sont, en partie, déterminées par la question de savoir si le pays est
membre du PCT ou d’un autre accord international ou d’une organisation
régionale. Mais actuellement, dans la plupart des pays en développement, seule
une faible part des demandes effectuées aux termes de ces accords a vu
l’ouverture de la « phase nationale », dans laquelle se déroulent la
délivrance et l’enregistrement matériels. Parmi les autres facteurs, on peut
citer les différences entre les lois et règlements nationaux en matière de PI
(qui peuvent être plus ou moins attirants pour les déposants) et les politiques
de PI des sociétés multinationales.
Une étude de l’OMPI
en 1996[382], réalisée auprès de 96
pays en développement, a conclu que dans les deux tiers des pays de
l’échantillon, l’administration de la propriété intellectuelle était assurée
par un département du ministère de l’Industrie et du Commerce ou du ministère
de la Justice. Dans 10 pays, une agence publique autonome était chargée de
l’administration de la propriété intellectuelle. L’administration du droit
d’auteur était assurée par un département du ministère de l’Education ou de la
Culture dans un tiers des pays de l’échantillon, et par une agence autonome
spécialisée dans le droit d’auteur dans 15 cas. Nous observons avec intérêt que
dans un autre tiers des pays interrogés, aucune entité particulière n’avait été
identifiée au sein du gouvernement pour assurer l’administration du droit
d’auteur.
Tableau 7.1 Volume des demandes et des délivrances dans
huit pays en développement, 1996-1998
|
Pays
|
1996
|
1997
|
1998
|
|
|
Deman-des
|
Délivran-ces
|
Deman-des
|
Délivran-ces
|
Deman-des
|
Délivrances
|
|
Brevets
|
|
Chine*
|
52 714
|
2 976
|
61 382
|
3 494
|
82 289
|
4 735
|
|
Guatemala
|
104
|
8
|
135
|
15
|
207
|
17
|
|
Inde
|
8 292
|
1 020
|
10 155
|
nd
|
10 108
|
1 711
|
|
Jamaïque
|
79
|
23
|
70
|
21
|
60
|
16
|
|
Kirghizstan*
|
20 305
|
125
|
25 103
|
133
|
33 905
|
91
|
|
Malawi*
|
39 034
|
117
|
49 934
|
49
|
67 760
|
80
|
|
Soudan*
|
39 061
|
97
|
49 920
|
37
|
67 719
|
64
|
|
Vietnam*
|
22 243
|
61
|
27 440
|
111
|
35 748
|
nd
|
|
Marques
|
|
Chine**
|
150 074
|
121 475
|
145 944
|
217 605
|
153 692
|
98 961
|
|
Guatemala
|
8 206
|
5 490
|
10 588
|
6 369
|
9 988
|
4 806
|
|
Inde
|
nd
|
4 436
|
43 302
|
nd
|
36 271
|
4 840
|
|
Jamaïque
|
1 537
|
1 346
|
1 883
|
2 195
|
2 005
|
1 966
|
|
Kirghizstan**
|
2 803
|
3 297
|
3 008
|
2 592
|
3 112
|
2 760
|
|
Malawi
|
624
|
316
|
819
|
422
|
582
|
320
|
|
Soudan**
|
1 508
|
1 508
|
1 482
|
1 482
|
1 514
|
1 514
|
|
Vietnam**
|
8 440
|
6 615
|
7 830
|
5 174
|
2 838
|
2 534
|
|
Source : site web de
l’OMPI. www.wipo.int
*
Membre du PCT pendant cette période. ** Membre de l’Arrangement ou du
Protocole de Madrid pendant cette période.
Remarque : le coût de la désignation des pays aux termes du PCT
est négligeable de sorte que les déposants désignent généralement un grand
nombre de pays. Ainsi, bien que le nombre total de demandes de brevets dans
les pays membres du PCT indiqués semble très élevé, seul un nombre bien
inférieur de ces brevets voit l’ouverture de la « phase nationale »
où les offices nationaux doivent agir, ce qui inclut la délivrance d’un
brevet matériel dans le pays concerné.
|
Mais il semble
qu’il s’est produit une augmentation du nombre de pays en développement ayant
décidé d’adopter une institution unique et semi-autonome de PI chargée de
l’administration de la propriété industrielle et du droit d’auteur. On peut
citer l’exemple de la Jamaïque et la Tanzanie. Il existe des arguments
valables en faveur de la création d’un office d’administration de la PI unique
et semi- autonome, sous la supervision d’un ministère approprié. Parmi ces
arguments, on compte la séparation des fonctions politiques et
administratives ; la création d’une approche de la récupération des coûts
et du contrôle des dépenses plus axée sur le commerce (y compris des stratégies
d’investissement du capital et de rémunération du personnel basée sur le
marché) ; et les avantages potentiels d’une meilleure coordination des
politiques dans les différents domaines de la PI.
Ressources humaines
Le nombre des
effectifs impliqués dans l’administration des DPI dans les pays en
développement varie énormément : d’une personne non qualifiée au ministère
du Commerce et de l’Industrie en Erythrée à plus de 800 personnes dans
trois agences publiques en Inde. Pour satisfaire les normes administratives
minimales exigées par l’Accord sur les ADPIC, le nombre requis pour un office
élémentaire traitant un volume très faible de demandes de DPI serait peut-être
de 10 professionnels et d’autant d’effectifs de soutien/administratif. Ce
besoin augmenterait sans doute au fil du temps, à mesure de l’augmentation des
volumes de demandes de DPI.
Presque tous les
pays en développement sont confrontés à des situations de pénurie de personnel
professionnel dans leur administration nationale de la PI. Dans les PMA et les
petits pays en développement à faible revenu, l’expertise technique et
juridique nécessaire est souvent rare. Lorsque l’expertise juridique existe, il
n’y a pas de spécialisation dans les DPI. Dans les pays en développement plus
avancés ou plus grands, on trouve généralement une plus grande expertise
juridique en PI, notamment dans le domaine des marques.
Encadré 7.2 Compléter le personnel : les
effectifs des offices de PI dans sept pays en développement
Inde :
L’Office
des brevets dispose d’effectifs d’environ 300 personnes, contre un niveau
de personnel autorisé de 530 personnes (dont 40 examinateurs de brevets sur un
total autorisé de 190 examinateurs). Le Bureau d’enregistrement des marques
emploie un effectif total de 259 personnes, contre un total autorisé de
282. Et l’Office du droit d’auteur emploie 12 personnes, dont 9 occupent
des postes professionnels.
Jamaïque : L’Office de la propriété
intellectuelle récemment créé, sous la supervision du ministère de l’Industrie,
du Commerce et de la Technologie, a un niveau de personnel autorisé de 51
postes, dont environ la moitié seulement est pourvue actuellement.
Kenya : L’Institut de la propriété
intellectuelle emploie 97 personnes, dont 26 occupent des postes professionnels
et 71 des postes administratifs.
Sainte-Lucie : L'Office pour
l'enregistrement des sociétés et de la propriété intellectuelle, sous la
supervision du Département du procureur général, a un niveau de personnel
autorisé de 9 postes, dont un est vacant actuellement.
Trinité-et-Tobago : L’Office de la propriété
intellectuelle a un niveau de personnel autorisé de 23 personnes à l’heure
actuelle, dont six postes vacants. Une révision de l’organigramme propose une
augmentation du niveau de personnel autorisé à 54 postes pour traiter la charge
de travail actuelle.
Tanzanie : La Division de la propriété
intellectuelle de l’Agence d’enregistrement des entreprises et de délivrance
des licences dispose d’effectifs de 20 personnes (11 occupant des postes
professionnels et 9 des postes administratifs).
Vietnam : L’Office national de la
propriété industrielle emploie 136 personnes au total (87 professionnels et 49
personnes de soutien) et l’Office du droit d’auteur emploie 22 autres
personnes.
Source : Leesti, M. et Pengelly, T. (2002) « Institutional Issues for Developing Countries in Intellectual Property
Policymaking, Administration and Enforcement »,
Commission Background Paper, p. 27.
Technologies de l’information
Les systèmes
informatiques sont maintenant une nécessité critique pour une administration
efficace de la PI. Ils permettent en effet d’accéder aisément à un large
éventail d’informations sur les thèmes de la politique de PI, ainsi qu’aux
bases de données et bibliothèques de brevets en ligne d’organisations comme
l’OMPI et les grands offices des brevets. Ils constituent donc un facteur
important des capacités institutionnelles. Si les besoins en matériel
informatique de base sont relativement limités pour les petits offices de la
propriété intellectuelle et si les logiciels nécessaires sont facilement
disponibles, l’ampleur de l’automatisation et de la connectivité Internet est
étonnamment faible.[383]
Bien que certains des plus grands pays en développement à revenu plus élevé
disposent de systèmes entièrement automatisés pour la recherche et le traitement
des demandes, un grand nombre de pays utilisent encore des systèmes manuels sur
papier. Ces systèmes ne font pas que gêner le traitement efficace des demandes,
mais compliquent également beaucoup la collecte d’informations importantes en
matière de statistique et de gestion.
EXAMEN, SYSTEMES
D’ENREGISTREMENT ET ACCORDS DE COOPERATION
L’administration
des DPI implique la réception des demandes, l’examen formel (le cas échéant),
la délivrance ou l’enregistrement des DPI, la publication et le traitement des
oppositions éventuelles. Comme certains DPI expirent à l’issue de délais
spécifiés, d’autres démarches sont nécessaires pour les procédures de
renouvellement et la motivation de la décision. Le niveau d’administration
publique nécessaire en matière de droit d’auteur et de droits connexes est
toutefois minimal, car ces droits sont acquis automatiquement et ne demandent
pas de renouvellement.
L’aspect de loin le
plus difficile concerne l’examen quant au fond des demandes de brevets, afin de
s’assurer non seulement que l’invention revendiquée est nouvelle, inventive et
susceptible d’application industrielle, mais également que le demandeur a
satisfait aux conditions de divulgation. Certaines demandes de brevets couvrent
maintenant plusieurs milliers de pages de données techniques, dans un large
éventail de domaines technologiques, et l’examen quant au fond implique des
compétences professionnelles/techniques et un accès aux bases de données
informatisées internationales contenant des informations sur les brevets. Ces
capacités institutionnelles nécessaires sont loin d’être à la portée de la
plupart des organismes d’administration des DPI du monde en développement (à
quelques exceptions près). Très peu de pays en développement sont en mesure de
procéder à un examen interne quant au fond dans un grand nombre de secteurs
technologiques.
L’un des moyens qui
permettraient aux pays en développement de résoudre ce problème est
l’utilisation d’un système d’enregistrement, en vertu duquel les brevets
seraient simplement acceptés et délivrés sans examen quant au fond. Il pourrait
être procédé à un examen élémentaire pour veiller au respect des formalités
légales. Un tel système réduirait grandement les coûts des offices des brevets
et leurs besoins en ressources humaines. Mais si les enregistrements ne sont
soumis à aucun filtre, les pratiques abusives en matière de brevets pourraient
se développer. Compte tenu de la présomption de validité dont pourrait
bénéficier ce type de brevets, la charge de la preuve de la nullité d’un brevet
pèserait sur le public ou les concurrents concernés. Cette charge pourrait être
trop lourde. En outre, l’établissement d’un système local d’examen, même doté
de ressources limitées, permet la création de capacités de rédaction et de lecture
des documents relatifs aux brevets, et leur utilisation en tant que source
d’information. Le degré élevé de mobilité du personnel des offices des brevets
assure souvent le transfert de ces capacités vers le secteur privé ou les
institutions de recherche.
Coopération régionale ou internationale
Nombre de pays en
développement ont décidé que la coopération régionale et/ou internationale en
matière d’administration des DPI était essentielle pour réduire les coûts et
accroître l’efficacité. Pour les brevets en particulier, beaucoup se fondent,
dans une mesure plus ou moins grande, sur le travail de l’OEB et des offices
des brevets des Etats-Unis et du Japon, qui effectuent à eux trois l’examen
quant au fond de la majorité des demandes du monde entier. Dans la pratique,
les pays en développement disposent de trois options principales en matière de
coopération régionale/internationale.
Traité de coopération en matière de brevets
La première option
est la participation aux systèmes du PCT et de Madrid. L’adhésion au système du
PCT permet aux offices nationaux des brevets de minimiser les tâches de
recherche, d’examen et de publication. Elle permet également aux déposants
nationaux de demander une protection internationale par brevet dans tous les
Etats membres du PCT à des coûts relativement faibles (en outre, les résidents
de pays en développement bénéficient d’une réduction de 75 % de toutes les
taxes du PCT). L’adhésion au système de Madrid produit des avantages similaires
à ceux du PCT, mais cette fois en matière d’administration des marques.[384]
Les pays pourraient
choisir de n’appliquer que le Chapitre I (Demande internationale et recherche
internationale) du PCT, et non
son Chapitre II (Examen préliminaire international), s’ils considèrent que
l’examen effectué par un office étranger des brevets conduirait à l’application
de normes et critères s’écartant substantiellement de ceux qui sont en vigueur
dans le pays, notamment dans des domaines critiques comme les produits
pharmaceutiques et la biotechnologie.
Externalisation
La deuxième option
est l’externalisation de l’administration des brevets, en la confiant par
contrat à un autre office de brevets national ou international, ou à une
organisation privée. Ainsi, l’OEB propose un service de recherche et d’examen
pour les brevets à certains pays d’Europe de l’Est. Un système similaire pour
les brevets est offert aux pays en développement, bien qu’aucun d’eux n’ait
encore tiré parti de cette option. Les pays en développement peuvent également
demander l’assistance des Services d’information en matière de brevets de
l’OMPI (WPIS), pour la recherche et l’examen de demandes de brevets
individuelles.[385] Il leur est aussi
possible d’utiliser l’expertise présente dans les universités locales, lorsque
elle existe, pour l’examen technique de demandes de brevets, comme le pratique
par exemple le Chili. De la même manière, au Brésil, le ministère de la Santé
est légalement tenu d’assister l’Institut de la propriété industrielle (INPI)
dans l’examen des brevets pharmaceutiques.
Organisations régionales
La troisième option
est l’adhésion à un système régional de propriété industrielle. On recense
actuellement quatre organisations régionales de propriété intellectuelle dans
le monde en développement. En Europe de l’Est et en Asie Centrale, l’Office
eurasien des brevets compte neuf Etats membres. Dans le monde arabe, l’Office
des brevets du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe compte six
Etats membres. Dans la région africaine, on recense deux organisations régionales
de propriété intellectuelle : l’OAPI et l’ARIPO qui comptent
respectivement 16 et 15 Etats membres. En outre, les six pays du Pacte andin
ont élaboré une législation commune en matière de PI (bien qu’elle reste
administrée au niveau individuel par les gouvernements nationaux) et des
initiatives sont en cours aux Caraïbes et en Asie du Sud-Est. A l’heure
actuelle, il n’existe pas encore d’organisation régionale d’administration de
la PI en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans la région du Pacifique, en
Asie du Sud ou en Asie du Sud-Est. La majorité des PMA (27 sur 49)
n’appartiennent actuellement à aucune organisation régionale de PI.
Si la coopération
régionale offre des avantages aux pays en développement, elle se concentre
principalement sur l’administration des DPI. Il appartient donc toujours aux
institutions nationales d’assurer les fonctions importantes liées à
l’élaboration des politiques, à la participation à l’élaboration des règles
internationales ainsi qu'à la sanction et à la réglementation des DPI. Les
organisations régionales, par conséquent, pourraient compléter, plutôt que
remplacer intégralement, une infrastructure nationale efficace en matière de
PI.
Parallèlement, la
coopération régionale/internationale présente également des inconvénients
potentiels pour les pays en développement. Premièrement, l’adhésion à un
système régional, selon sa structure et les assouplissements intégrés pour
prendre en compte les intérêts nationaux des membres, peut compliquer
l’application par chaque pays en développement d’un régime de PI adapté à ses
besoins (avec, par exemple, des conditions et niveaux de protection différents
dans certains domaines technologiques). Ainsi, les PMA membres de l’OAPI ne
peuvent pas bénéficier de la période de transition étendue prévue par l’Accord
sur les ADPIC ou de l’allongement de l’extension concernant la protection des
produits pharmaceutiques qui leur est accordé dans la Déclaration de Doha, à
moins d’une modification à cet effet de l’Accord de Bangui récemment révisé. Ce
n’est pas le cas des PMA membres du système de l’ARIPO, qui disposent d’une
plus grande souplesse pour façonner leurs propres législations et pratiques en
matière de brevets.[386]
Deuxièmement, l’adhésion à un système régional ou international des brevets
peut rendre difficile pour un pays en développement l'application d’un système
efficace d’oppositions contestant la validité des brevets. Enfin, la dépendance
à l’égard des institutions régionales peut entraver la constitution au niveau
national des connaissances spécialisées et des capacités institutionnelles
(encore) nécessaires en matière de PI (par exemple, pour l’élaboration de
politiques, la sanction et la réglementation).
Il est clair que
les pays en développement doivent peser les avantages et les inconvénients de
la coopération régionale et internationale et choisir le régime de brevets qui
convient le mieux à leur situation nationale. En même temps, il pourrait être
utile aux partisans de la coopération régionale/internationale en matière de PI
de démontrer comment certains des inconvénients potentiels pour les pays en
développement peuvent être surmontés ou atténués dans la pratique. Un débat
plus actif et mieux informé pourrait aider les pays en développement à
comprendre les avantages et inconvénients de la coopération
régionale/internationale et à prendre la bonne décision.
COUTS ET RECETTES
Le coût d’un système de PI
L’établissement et
l’exploitation des infrastructures de PI dans les pays en développement
impliquent diverses charges exceptionnelles et courantes. Les charges
exceptionnelles comprennent, par exemple, l’acquisition de locaux, l’équipement
d’automatisation (matériel et logiciels) et de bureau, les services de conseil
(pour la recherche sur les politiques, la rédaction de nouvelles législations,
la conception des stratégies d’automatisation, la réorganisation de la gestion,
etc.) et la formation du personnel des organismes concernés traitant de la
politique/législation, de l’administration et de la sanction des droits. Les charges
courantes incluent, par exemple, les salaires et avantages sociaux, les
factures des services publics, l’entretien du matériel informatique, les
services de communication (y compris la production d’un rapport annuel et la
mise en place d’un site web), les frais de déplacement pour la participation
aux réunions des organisations internationales et régionales, et les
cotisations annuelles à l’OMPI et aux organisations régionales.
Il est très
difficile de tirer des conclusions générales concernant l’ampleur de ces coûts
dans les pays en développement, du fait notamment des différences de volumes
des demandes de DPI qui doivent être traités, des variations des coûts locaux
de la main-d’œuvre et des locaux, et des choix politiques effectués par
différents pays en développement lors de la conception de leur infrastructure
de PI. Ainsi, les coûts seront bien supérieurs dans les pays en développement
qui exploitent des systèmes d’examen quant au fond des brevets, par rapport à
ceux qui utilisent un système d’enregistrement sans examen.
Une étude réalisée
en 1996 par la CNUCED a produit des estimations des coûts institutionnels de la
mise en conformité avec l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement.[387]
Au Chili, les charges fixes supplémentaires de la mise à niveau des
infrastructures de PI ont été estimées à 718 000 dollars, les charges
courantes annuelles passant à 837 000 dollars. En Egypte, les charges
fixes étaient estimées à 800 000 dollars, les coûts supplémentaires de
formation s’élevant à 1 million de dollars environ. Le Bangladesh
prévoyait des charges exceptionnelles de 250 000 dollars seulement
(rédaction de législation) et des charges annuelles de 1,1 million de dollars
pour le travail judiciaire, le matériel et la sanction, hors formation. La
Banque mondiale a récemment estimé qu’une mise à niveau complète du régime de
DPI dans les pays en développement, formation comprise, pourrait nécessiter des
dépenses d’investissement de 1,5 à 2 millions de dollars, bien que les
résultats d’une étude de 1999 des projets concernés de la Banque mondiale aient
suggéré que ces coûts pourraient être très supérieurs.[388]
Un récent rapport sur la modernisation du système de PI de la Jamaïque estimait
que les coûts initiaux de la seule automatisation s’élèveraient à
300 000 dollars environ.[389]
Financer les coûts
Dans la plupart des
pays en développement, les organismes d’administration des DPI facturent des redevances diverses au titre
des services liés au traitement des demandes de DPI, ainsi qu’au renouvellement
de ces droits une fois qu’ils ont été octroyés. Dans certains pays en
développement plus grands, les recettes issues de ces redevances sont
significatives et dépassent de beaucoup les charges d’exploitation. Au Chili,
par exemple, les recettes issues des redevances perçues sur l’administration
des DPI s’élevaient à 6 millions de dollars en 1995, contre des charges
courantes de 1 million de dollars sur la même période.[390]
Dans les pays développés, les offices de la PI enregistrent souvent des
excédents substantiels, apportant normalement des sommes significatives aux
Trésors nationaux.
Les études que nous
avons commandées indiquent en général des flux de recettes plus modestes,
quoique croissants, dans beaucoup de pays en développement.[391]
Par exemple, les recettes issues des redevances de PI pour l’exercice 1999-2000
s’élevaient à 2,5 millions de dollars en Inde, 629 000 dollars au
Kenya, 230 000 dollars à Trinité-et-Tobago, 214 000 dollars en
Tanzanie et 162 000 dollars à la Jamaïque. Les redevances perçues sur
l’administration des marques sont généralement la principale source de recettes
car la délivrance de brevets et autres DPI produit des recettes bien
inférieures en comparaison. C’est tout particulièrement le cas dans les pays en
développement à faible revenu.
Bien entendu, la
question financière cruciale est l’équilibre entre les recettes et les
dépenses. Comme l’a signalé la Banque mondiale, il ne semble pas souhaitable
que les pays en développement détournent de leurs budgets déjà soumis à de
fortes contraintes dans le domaine de la santé et de l'éducation les ressources
nécessaires pour subventionner
l’administration des DPI. Pourtant, c’est un risque réel dans certains pays en
développement plus petits ou à faible revenu, susceptibles de traiter des
volumes très faibles de DPI pendant encore de nombreuses années. Selon nos
études, sur huit pays en développement, quatre semblaient produire des recettes
issues des redevances perçues sur la PI suffisantes pour couvrir les charges
d’administration, au moins en termes de charges d’exploitation, si ce n’est de
coût du capital. Toutefois, l’Office de la propriété intellectuelle de la
Jamaïque semble actuellement fonctionner à perte (environ
120 000 dollars pour l’exercice 1999-2000), nécessitant donc une subvention
des contribuables jamaïcains, tandis que dans trois autres pays que nous avons
examinés, les données disponibles étaient insuffisantes pour nous permettre de
parvenir à une conclusion.[392]
La plupart des pays
en développement devront probablement élaborer des programmes échelonnés de dépenses
d’investissement en matière de DPI et veiller à ce que les redevances de
service soient fixées à un niveau permettant la récupération de tous les coûts
financiers encourus dans le système de PI. Il est donc nécessaire de mettre en
place des systèmes rigoureux de gestion financière et de comptabilité, ainsi
que de révision régulière des redevances. Les données factuelles que nous avons
examinées suggèrent que ces conditions ne sont pas satisfaites dans certains pays
en développement : en Ouganda, par exemple, les taxes sur les brevets ont été révisées pour la dernière
fois en 1993.
Comme des
redevances élevées risquent de dissuader certains types de déposants de
demander des DPI, plusieurs pays ont choisi d’adopter un système à plusieurs
niveaux de redevances, dans lequel des redevances réduites sont facturées aux
organisations à but non lucratif, aux individus et aux petites organisations
commerciales, comme celles dont le nombre d’employés ou le niveau du chiffre
d’affaires est inférieur à des seuils stipulés. Cette politique de récupération
des coûts paraît très sensée, car elle devrait permettre de développer
l’infrastructure nationale de PI et d’offrir un meilleur service aux
utilisateurs, sans imposer de fardeau supplémentaire aux finances publiques.
Certains pourraient être attirés par une politique de facturation de redevances
majorées aux déposants des pays développés, mais ce type de politique serait
incompatible avec le principe de traitement national exigé par la Convention de
Paris et l’Accord sur les ADPIC. Mais comme la très grande majorité des
demandes de brevets dans la plupart des pays en développement proviennent de
l’étranger, un système à plusieurs niveaux de redevances pourrait produire des
recettes comparables.
Au fil du temps, la
rationalisation de l’administration des DPI par l’automatisation et la
coopération régionale ou internationale dans certains pays pourrait contribuer
à générer des volumes plus élevés de demandes de brevets et de délivrances de
brevets pour lesquelles il est possible de facturer des redevances. Et bien
entendu, une partie de la solution au problème relève clairement de l’apport
d’une assistance technique ou financière de la part des bailleurs de fonds.
Mais cette assistance n’est pas une panacée pour les pays en
développement : elle ne peut jamais être garantie ; les ressources
sont limitées et d’autres priorités peuvent être plus pressantes ; et elle
est surtout disponible pour les coûts d’investissement exceptionnels, plutôt
que pour le financement d’un déficit courant des budgets d’exploitation.
Les pays en développement devraient
chercher à récupérer la totalité des dépenses liées aux améliorations et à la
gestion de leurs infrastructures nationales en matière de PI par le biais des
redevances perçues auprès des utilisateurs du système. Ils devraient également
envisager l’adoption d’un système à plusieurs niveaux de redevances pour
l’enregistrement des DPI. Le montant des redevances demandées aux utilisateurs
devrait être révisé régulièrement afin de veiller à ce que des coûts de
l’administration du système soient complètement récupérés.
SANCTION
Sanction dans les pays en
développement
Les DPI n’ont de valeur pour leurs titulaires que s’ils sont véritablement
appliqués, ce qui requiert des systèmes juridiques efficaces. Parallèlement,
ces systèmes doivent être capables de rejeter les DPI non valables, comme les
brevets délivrés malgré l’existence d’un état de la technique. L’Accord sur les
ADPIC expose des exigences minimales détaillées quant aux moyens de faire
respecter les DPI. Pour de nombreux pays en développement, en particulier ceux
à faible revenu, le respect de ces dispositions de l’Accord sur les ADPIC
présente des défis institutionnels considérables en matière de systèmes
judiciaires, de procédures civiles et pénales et d’autorités chargées de la
sanction des droits. En outre, le renforcement de la sanction peut revêtir un
caractère très sensible en termes politiques s’il augmente les prix pour les
consommateurs pauvres, ou s’il menace l’emploi dans les industries
contrevenantes, voire les recettes fiscales qu’elles produisent.
Dans beaucoup de pays en développement, les domaines spécialisés du droit
commercial, comme la PI, posent un défi aux systèmes judiciaires. En pareil
cas, l’application dans les tribunaux des lois en matière de PI est sans doute
particulièrement difficile, car les juges et avocats ont besoin d’une
connaissance approfondie de concepts techniques et juridiques complexes. Cet
état de fait pose des risques potentiels en termes de « sanction
insuffisante » et de « sanction excessive » des DPI dans les pays en développement.
Les associations
sectorielles comme la Business Software Alliance et l’Alliance internationale
de la propriété intellectuelle estiment souvent que les niveaux de violation
des DPI sont très élevés dans les pays en développement.[393] Prouver
la mesure des atteintes aux DPI dans les pays en développement pose un problème
car aucune statistique officielle fiable n’est souvent disponible. Toutefois,
il est généralement admis que l’ampleur du problème de violation des DPI dans
la plupart des pays à faible revenu est tout particulièrement marqué dans les
domaines du droit d’auteur (contrefaçon de produits comme les logiciels d’ordinateur
et les musicassettes, faciles à copier) et des marques, bien qu’il convienne de
noter qu’en termes de manque à gagner, l’utilisation de produits contrefaits
est plus significative dans le monde développé.[394]
Nous convenons que
les systèmes de sanction des pays en développement doivent traiter les
atteintes graves aux DPI avec une plus grande sévérité. Il s’agit d’un élément
important pour préserver les incitations que le système offre aux titulaires de
DPI. Mais il est également important que les pays en développement créent des
institutions capables de sanctionner les atteintes de manière équilibrée et
favorable à la concurrence. Plus exactement, les institutions de sanction des
pays en développement doivent être suffisamment robustes pour décider de la
validité ou de l’invalidité des DPI et pour résister à leur abus potentiel par
des pratiques commerciales restrictives comme les « procès
stratégiques ». Ainsi, tandis que les pays en développement font l’objet
de pressions à l’introduction de systèmes facilitant et accélérant l’obtention
d’injonctions, celles-ci risquent d’être utilisées de manière abusive par les
titulaires de DPI et entravent donc la concurrence légitime. A mesure que les
systèmes de sanction de la PI se renforcent dans les pays en développement,
dans la lignée de l’Accord sur les ADPIC, il est essentiel d’insister
suffisamment sur la nécessité de protéger l’intérêt public et de développer des
procédures équitables pour les deux parties en litige.
La sanction
efficace des DPI tend à augmenter avec les niveaux de revenu, aussi les
faiblesses institutionnelles en la matière seront sans doute les plus marquées
dans les pays les plus pauvres. Ainsi, en Tanzanie et en Ouganda, on trouve peu
de traces dans le système judiciaire d’affaires portant sur des procès pour
atteintes aux DPI, tandis qu’au Kenya, ces dernières années, les autorités
douanières ont procédé à 50 saisies de produits de contrefaçon et 20 affaires
pénales liées aux DPI ont été portées devant les tribunaux.[395]
Certains pays en développement, comme la Thaïlande et la Chine, sont allés plus
loin et ont créé des tribunaux spécialisés pour connaître des affaires liées aux DPI, comme un
moyen d’améliorer leurs capacités nationales en matière de sanction, bien que
cette mesure ne soit pas formellement requise par l’Accord sur les ADPIC. Les
pays en développement seront sans doute plus attirés par l’établissement (ou le
renforcement) d’un tribunal de commerce compétent pour connaître des affaires
liées aux DPI, entre autres, et offrant à l’ensemble du secteur commercial un
meilleur accès à la justice. Dans tous les cas, un programme considérable de
formation des autorités judiciaires, et autres organismes de sanction, aux
thèmes de la PI sera nécessaire dans la plupart des pays en développement.[396]
La nature
« privée » des DPI signale l’importance de la résolution des litiges
entre les parties, soit en dehors des tribunaux soit en vertu du droit civil.
En effet, comme la sanction par l’Etat des DPI est une activité demandant
beaucoup de ressources, il semblerait souhaitable que les pays en développement
adoptent des législations en matière de DPI mettant en avant leur sanction par
système judiciaire civil plutôt que pénal. De telles législations allégeraient
le poids sur le gouvernement de la sanction de contrefaçons à grande échelle,
bien que les organismes de sanction de l’Etat dussent encore d’intervenir. Cela
dit, nous observons que les pays en développement font l’objet de pressions de
la part de l’industrie, qui préconise des régimes de sanction fondés sur les
initiatives publiques de poursuite des infractions. Il faudrait résister à ces
pressions et les titulaires de droits devraient prendre l’initiative et assumer
les coûts du respect de leurs droits privés.
Les pays en développement devraient veiller à ce que leur
législation et leurs procédures en matière de PI mettent l'accent, dans toute
la mesure du possible, sur les moyens de faire respecter les DPI qui font
intervenir les voies administratives ou civiles, plutôt que le système de
justice pénale. Les procédures visant à assurer le respect des droits devraient
être justes et équitables pour les deux parties et garantir que des injonctions
et autres mesures ne sont pas utilisées à mauvais escient par les titulaires de
DPI pour bloquer une concurrence légitime. Les fonds publics et les programmes
des bailleurs de fonds devraient être utilisés principalement pour améliorer
l'application du droit de la PI dans le cadre d’un renforcement plus large des
systèmes juridique et judiciaire.
Sanction dans les pays développés
Jusqu’ici, cette
section s’est concentrée exclusivement sur les questions relatives à la
sanction des DPI dans les pays en développement, ce qui témoigne du poids des
débats sur le thème de la sanction dans les documents que nous avons examinés.
En revanche, nous avons relevé très peu de discussions ou de reconnaissance des
difficultés que rencontrent les titulaires de DPI du monde en développement
pour faire respecter leurs droits dans des pays comme le Royaume-Uni, les
Etats-Unis ou le Japon, par exemple, où les coûts des litiges peuvent être
prohibitifs. Cette situation signifie que les sociétés des pays en
développement participant au jeu de la concurrence dans les pays développés
sont vulnérables aux procès stratégiques impliquant des DPI. Un autre problème
se greffe sur celui-ci, comme l’indique l’affaire du curcuma (voir l’Encadré
4.2 au Chapitre 4) : l’octroi par des pays tiers de DPI sur des savoirs
qui existent en tant qu’état de la technique dans les pays en développement.
Les pays développés doivent réfléchir à la manière dont ils pourraient
améliorer l’accès des pays en développement à leurs systèmes judiciaires dans
les affaires liées à la PI.
Les pays développés devraient mettre en place des
procédures visant à faciliter l’accès effectif des inventeurs de pays en
développement à leurs systèmes de PI. Ces procédures pourraient comprendre
notamment des niveaux de redevances différenciés favorables aux inventeurs
pauvres ou aux inventions à but non lucratif, des systèmes pro bono, des dispositions prévoyant la récupération des dépens par
les parties gagnantes dans les procès ou l’inclusion, dans les programmes
d'assistance technique, de frais appropriés pour la mise en œuvre du système de
PI.
REGLEMENTATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La réglementation
des DPI, notamment dans le cadre des affaires intéressant particulièrement
l’intérêt public (comme les licences obligatoires) ou du contrôle des pratiques
anticoncurrentielles des titulaires de droits, devrait être considérée comme
prioritaire lors de la conception de la politique publique et de
l’infrastructure institutionnelle. Pour être efficace, il est important que la
réglementation impose de procéder à des examens réguliers et périodiques de tous
les aspects du régime national de PI, pour veiller à leur pertinence et leur
adéquation, tout autant que de développer des cadres réglementaires adaptés.
On trouve un grand
nombre de documents justifiant la création par les pays en développement de tels
systèmes et instruments réglementaires en matière de DPI.[397]
En effet, on ignore peut-être que les pays développés ont introduit un
renforcement de la protection de la PI dans le cadre des régimes de la
concurrence et autres régimes réglementaires conçus pour assurer que les DPI ne
portent pas préjudice à l’intérêt public. Aux Etats-Unis notamment, mais aussi
dans d’autres pays développés, une réglementation des DPI favorable à la
concurrence et le contrôle des pratiques commerciales restrictives associées
constituent des éléments fondamentaux de la législation sur la concurrence et
sont régulièrement appliqués par les tribunaux, les autorités compétentes en
matière de concurrence et autres agences publiques concernées.
Du point de vue
institutionnel toutefois, une réglementation efficace des DPI selon les normes
communes du monde développé présentera sans doute des défis significatifs aux
décideurs politiques, administrateurs et organismes de sanction des pays en
développement. Nos études dans huit pays en développement confirment ce point,
en révélant qu’il n’existe aucune trace d’affaires liées à des questions de PI
portées devant les tribunaux aux termes de la législation en matière de
concurrence.[398] Comme l’a récemment
exprimé un observateur :
« … dans la plupart des pays en développement, les
mécanismes visant à contrôler les pratiques commerciales restrictives ou
l’utilisation illicite des DPI sont faibles ou inexistants. De la même manière,
les pays en développement ne sont généralement pas préparés ou ne sont pas en
mesure de neutraliser l’impact que les hausses de prix résultant de
l’établissement ou du renforcement des DPI peut avoir sur l’accès à des
produits protégés, notamment par la population à faible revenu. »[399]
A l’heure actuelle,
seulement 50 pays en développement et économies en transition environ ont
adopté des lois spécifiques en matière de concurrence. D’autres pays en
développement, dont des PMA comme l’Ouganda, sont toutefois en train d'élaborer
une telle législation. D’autres pays en développement encore pourraient inclure
des dispositions relatives à la réglementation des DPI au sein de leurs lois
existantes en matière de PI. Mais l’existence de législations visant à régler
les questions de concurrence dans un pays en développement ne signifie pas que
des institutions compétentes et capables de traiter efficacement des questions
complexes liées à la PI seront en place.
Par exemple, les
compétences et jugements nécessaires pour l’administration des licences
obligatoires, comme la détermination de qui constitue « des conditions
commerciales raisonnables » et « la valeur économique de
l’autorisation », sont assez sophistiqués et pourraient bien dépasser les
capacités institutionnelles existantes de nombreux pays en développement. Cet
argument est étayé par le fait que les pays en développement n’ont presque
jamais utilisé les licences obligatoires (bien qu’on puisse avancer que la
menace de ces licences a pu se révéler suffisante ou que les autorités
nationales ne souhaitent pas utiliser cet instrument).
Les pays en
développement se trouvent donc clairement face à un dilemme. D’une part,
établir un cadre réglementaire efficace, comprenant une politique en matière de
concurrence, représente une étape complémentaire importante de l’introduction
d’une protection renforcée de la PI. D’autre part, bien que les plus grandes
nations en développement (par exemple, l’Inde) s’efforcent de renforcer et
mettre à niveau leurs capacités institutionnelles dans ce domaine, pour
beaucoup de pays cette tâche sera sans doute tout aussi difficile et complexe
que l’établissement d’un régime de DPI. Le monde développé croit souvent que le
système de PI ne peut fonctionner de la manière voulue que s’il est complété
par un cadre efficace de politique de la concurrence. Il s’agit alors de savoir
si un système de PI est à lui seul un objectif valable pour les pays en
développement.
Il n’y a pas de réponse facile à cette question.
Pour les PMA, il existe des arguments valables en faveur de l’extension de la
période de transition pour l’introduction de régimes de DPI, comme nous le
mentionnons au Chapitre 8. Pour d’autres pays en développement, l’argument en
faveur de l'établissement d’un régime de concurrence ne repose pas uniquement
sur sa relation avec les DPI. La privatisation généralisée des industries
publiques et la concentration accrue dans de nombreux marchés ces vingt
dernières années donnent une autre bonne raison d’instaurer d’une politique de
la concurrence efficace, comme l’ont appris les pays développés et les pays en
développement. Nous concluons donc qu’il faudrait accorder une priorité plus
élevée au renforcement des politiques de la concurrence dans les pays en
développement.
Les pays développés et les institutions
internationales qui fournissent une aide à l’élaboration de régimes de DPI dans
les pays en développement devraient également fournir une aide pour
l’élaboration de politiques appropriées en matière de concurrence et pour la
création des institutions nécessaires.
ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT
DES CAPACITES
Programmes actuels
Aux termes de
l’article 67 de l’Accord sur les ADPIC, les pays développés membres de l’OMC
sont tenus d’offrir une coopération technique et financière aux pays en
développement pour faciliter la mise en œuvre de l’Accord. La plupart des pays
développés fournissent aux pays en développement une assistance technique liée
à la PI. Cela se fait soit au niveau bilatéral (surtout par les offices
nationaux des brevets), soit au niveau multilatéral. Les principales organisations
internationales impliquées dans l’apport aux pays en développement d’une
assistance technique liée à la PI sont l’OMPI, l’OEB, la Banque mondiale, le
PNUD et la CNUCED. Plusieurs organisations non gouvernementales prennent aussi
une part active, en entreprenant des recherches et en offrant une assistance
technique aux pays en développement dans le domaine de la PI.
Les types
d'assistance technique offerts par les organisations bailleurs de fonds tombent
dans les grandes catégories suivantes : formation générale et
spécialisée ; conseils juridiques et aide à la préparation de projets de
lois ; soutien à la modernisation des offices d’administration des DPI et
des systèmes de gestion collective ; accès aux services d’information sur les
brevets (dont la recherche et l’examen) ; échange d’informations entre les
législateurs et les juges ; et promotion de l’innovation et de la
créativité locales. Comme la plupart des bailleurs de fonds ne disposent pas
d’agences locales, des missions de conseil à court terme et des consultants
sont normalement déployés dans les pays en développement pour planifier,
exécuter et contrôler les activités des programmes.
La formation et le
développement des ressources humaines font l’objet d’une grande concentration,
un exemple important étant l’Académie mondiale de l’OMPI créée à Genève en
1998. Plus récemment, l’assistance à l’automatisation de l’administration des
DPI dans les pays en développement et les organisations régionales de PI a
également joué un rôle significatif. En particulier, nous notons le programme
WIPONet, mis en œuvre par l’OMPI sur une période de cinq ans, à un coût estimé
à 20 millions de dollars. Ce programme offrira à 154 offices de la PI dans
le monde des services en ligne comme la connectivité Internet, l’hébergement de
sites web nationaux de PI, la messagerie électronique sécurisée et l’échange de
données relatives à la PI. Il est clair que WIPONet a le potentiel d’apporter
des avantages substantiels, bien qu’il soit trop tôt pour juger de la mesure de
son impact.
Evaluer l’impact de l’assistance technique
Compte tenu du
manque d’évaluations entreprises jusqu’ici, il est difficile de parler avec
certitude de l’impact et de l’efficacité de l’assistance technique assurée par
diverses organisations bailleurs de fonds dans des pays ou régions
particuliers. Toutefois, pour veiller à l’efficacité et au maintien d'un bon
rapport qualité/prix, il est important que les bailleurs de fonds entreprennent
régulièrement ces évaluations, à titre individuel et collectif, dans le cadre
du cycle de gestion des programmes. De la même manière, nous avons été frappés
par la rareté des documents définissant la « meilleure pratique » en
matière d’assistance technique liée à la PI. Cette situation forme un contraste
avec les secteurs de l’environnement et du commerce, par exemple, où les
bailleurs de fonds et les pays en développement se sont réunis pour développer
un corps de directives convenues au niveau international dans des forums comme
le Comité d’aide au développement de l’OCDE. Une démarche similaire portant sur
l’assistance technique liée à la PI pourrait être très précieuse.
Il est clair que
des progrès considérables ont été réalisés ces cinq à dix dernières années, en
termes de modernisation des infrastructures de PI et de développement des
ressources humaines associées dans le monde en développement. Un grand nombre
de personnes, de diverses professions, ont reçu une formation générale et
spécialisée sur des thèmes de la PI. Cette formation est particulièrement importante
pour le système éducatif et le barreau qui permettent aux nations d’utiliser
leurs propres systèmes de PI et de participer efficacement aux négociations
internationales et aux négociations avec les fournisseurs étrangers de
technologies. De la même manière, beaucoup de pays en développement ont procédé
à une refonte de leur législation en matière de PI et ont tiré parti de
mécanismes de coopération internationale comme les systèmes du PCT et de
Madrid, afin de réaliser des gains d’efficacité importants et d’offrir de
meilleurs niveaux de service. Les régions où l’impact a été le plus fort sont
sans doute l’Amérique latine et l’Europe de l’Est, mais on a également observé
des améliorations significatives des capacités institutionnelles dans d’autres
pays en développement comme la Chine, le Maroc, le Vietnam, Trinité-et-Tobago
et l’Inde.
En même temps,
beaucoup de pays à faible revenu, et en particulier les PMA, sont toujours
confrontés à des défis considérables dans le développement de leurs infrastructures
de PI. Aussi, certaines questions d’ordre général revêtent une grande
importance pour le financement, la conception et l’exécution de l’assistance
technique en faveur des pays en développement, et en particulier des pays les
plus pauvres, et doivent être réglées sans délai.
Financement supplémentaire de l’assistance technique
Il faut offrir des
financements supplémentaires pour les réformes institutionnelles nécessaires et
le renforcement des capacités dans les pays en développement, car un grand
nombre d'entre eux auront du mal à mettre en œuvre l’Accord sur les ADPIC au
cours des quelques prochaines années. Nous estimons que ce besoin est
significatif, mais il est impossible d’en suggérer le montant précis. Les
besoins de renforcement des capacités de chaque pays doivent être évalués
individuellement. Toutefois, pour donner un ordre de grandeur approximatif,
l’estimation récente de la Banque mondiale, mentionnée ci-dessus, de 1,5 à 2
millions de dollars par pays pour une mise à niveau complète du régime de DPI
nous semble un point de départ raisonnable. Mais il est clair que les bailleurs
de fonds et les pays en développement doivent poursuivre leur travail pour
évaluer et quantifier les besoins correspondants.
D’autre part, il
faut bien entendu se poser la question de savoir où ces financements
supplémentaires nécessaires seront obtenus. Comme nous l’avons indiqué dans une
partie précédente de ce rapport, la plupart des pays en développement ont des
niveaux très faibles de création de DPI, aussi l’assistance technique relative
au renforcement de la protection de la PI est originale, dans le sens où une
partie significative des avantages directs qui en résultent devrait bénéficier
à des titulaires étrangers de DPI, provenant surtout des pays développés. En
outre, dans les PMA et autres pays à faible revenu, les niveaux extrêmement
faibles de développement humain et économique signifient que la priorité est
donnée à juste titre à l’augmentation des dépenses d’aide pour les services
élémentaires de santé et d’éducation pour les pauvres.
Compte tenu des
points qui précèdent, nous pensons qu’il existe des arguments puissants en
faveur du financement par les titulaires de DPI du coût de la modernisation des
infrastructures nationales de PI de ces pays. D’ailleurs, c’est ce que des
organisations comme l’OMPI, l’OEB et les offices des brevets de certains pays
développés font déjà en
pratique dans une large mesure, en produisant, à partir
des redevances des services offerts aux titulaires de DPI, des recettes qui
seront affectées à leur programmes d’assistance technique.[400]
De cette manière, il serait possible de produire un financement supplémentaire
pour l’assistance technique, de façon relativement aisée et équitable.[401]
L’OMPI, l’OEB et les pays développés devraient élargir de
manière significative leurs programmes d’assistance technique liés à la PI. Les
financements supplémentaires nécessaires pourraient être trouvés grâce à une
modique augmentation des redevances d’utilisateur des DPI, comme les redevances
au titre du PCT, plutôt que dans des budgets d’aide déjà soumis à de fortes
pressions. Les bailleurs de fonds devraient également veiller à orienter une
plus grande assistance technique vers les PMA, étant donné qu’ils ont tout
particulièrement besoin de mettre au point un régime de PI ainsi que d’étendre
leur infrastructure institutionnelle pour assurer l’efficacité de la protection
et de la réglementation.
Veiller à l’exécution efficace de l’assistance technique
D’après nos
discussions avec les personnes impliquées, nous avons le sentiment qu’il existe
une grande marge de manœuvre pour l’amélioration de l’exécution et de la
coordination de la coopération dans le domaine de la PI. Des sommes
considérables ont été dépensées de diverses manières par nombre d’institutions
différentes, mais les résultats ne semblent pas proportionnels à l’effort
fourni. La conception et l’exécution de l’assistance technique liée à la PI
dans les pays en développement doivent progresser. Cette coopération doit être
bien mieux intégrée à la stratégie nationale globale de développement de chaque
pays. Trop souvent, l’assistance technique en matière de PI semble planifiée et
exécutée sans tenir compte des autres programmes de développement. Ainsi, des
organisations spécialisées comme l’OMPI préparent parfois une nouvelle
législation relative à la PI pour des
pays, mais l’infrastructure institutionnelle nécessaire à l’administration de
ce nouveau régime n’est pas mise en place parce que les organismes de
développement plus larges et généraux n’ont pas été impliqués. D’autre part,
les projets financés par la Banque mondiale au Brésil, en Indonésie et au
Mexique ont adopté une approche plus globale de la mise à niveau de
l’architecture nationale de PI. Dans ces pays, la modernisation du régime de PI
était un élément de programmes beaucoup plus larges de réforme politique et de
renforcement des capacités visant à stimuler les dépenses de R&D et à
améliorer la compétitivité.
Les activités n’ont
pas non plus toujours été bien coordonnées par les divers bailleurs de fonds
impliqués, ou par les pays bénéficiaires de l’assistance. Cette situation a
entraîné des doubles emplois ou, au pire, des conseils contradictoires. Au
Vietnam, par exemple, huit organismes bailleurs de fonds différents ont apporté
une assistance au pays entre 1996 et 2001.[402]
Une grande partie du problème réside dans le fait que les principaux bailleurs
de fonds en matière de PI (par exemple, l’OMPI et l’OEB) ne disposent pas de
personnel basé dans les pays, ce qui entrave en partie la coordination de la
planification et de la mise en œuvre de l'assistance. A cet égard, il pourrait
donc être utile que les bailleurs de fonds considèrent d’expérimenter, sur la
base d’un projet pilote, en plaçant des responsables sur le terrain dans les
pays ou les régions, pour améliorer la coordination de leur programmes
d’assistance technique en matière de PI sur le terrain dans les pays en
développement.
Il nous semble que
le Cadre intégré pour l'assistance technique liée au commerce en faveur des PMA
(ci-après dénommé « Cadre intégré ») constitue une opportunité cruciale
d’améliorer la coordination des bailleurs de fonds et de mieux intégrer les
programmes d’assistance en matière de PI aux stratégies de développement
nationales. Cette initiative rassemble des bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux (dont la Banque mondiale, le PNUD, la CNUCED et l’OMC, mais pas
l’OMPI ou l’OEB) qui entreprendront des évaluations et des programmes communs
pour le développement des capacités liées au commerce et la réforme du
commerce. Comme le Cadre intégré inclut déjà en théorie un appui à la mise en
œuvre de l’Accord sur les ADPIC dans les PMA, il semble être l’instrument
adéquat pour approfondir la coordination entre les bailleurs de fonds sur l’assistance
liée à la PI. En pratique, la première étape pourrait être l’adhésion formelle
de l’OMPI et l’OEB au groupe des principaux bailleurs de fonds du Cadre
intégré.
L’assistance technique liée à la PI devrait être
organisée en tenant compte des besoins et des priorités de développement
spécifiques à un pays particulier. Pour ce faire, on pourrait incorporer cette
assistance au Cadre intégré pour faciliter l’intégration avec les plans de
développement nationaux et les stratégies d’assistance des bailleurs de fonds.
Enfin, pour relever
ces nouveaux défis, les bailleurs de fonds et les pays en développement doivent
trouver de nouveaux moyens de collaborer plus efficacement. En particulier, il
leur faudrait faire un meilleur usage des mécanismes institutionnels existants,
aux niveaux national, régional et international, pour comprendre les besoins de
renforcement des capacités en matière de PI des pays en développement, pour
partager l’information sur les projets d’assistance technique et pour
entreprendre des examens sectoriels en collaboration dans le cadre de
l’élaboration constante des meilleures pratiques.
Les bailleurs de fonds devraient renforcer les
systèmes permettant de suivre et d’évaluer les programmes de coopération pour
le développement liés à la PI. Une première mesure importante serait de créer
un groupe de travail réunissant bailleurs de fonds et pays en développement
pour commanditer et surveiller une étude d’impact à l’échelon du secteur
concernant l’assistance technique liée à la PI accordée aux pays en
développement depuis 1995. Une équipe d’experts externes devrait effectuer
cette évaluation.
Dans le prochain chapitre, nous revenons sur la
question de la pertinence du contenu de l’assistance technique offerte par les
agences internationales et nationales.
Notre
analyse laisse entendre que les intérêts des pays en développement sont mieux
servis si leurs régimes de propriété intellectuelle sont adaptés à leurs
circonstances économiques et sociales particulières. De même que les pays
développés sont loin à l’heure actuelle d’appliquer les DPI de manière
uniforme, ce qui était encore plus courant dans le passé, de même les pays en
développement devraient pouvoir procéder de cette manière. En fait, c’est
peut-être plus important pour les pays en développement parce que les erreurs
coûteuses qu’ils pourraient commettre dans leur choix de mesures leur seront
plus difficiles à supporter. Toutefois, il est alors crucial de savoir comment
cet objectif peut être atteint tout en restant dans le cadre de l’architecture
internationale complexe des règles et des normes multilatérales, régionales et
bilatérales en matière de PI, lesquelles imposent des limites sans précédent à
la liberté des pays d'agir comme ils le jugent nécessaire dans ce domaine.
(Voir Encadré 8.1 pour une vue d’ensemble).
Cette
question se pose non seulement dans le contexte des réglementations existantes,
mais également à propos de celles qui sont actuellement à l’étude. Comme nous
l’avons vu au Chapitre 6, le débat actuel relatif à une plus grande
harmonisation internationale des systèmes de brevets qui a lieu dans le cadre
de l’OMPI soulève de manière urgente la question de savoir comment les intérêts
des pays en développement pourraient être correctement protégés et même promus
dans le système international. D’une manière plus générale, nos conclusions
montrent qu’il incombe à la communauté internationale d’évaluer si les
mécanismes actuellement en place pour la négociation des normes de propriété
intellectuelle, que ce soit de manière multilatérale ou bilatérale, tiennent
suffisamment compte des intérêts des pays en développement et des populations
pauvres. Nous estimons que le cadre institutionnel n’est pas vraiment en mesure
d’assurer cette tâche et qu’il lui faudrait faire preuve d’une sensibilité
beaucoup plus grande à toutes ces questions.
Les
points essentiels que nous abordons ci-dessous sont les suivants :
·
Les
institutions internationales majeures, en particulier l’OMC et l’OMPI,
fournissent-elles des conseils et une analyse suffisants fondés sur une
compréhension des besoins particuliers des pays en développement et des
populations pauvres ?
·
Dans
leurs relations bilatérales avec les pays en développement, les pays développés
tiennent-ils suffisamment compte de l’impact des DPI sur les pays en
développement et en particulier sur leurs population pauvres ?
·
Les
pays en développement sont-ils eux-mêmes suffisamment conscients de ce qui
favorise leurs intérêts et ont-ils la capacité de les défendre dans les
négociations bilatérales et multilatérales ?
Afin de
pouvoir réponde à ces questions, il est nécessaire de mieux comprendre quelle
est l’architecture internationale de la PI, comment les règles sont formulées à
ce niveau et comment les institutions peuvent contribuer à les incorporer à la
législation nationale.
L’architecture du régime des
DPI dans le monde est devenue de plus en plus complexe et comprend toute une
variété d’accords multilatéraux, d’organisations internationales, de
conventions régionales et d’arrangements bilatéraux.
Traités multilatéraux
La plupart de ces accords
sont administrés par l’OMPI et sont de trois types :
i. Traités fixant les normes, qui définissent les normes fondamentales
convenues de protection. Il s’agit notamment de la Convention de Paris, de la
Convention de Berne et de la Convention de Rome. Parmi les importants traités non
OMPI de cette nature, il faut compter la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Accord sur les ADPIC.
ii. Traités relatifs au système mondial de protection, qui facilitent
le dépôt ou l’enregistrement des DPI dans plus d’un pays. Il s’agit notamment
du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de l’Arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
iii. Traités de classification, qui organisent l’information concernant
les inventions, les marques et les dessins et modèles industriels en structures
indexées, facilement exploitables pour la recherche. Un exemple est
l’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des
brevets.
D’autres accords internationaux
portant également sur les DPI comprennent notamment le Traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et la
Convention sur la diversité biologique.
Traités ou
instruments régionaux
Ce genre d’accord comprend
par exemple la Convention sur le brevet européen, le Protocole d’Harare relatif
aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l’ARIPO, et
le Régime commun concernant la propriété intellectuelle de la Communauté
andine.
Accords commerciaux régionaux
Les accords commerciaux
régionaux ont normalement des sections établissant des normes de PI. Par exemple, l’Accord de libre-échange
nord-américain, la proposition de Zone de libre-échange des Amériques, et
l’Accord de partenariat ACP/UE de Cotonou.
Accords bilatéraux
Il s’agit plus
particulièrement des accords bilatéraux qui portent sur les DPI parmi d’autres
questions abordées. Un récent exemple est l’Accord de libre-échange de 2000
entre les Etats-Unis et la Jordanie, mais il en existe de nombreux autres (voir
Tableau 8.1).
Source:
CNUCED/ICTSD (2002)[403].
Plusieurs
institutions internationales prennent part à la fixation des normes de
propriété intellectuelle. L’OMPI est la principale institution internationale
chargée d’organiser la négociation des traités en matière de PI et leur
administration. Avec l’inclusion de l’Accord sur les ADPIC dans le Cycle
d’Uruguay, la propriété intellectuelle est maintenant aussi sous la houlette de
l’OMC, qui a succédé au GATT, et certains avancent que l’influence de l’OMPI en
a été diminuée. Un Conseil spécial des ADPIC a été créé au sein de la structure
de l’OMC pour administrer l’Accord sur les ADPIC.
Les secrétariats de
l’OMPI et de l’OMC sont au service d’organisations gouvernées par leurs
membres. Les gouvernements nationaux fixent la politique générale et décident
des résultats des négociations. En réalité, comme dans toute bureaucratie où la
gouvernance dépend d’une structure dispersée, le secrétariat et son bureau
directeur jouent un rôle plus ou moins grand lorsqu’il s’agit de déterminer
quelles sont les questions importantes et d’arrêter la gamme des solutions
possibles. L’OMPI et l’OMC sont également
soumises à un ensemble d’influences extérieures, situées en dehors de la
structure officielle de la gouvernance, notamment de la part des Etats membres,
dont certains ont plus d’influence que d’autres, ainsi qu’à celles des groupes
de pression extérieurs, comme l’industrie, les associations industrielles et
les ONG.
Les gouvernements
et autres entités comprennent que l’OMC est particulièrement importante dans
son rôle d’institution créatrice de règles commerciales contraignantes. Ceci
est dû à l’ampleur de son champ d’action et au fait qu’elle a le pouvoir
d’imposer des sanctions qui peuvent avoir une influence significative sur les
politiques nationales. C’est pourquoi les pays développés choisissent le
GATT/OMC, plutôt que l'OMPI, comme mécanisme convenant à la mondialisation de
la protection de la PI par l’intermédiaire de l’Accord sur les ADPIC. C’est
aussi la raison pour laquelle l’industrie, les gouvernements et les ONG se sont
penchés avec autant d’attention sur la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les
ADPIC et la santé publique. L’importance de l’OMC pour ce qui est d’établir des
règles en matière de PI n’est pas tant due à sa compétence particulière dans le
domaine de la fixation des normes internationales de PI (bien qu’elle ait une
division de la propriété intellectuelle de haute qualité), mais plutôt à son
mécanisme de règlement des différends, instrument puissant que les membres
peuvent utiliser pour faire respecter les obligations découlant de l'Accord sur
les ADPIC auxquelles doivent se conformer leurs partenaires commerciaux, en
faisant jouer la menace de sanctions commerciales. Jusqu’à présent, 24 affaires
ont été soumises à l’OMC pour règlement des différends soulevés par l’Accord
sur les ADPIC, qui pour leur grande majorité ont été présentées par les
Etats-Unis et l’UE.[404]
Par contre, l’OMPI
possède une expertise plus grande dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Mais cette organisation est très différente pour deux raisons.
Tout d’abord, environ 90 % de son
financement provient non pas des gouvernements membres (comme à l’OMC et pour
d’autres institutions des Nations Unies) mais du secteur privé par
l’intermédiaire des taxes versées par les demandeurs de brevets dans le cadre
du PCT - en fait donc de la communauté des titulaires de brevets.[405]
Ensuite, l’OMPI a uniquement pour but, selon la Convention qui l’a instituée,
de promouvoir la protection des DPI. Ses objectifs et ses fonctions ne
comprennent aucun objectif de développement.[406]
Comme on pourrait
le déduire de l’interprétation par l’OMPI de sa mission (voir Encadré 8.2),
l’organisation se fait le défenseur acharné d’une protection accrue de la PI
dans les pays en développement. En fait, les analyses contenues dans les
différents documents de politique générale publiés par l’OMPI ne s’occupent
guère des conséquences négatives éventuelles d’une telle protection. Les DPI
sont principalement présentés comme bénéfiques sans ambiguïté possible. Par
exemple, une publication sur le site web de l’OMPI intitulée « Intellectual Property – Power Tool for
Economic Growth » (Propriété intellectuelle - un instrument puissant de
croissance économique) déclare que les idées selon lesquelles :
« … les brevets ne
sont pas utiles pour les pays en développement, ou qu’ils sont incompatibles
avec les objectifs économiques de ces pays, sont des mythes pernicieux. Ils
sont pernicieux parce qu’ils donnent l’impression qu’il est possible de tout
simplement s’écarter du système international des brevets, et d’arriver
néanmoins à un développement économique. C’est une erreur car les brevets
constituent une partie essentielle de la stratégie économique, indépendamment
du fait que le pays soit développé ou en voie de développement économique. »[407]
Il ne
faut pas accorder trop d’importance à une déclaration individuelle comme
celle-ci, mais nous pensons qu’elle révèle une perspective particulière qui
prévaut au sein de l’OMPI. Comme le présent rapport l’a mis en évidence, il est
incontestable qu’il existe entre la protection de la PI et le développement des
liens plus complexes que ce que suggèrent de telles déclarations. Nous
admettons bien que l’OMPI a un rôle à jouer dans la promotion des DPI.
Toutefois, nous pensons que cela doit se faire d’une manière beaucoup plus
nuancée, véritablement compatible avec les objectifs économiques et sociaux que
les Nations Unies et la communauté internationale se sont fixés. Une démarche
plus équilibrée vis‑à‑vis de l’analyse des DPI, et, par conséquent
des programmes de l’OMPI, serait avantageuse à la fois pour l’organisation et
pour le monde en développement, qui constitue la majorité de ses membres.
Encadré 8.2
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
L’OMPI a pris la suite du
BIRPI (acronyme français pour les Bureaux internationaux réunis pour la
protection de propriété industrielle) fondé en 1893. Celui-ci était un
organisme créé principalement pour administrer les Conventions de Paris et de
Berne sur la propriété industrielle et le droit d’auteur. L'OMPI n'a été
restructurée et reconstituée en tant qu’institution des Nations Unies qu'en
1974.
Le but de l’organisation,
tel qu’il figure dans la Convention instituant l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, est de « promouvoir la protection de la
propriété intellectuelle à travers le monde ». Etant donné ce but, sa première
fonction consiste à « promouvoir l’adoption de mesures destinées à
améliorer la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et à
mettre en harmonie les législations nationales dans ce domaine ». [408]
Elle est « convaincue de la nécessité d’assurer la pleine intégration des
pays en développement … dans le système international de la propriété
intellectuelle ». Elle estime que « il convient de rechercher
l’harmonisation des mesures nationales en matière d’établissement des droits de
propriété intellectuelle, avec pour objectif la mise en œuvre d’une protection
au niveau mondial ».[409] Voilà donc la perspective dans laquelle elle
gère ses activités de coopération et d’assistance technique avec les pays en
développement.
A l’heure actuelle, les
principales fonctions de l’OMPI consistent à servir de forum pour la
négociation des traités internationaux en matière de PI ; à administrer les
services de ces traités et à faire fonctionner les systèmes de protection
mondiale comme le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et le
système de Madrid ; et à fournir une assistance technique et une formation aux
pays en développement et aux pays en transition.
Le PCT vise à simplifier
l’obtention d’une protection internationale en matière de brevets et à en faire
baisser le coût. En déposant une seule demande internationale de brevet en
vertu du PCT, un demandeur peut rechercher simultanément une protection pour
une invention dans plus de cent pays. Les demandes PCT récentes sont publiées
dans la Gazette PCT afin de faciliter l’accès du public à l’information
technique.
WIPONET est un réseau
d’information numérique mondial fournissant une infrastructure et des services
de réseau pour l’amélioration des échanges de renseignements, afin de permettre
l’intégration des ressources, des processus et des systèmes d’information en
matière de PI en provenance de toutes les communautés mondiales de la PI,
notamment les offices de PI des Etats membres. WIPONET fournira également un
portail pour d’autres systèmes fournis par l’OMPI, comme les Bibliothèques
numériques de la propriété intellectuelle (IPDL), et ultérieurement le dépôt en
ligne de demandes de brevets dans le cadre du PCT.
L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) gère un système servant à résoudre les litiges concernant les noms
de domaine portant sur des marques, ainsi qu’un système des meilleures
pratiques pour les autorités d’enregistrement des noms de domaine, conçu pour
éviter de tels conflits.
L’Académie mondiale de l’OMPI
est une institution qui offre des services d’enseignement, de formation, de
conseil et de recherche dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Source : http://www.wipo.int
L’OMPI
devrait reconnaître de manière plus explicite le fait que la protection de la
PI comporte à la fois des avantages et des coûts, et insister davantage sur la
nécessité pour les régimes de PI d’être adaptés aux conditions particulières
existant dans les pays en développement. Pour cela, il faudrait, à notre avis,
faire preuve de plus de doigté lorsqu’une assistance est fournie aux pays en
développement pour l’application de l’Accord sur les ADPIC et de certaines
autres mesures appropriées, de manière à faire en sorte que les DPI sont exercés
dans l’intérêt de tous.
Pour
parvenir à cet objectif, nous pensons également que l’OMPI aurait avantage à
consulter un groupe plus large d’entités ayant un intérêt dans le système de PI
lors de son processus de prise de décision, comme par exemple les organisations
de consommateurs. L’OMPI a toujours apporté une réponse aux besoins des
secteurs industriels qui font une utilisation intensive de la PI. Nous ne
sommes pas convaincus qu’elle réponde
aussi bien aux intérêts des consommateurs ou des utilisateurs de produits
protégés par la PI. Il est d’importance cruciale à ce sujet que l’OMPI ne soit
pas considérée comme étant principalement sensible aux besoins des
organisations qui ont tout intérêt à renforcer la protection de la PI.[410]
Tout à
fait récemment, l’OMPI a créé deux organismes consultatifs : une Commission
consultative des politiques (CCP) et une Commission consultative du monde de
l’entreprise (CCE). Nous saluons la création de ces groupes dont le rôle
consiste à fournir des conseils d’experts à l’OMPI. Nous nous félicitons
également que soit reconnue la nécessité de la représentation d’une large gamme
d’opinions lorsque des décisions sont prises. Mais nous estimons que les
membres de ces organes devraient refléter de manière plus systématique la
diversité des intérêts de la société concernée par la PI, qu’il s’agisse de
ceux qui la créent ou de ceux qui l’utilisent. Ainsi, les représentants de
l’industrie, de la science, des groupes de consommateurs et autres
organisations de la société civile, ainsi que des experts en PI et des
représentants des gouvernements, permettraient à l’OMPI de jouer un rôle plus
efficace parce qu’elle faciliterait le dialogue avec une large variété de
parties prenantes. Cette participation accrue d’une gamme plus large
d’utilisateurs et de groupes d’intérêt pourrait être associée très utilement à
une coopération plus étroite avec d’autres organisations internationales
concernées, comme l’OMS (notamment pour la mise en œuvre de la Déclaration de
Doha), la FAO, la CNUCED et la Banque mondiale.[411]
L’OMPI devrait s’efforcer d’intégrer les objectifs du
développement dans sa démarche de promotion de la protection de la PI dans les
pays en développement. Elle devrait reconnaître de manière explicite à la fois
les avantages et les coûts de la protection de la PI et la nécessité qui en
découle d’adapter les régimes nationaux dans les pays en développement afin de
garantir que les coûts ne dépassent pas les avantages. Il appartient à l’OMPI
de déterminer quelles mesures concrètes doivent être prises dans ce but, mais
elle devrait au minimum s'assurer que ses comités consultatifs sont composés de
représentants provenant d’un large éventail d’entités, et rechercher en outre
une coopération plus étroite avec d’autres organisations internationales
concernées.
Si l’OMPI adopte
la stratégie que nous proposons, ses articles actuels vont-ils lui permettre de
le faire de manière légitime ? Les objectifs fixés à de nombreuses
organisations internationales sont larges et polyvalents, et permettent une
interprétation très souple si les Etats membres souhaitent changer les
activités de l’organisation afin de répondre à l’évolution des circonstances. A
la différence d’un grand nombre d’autres organisations, l’OMPI a un mandat très
spécifique énoncé dans sa Convention, lequel consiste à promouvoir la
protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et à mettre en
harmonie les législations nationales. Nous ne sommes pas sûrs que ce mandat
puisse s’interpréter comme permettant à l’OMPI d’adapter sa stratégie dans les
pays en développement afin de tenir compte de l’impératif économique qui
consiste à équilibrer les avantages et les coûts de la protection de la PI.
Les Etats membres de l'OMPI devraient réviser les
articles de l'OMPI s'ils ne sont pas capables de les réinterpréter pour
intégrer clairement l'équilibre nécessaire dans ses opérations.
ACCORD SUR LES ADPIC
De
nombreuses discussions ont eu lieu sur la question de savoir si l’objet de
l’Accord sur les ADPIC relève de l’OMC. Certains commentateurs estiment que
l’OMC est essentiellement une organisation de libre-échange et que
l’application mondiale des normes de PI entre pays se trouvant à des niveaux
très différents de développement social et économique ne devrait pas faire
partie de son mandat. Ils affirment que la propriété intellectuelle ne concerne
pas le commerce et en outre que, que l’Accord sur les ADPIC avantageant
principalement les pays développés, cela affaiblit la crédibilité de l’OMC en
tant qu’instrument permettant d’encourager le libre‑échange dans
l’intérêt de tous les pays. Un éminent zélateur de cette opinion est Jagdish
Bhagwati :
« L’Accord
sur les ADPIC n’aboutit pas à des gains mutuels ; au contraire, il positionne
l’OMC principalement comme le percepteur des rentes liées à la propriété
intellectuelle au nom des multinationales. C’est une mauvaise image pour l’OMC
et reflète, selon l’opinion de beaucoup et notamment des organisations non
gouvernementales, le fait que les multinationales « se sont appropriées » l’OMC.»[412]
D’autres répliquent à cet argument en déclarant que la protection de la
PI a toujours fait partie intégrante des échanges et de la diplomatie
commerciale. Selon eux, l’Accord sur les ADPIC est le résultat de négociations
entre Etats souverains dans le cadre d’un ensemble plus large de compromis dont
chacun est censé retirer un avantage. Même si les pays en développement n’ont
pas tous participé aux négociations sur l'accord sur les ADPIC, ils étaient
libres de le faire, comme l’ont fait de manière très active certains grands
pays en développement, plus particulièrement l’Inde et le Brésil.
Il nous semble que, en dépit des antécédents des négociations du Cycle
d'Uruguay et de l’asymétrie des capacités et du pouvoir de négociation entre pays
développés et pays en développement, l’Accord sur les ADPIC va probablement
rester partie intégrante du cadre de l’OMC. Même si nous formulons des réserves
au sujet de l’extension des normes de l’Accord sur les ADPIC à tous les pays en
développement, nous devons reconnaître qu’il est tout à fait improbable qu’un
membre de l’OMC souhaite véritablement renégocier l’accord. De nombreux membres
craignent que s’ils cherchent à obtenir certaines modifications particulières,
ils soient contraints d’accepter par ailleurs des compromis, de telle sorte que
le résultat net ne pourrait pas être à leur avantage. L’Accord sur les ADPIC,
comme tous les autres accords de l’OMC, doit être revu périodiquement et il
faudra accorder l’attention qu’elles méritent aux propositions qui cherchent
véritablement à améliorer les dispositions de cet Accord en vue d’avantager les
pays en développement. Mais au-delà de ces généralités, nous voudrions tirer
deux autres conclusions particulières des données factuelles et de nos consultations
concernant l’Accord sur les ADPIC.
Tout d’abord, il est de première importance que les membres de l’OMC
continuent à préciser les assouplissements prévus dans l’Accord sur les ADPIC
en matière de santé publique et que
les pays en développement soient dotés des moyens leur permettant d’utiliser
ces assouplissements ainsi que d’autres fournis par l’Accord. De nombreuses
nouvelles législations en matière de PI ont été introduites dans les pays en
développement depuis 1995 et certains commentateurs[413] se
sont inquiétés de ce que les flexibilités fournies par l’Accord sur les ADPIC
n’ont pas été pleinement utilisées pour prendre en compte les besoins locaux.
Nos recherches sur les lois en vigueur ou à l’état de projet en matière de PI
auprès de 70 pays en développement et PMA ont permis de découvrir, par exemple,
que seulement un quart de ces pays excluaient de manière spécifique les
végétaux et les animaux de la protection par brevet, que moins de la moitié
prévoyaient l’épuisement international des droits de brevet et que moins d’un
cinquième prévoyaient plus particulièrement ce qu'on appelle une exception
« Bolar » aux droits de brevet.[414] Bien
évidemment, un pays en développement peut avoir de très bonnes raisons de ne
pas faire usage de ces flexibilités, après avoir pris la décision de ne pas le
faire en toute connaissance de cause. Sa liberté de manœuvre peut aussi être
limitée par d’autres engagements, comme des accords bilatéraux.
Mais la
raison peut aussi être que les responsables du processus législatif ne sont pas
conscients des options disponibles, ou de tout ce qu'elles impliquent. Comme
nous le faisons remarquer au Chapitre 7, les pays en développement reçoivent
dans le domaine de la PI une assistance technique provenant d’un large éventail
d’institutions nationales et internationales, comme l’OEB, l’USPTO et les
autorités de PI des pays développés. Mais l’OMPI, en tant qu’institution
internationale responsable de la promotion de la PI, joue un rôle clé dans la
fixation des normes dans ce domaine, par ses lois types et la nature de
l’assistance technique qu’elle fournit. Nos observations sur cette question
sont par conséquent dirigées comme cela se doit à l’OMPI, mais elles s’appliquent
également à tous les autres organismes fournissant des conseils en matière de
PI aux pays en développement.
Nous
avons découvert que si certaines personnes, notamment dans les offices de PI
des pays en développement, accordent une grande importance à l’assistance
technique de l’OMPI, plusieurs particuliers et organisations se sont demandés
avec inquiétude si l’aide fournie par l’OMPI était véritablement adaptée aux
circonstances des pays en développement concernés.[415]
Jusqu’à présent, la nature confidentielle des consultations entre les
fonctionnaires de l’OMPI et un pays en développement, ainsi que l’absence de
toute déclaration de politique générale officielle de l’OMPI sur la nature de
son assistance technique, ont contribué à empêcher de savoir si ces
préoccupations étaient fondées. De plus, l’OMPI ne publie pas ses lois types et
ses annotations en matière de PI qui auraient indiqué dans quelle mesure les
conseils fournis étaient compatibles avec toutes les flexibilités que permet
l’Accord sur les ADPIC. Certaines données factuelles montrent aussi que dans
les cas où l’assistance de l’OMPI avait été reconnue, les résultats
n’incorporaient pas tous les assouplissements prévus par l’Accord sur les
ADPIC. Par exemple, l’Accord révisé de Bangui pour les pays membres de l’OAPI,
dans lequel l’aide de l’OMPI est reconnue, est critiqué par plusieurs parce
qu’il va plus loin que l’Accord sur les ADPIC. Il oblige les PMA membres (la
majorité des membres de l’OAPI) qui le ratifient à appliquer les dispositions
de l’Accord sur les ADPIC avant d’en avoir besoin ; il restreint la délivrance
de licences obligatoires bien au-delà de ce qui est exigé par l’Accord sur les
ADPIC ; il ne permet pas de manière explicite les importations parallèles ; il
incorpore les éléments de la Convention UPOV de 1991 dans l’accord et prévoit
une durée du droit d’auteur de 70 ans après le décès de l’auteur.
Toutefois,
l’OMPI a mis tout récemment sur son site web une page qui décrit l’aide
législative qu’elle fournit en ce qui concerne l’Accord sur les ADPIC et la
Déclaration de Doha. Ceci afin d’apaiser certaines inquiétudes. L’OMPI fait
remarquer, en plus de mettre à disposition les lois types de PI qu’elle
utilise, que :
« Les conseils de
l’OMPI tiennent compte de toutes les flexibilités offertes aux Membres en vertu
des dispositions sur l’Accord sur les ADPIC, notamment celles qui ont été
confirmées dans la Déclaration ministérielle de Doha sur l’Accord sur les ADPIC
et la santé publique (« la Déclaration
ministérielle de Doha »). Les conseils de l’OMPI tiennent compte de la
situation unique de chaque pays, étant donné que les Etats Membres ont des
systèmes juridiques différents et des structures politiques et culturelles
variées. L’OMPI accompagne son conseil juridique écrit d’un processus
interactif entre l’Organisation et les principales parties prenantes de l’Etat
Membre concerné. Pour renforcer le processus de mise en œuvre de l’Accord sur
les ADPIC pendant les quatre premières années, l’OMPI encourage l’interaction
entre les parties prenantes au niveau national, notamment par exemple les
fonctionnaires des commissions de réforme législative, des Chambres de commerce
et Fédérations d’industries, des Institutions de recherche et développement,
des parlementaires, des hauts fonctionnaires des ministères du Commerce, de
l’Agriculture, de la Santé, de la Science et de la Technologie, de la Culture,
de la Justice, de l’Environnement, parmi d’autres. »[416]
Nous nous
félicitons de cette déclaration montrant l’engagement de l’OMPI à fournir aux
pays en développement des conseils qui tiennent compte des flexibilités
accordées par l’Accord sur les ADPIC, et des circonstances spécifiques à chaque
pays. De plus, nous attachons de l’importance, comme nous l’avons indiqué dans
le chapitre précédent, à un processus consultatif étendu pour l’élaboration et
l'évolution de la législation en matière de PI de chaque pays. Une telle
consultation est essentielle pour que, lors de l’élaboration des lois en
matière de PI, il soit tenu compte des objectifs de développement dans les
secteurs de l’agriculture, de la santé et de l’industrie. Néanmoins, nous
pensons qu’il s’agit là du début du processus nécessaire pour que l’OMPI
réponde véritablement aux besoins spécifiques des pays en développement. Par
exemple, il faudrait à notre avis que la loi type actuelle élaborée par l’OMPI
pour les brevets soit retravaillée afin de contenir les meilleurs conseils
possibles concernant la manière dont les pays en développement peuvent utiliser
les assouplissements prévus dans l’Accord sur les ADPIC.[417]
D’autres modifications au niveau de l’organisation de la procédure pourraient
également être nécessaires pour incorporer de manière fonctionnelle ces
nouvelles politiques. D’autres prestataires d’assistance technique en matière de
PI doivent également réexaminer leur politique dans cette même perspective.
L’OMPI devrait prendre des mesures pour appliquer dans
les faits sa politique déclarée selon laquelle elle tient compte davantage de
la nécessité d’adapter ses conseils en matière de PI aux circonstances
spécifiques du pays en développement qu’elle est en train d’aider. Nous
recommandons également que l'OMPI et le gouvernement concerné fassent
participer un plus grand nombre de parties prenantes à l’élaboration de la
législation en matière de PI, à la fois au sein de l'administration et à
l'extérieur, ainsi que les éventuels producteurs et utilisateurs de la PI.
D’autres prestataires d’assistance technique aux pays en développement
devraient prendre des mesures équivalentes.
Notre seconde conclusion concernant l’Accord sur les ADPIC est que, dans
la logique de l’analyse globale du présent rapport, nous ne sommes pas
convaincus par les arguments selon lesquels les pays en développement se
trouvant à différents stades de développement devraient adopter une date
particulière (janvier 2000 pour les pays en développement, janvier 2006 pour
les PMA) à laquelle ils fourniront les normes de protection prévues par
l’Accord sur les ADPIC dans leur régime national de PI, indépendamment des
progrès réalisés s’agissant de la mise en place d’une base technologique
viable. Au contraire, il existe à notre avis de solides arguments qui militent
pour une plus grande flexibilité dans la fixation de la période de temps
optimale nécessaire pour renforcer la protection de la PI, compte tenu du
niveau de développement économique, social et technologique du pays
concerné.
Les dispositions de l’Accord sur les ADPIC prévoient la prorogation de
la période transitoire pour les PMA par le Conseil des ADPIC, bien que la
logique de notre argument s’applique à la catégorie plus large des pays en
développement à faible revenu.[418] Nous pensons que cet Accord serait amélioré
si ses dispositions étaient utilisées pour tenir davantage compte des besoins
spéciaux des PMA. Ces pays ont besoin d’un plus grand délai pour mettre au
point des régimes appropriés de PI et pour créer les infrastructures
administratives et institutionnelles nécessaires ainsi que les cadres réglementaires
requis, y compris des lois supplémentaires, telles que des lois en matière de
concurrence. Les difficultés sont redoutables et pourraient entraîner des coûts
très élevés si les pays se précipitent pour établir un régime de PI inadapté à
leur niveau de développement. Et bien évidemment les gouvernements de nombreux
PMA, notamment en Afrique subsaharienne, sont confrontés à des exigences
beaucoup plus urgentes dans des domaines d’importance vitale comme la santé,
l’éducation et la sécurité alimentaire.
Nous ne pensons pas qu’accorder aux PMA la possibilité de bénéficier
d’une plus grande période de transition pour appliquer les dispositions de
l’Accord sur les ADPIC puisse porter atteinte aux intérêts matériels des pays
développés. La Déclaration de Doha a lancé ce processus en acceptant que les
PMA puissent proroger jusqu’à 2016 au minimum la période de transition avant
d’octroyer une protection par brevet aux produits pharmaceutiques. Logiquement,
la prorogation de cette période de transition devrait maintenant être élargie
pour s’appliquer à l’ensemble de la mise en œuvre des dispositions de l’Accord
sur les ADPIC. Ceci pourrait être facilement adopté par le Conseil des ADPIC en
conformité absolue avec les dispositions actuelles de l’article 66.1 de
l’Accord. De plus, nous pensons que le Conseil des ADPIC devrait aussi
envisager l’introduction de critères permettant de déterminer sur quelle base
après 2016 les PMA devraient respecter les obligations de l’Accord sur les
ADPIC. Ces critères pourraient comprendre des indicateurs de développement
économique et de capacités scientifiques et technologiques, liés au critère qui
est précisé dans l’article, à savoir « qu’ils ont besoin de flexibilité
pour se doter d’une base technologique viable».[419]
Il faudrait accorder aux PMA une
période de transition plus longue pour l'application de l’Accord sur les ADPIC,
jusqu'en 2016 au plus tôt. Le Conseil des ADPIC devrait envisager
l’introduction de critères fondés sur les indicateurs de développement économique
et technologique pour décider de prolongations ultérieures au-delà de cette
date. Les PMA qui ont déjà adopté les normes ADPIC de protection de la PI
devraient être libres de modifier leur législation, s’ils le désirent, pendant
cette période de transition prolongée.
Les pays développés, les Etats-Unis
et l’UE en particulier, ont cherché à encourager les pays en développement à se
conformer aux dispositions des traités internationaux de PI, ou à adopter les
normes plus élevées de protection de la PI. Dans le passé, des concessions
commerciales ont été suspendues et des sanctions commerciales mises en œuvre à
l’encontre de certains pays en développement dont les régimes de PI ne
remplissaient pas les attentes de leurs partenaires commerciaux du monde
développé.[420]
Plus récemment, les pays développés ont eu tendance à rechercher, auprès d’un
nombre croissant de pays en développement, des engagements à propos des normes
de PI en concluant des accords bilatéraux ou régionaux en matière de commerce
et d’investissement qui vont au-delà des prescriptions de l’Accord sur les
ADPIC.[421]
Le Tableau 8.1 ci-après en fournit quelques exemples.
Nous reconnaissons que, dans une certaine mesure, il est légitime que
les pays développés s’intéressent aux normes de PI de leurs partenaires
commerciaux. A notre avis, la fixation de normes multilatérales, lors de
laquelle les capacités de négociation des pays développés et en développement,
tout en restant asymétriques, sont contrebalancées par l’avantage numérique et
la capacité de nouer des alliances, est bien préférable à la conclusion
d’accords régionaux et bilatéraux. De plus, ces accords régionaux/bilatéraux
risquent de réduire l’efficacité du système multilatéral en limitant plus
généralement l’utilisation par les pays en développement des assouplissements
et des exceptions autorisées par l’Accord sur les ADPIC. En particulier, le
principe de la nation la plus favorisée signifie que les conditions convenues
bilatéralement et régionalement doivent être offertes sur la même base à tous
les autres membres de l’OMC.
Il serait peu réaliste de penser que la fixation des normes de PI
disparaîtra complètement de la diplomatie commerciale bilatérale et régionale.
Il est par conséquent impératif que les pays développés veillent à ce que leurs
objectifs de politique générale concernant les normes de PI dans les accords de
commerce régionaux/bilatéraux soient manifestement en harmonie avec leurs
objectifs plus larges de promotion du développement international et de
réduction de la pauvreté. Dans ce but, nous voudrions encourager les pays
développés, un peu comme le font les pays en développement (voir Chapitre 7), à
associer à l’élaboration de la politique en matière de PI tout un ensemble de
parties prenantes, gouvernementales ou
non. La politique en matière de PI doit aussi prendre en considération les
aspects concernant le développement, ce qui doit être fait tant par les pays
développés que par les pays en développement. Les pays en développement ne
devraient pas avoir à accepter des DPI imposés par le monde développé, sauf en
ce qui concerne les engagements pris en vertu d’accords internationaux. Les
négociateurs des pays développés doivent prendre en compte les coûts que
représente pour les pays en développement l'adoption de normes de PI plus
élevées, aussi bien que les avantages que ces normes apportent à leurs
industries.
Tableau 8.1. Exemples d’accords
bilatéraux exigeant des normes plus élevées que celles de l’Accord sur les ADPIC[422]
|
|
Date
|
Exemples de
dispositions allant au-delà de celles prévues par l’Accord sur les ADPIC
|
|
Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et la Jordanie
|
2000
|
Chaque partie doit
appliquer certaines dispositions choisies du Traité de l'OMPI sur le droit
d’auteur, du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes et de la Convention UPOV (1991). Les parties ne peuvent exclure
les végétaux et les animaux de la protection par brevet et doivent prévoir
une prorogation de la durée du brevet pour compenser tout retard excessif de
l'approbation réglementaire.
|
|
Accord sur les relations commerciales et les DPI entre les Etats-Unis et le Cambodge
|
1996
|
Chaque partie doit adhérer à la Convention UPOV et étendre la durée
de la protection du droit d’auteur dans certains cas à 75 ans à partir de la
publication ou à 100 ans à partir de la réalisation (l’Accord sur les ADPIC
n’exige qu’un minimum de 50 ans dans les deux cas). En outre, les parties
peuvent ne pas autoriser autrui à compter sur les données soumises à des fins
de réglementation pharmaceutique pendant une durée raisonnable qui ne saurait
en général être inférieure à 5 ans.
|
|
Accord sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et le
Vietnam
|
2000
|
Les parties ne
peuvent pas exclure de la protection par brevet les inventions qui
comprennent plus d’une race animale ou variété végétale.
|
Dans la mesure où les objectifs du développement ont un rang de priorité
élevé dans le cadre de politique générale des pays développés (comme cela
semble avoir été prouvé à Doha et à Monterrey), il serait peu judicieux de
laisser la politique en matière de PI être influencée principalement par des
groupes d’intérêt industriels et commerciaux des pays développés, dont la
vision de ce qui convient aux pays en développement est fortement colorée par
la perception de leurs propres intérêts. Il faudrait que les gouvernements des
pays développés se fassent leur propre opinion, reposant sur des donnés
factuelles, sur la manière de concilier au mieux les intérêts du développement
dans les pays en développement et leurs propres intérêts commerciaux. En fin de
compte, il n’est pas nécessaire que ce soit un jeu à somme nulle. A notre avis,
la plupart des pays développés ne tiennent pas suffisamment compte des
objectifs du développement lorsqu’ils formulent leur politique en matière de PI
au plan international. Nous pensons en particulier que les pays développés
devraient cesser la pratique qui consiste à utiliser systématiquement les
accords régionaux/bilatéraux pour créer des régimes de PI allant au-delà de
l’Accord sur les ADPIC dans les pays en développement.[423] Les
pays en développement devraient être libres de choisir, dans les limites fixées
par l’Accord sur les ADPIC, comment orienter leurs propres régimes de PI.
Bien que les pays en développement
aient le droit d’opter pour une conformité accélérée avec des normes allant
au-delà de celles prévues par l’Accord sur les ADPIC, ou pour leur adoption,
s’ils pensent que cela est dans leur intérêt, les pays développés devraient
réviser leurs politiques en matière de diplomatie commerciale régionale et
bilatérale avec les pays en développement de manière à ne pas leur imposer des
normes ou des calendriers allant au-delà de ceux prévus dans l’Accord sur les
ADPIC.
La participation active des pays en développement est absolument
essentielle pour garantir tant la légitimité de la fixation des normes que sa
pertinence et son utilité pratique pour des pays se trouvant à des stades de
développement très différents. La réalisation de la Déclaration de Doha montre
en effet que les pays en développement sont en mesure de présenter des
propositions précises et soigneusement conçues susceptibles d’être incorporées
à l’élaboration des règles de l’OMC. Il est par conséquent tout à fait évident,
thème qui se dégage d’une grande partie de notre travail sur le terrain, que
les pays en développement doivent pouvoir participer de manière beaucoup plus
efficace aux négociations internationales en matière de PI, et régulièrement
plutôt qu’à titre exceptionnel.
Pour
prendre part effectivement à ces négociations, les pays en développement
doivent disposer de quatre éléments : une représentation permanente à
Genève ; des délégations dotées d’experts en la matière capables de prendre
part aux réunions et aux négociations ; un soutien technique suffisant pour
l’analyse des politiques ; et des mécanismes fonctionnels permettant la
coordination et l’examen des politiques dans les capitales. Au Chapitre 7, nous
avons souligné la nécessité d’une concertation accrue lors de l’élaboration de
la politique au sein des pays en développement, et qu’il leur était
indispensable de développer les compétences en matière d'élaboration des
politiques de PI dans leurs institutions nationales. Nous allons aborder ici
les deux autres questions.
Il importe d’avoir une représentation permanente à Genève pour veiller à
ce que l’information utile remonte vers les capitales, pour participer aux
consultations et négociations informelles, pour créer des alliances avec des
pays ayant des intérêts semblables, pour pouvoir être élu à la présidence des
réunions et pour permettre un meilleur accès aux services et à l’assistance
offerts par les secrétariats. Une étude récente commanditée par le Secrétariat
du Commonwealth[424] a mis
en évidence que 36 pays en développement, membres de l’OMC ou en cours
d’adhésion, n’avaient pas encore de représentation permanente à Genève parce
qu’ils ne pouvaient pas assumer les frais élevés d’établissement et de
fonctionnement d’une mission.[425] Notre propre analyse montre que 20 PMA sur 45
qui sont membres de l’OMPI ou de l’OMC, ou en cours d’adhésion à l’OMC, n’ont
actuellement aucune représentation permanente à Genève. Lorsque des
représentations permanentes existent pour les pays en développement, elles sont
en moyenne deux fois moins importantes que celles des pays développés.[426] Il y a
deux catégories de pays en développement en ce qui concerne la capacité à participer :
30 à 35 pays en développement à peu près, dont le Brésil, l’Egypte et l’Inde et
certains PMA, comme le Bangladesh, sont des participants effectifs et actifs de
l’OMP et de l’OMPI, et par conséquent exercent une influence sur les processus
d’élaboration des règles de ces organisations. Les autres pays en
développement, y compris un grand nombre de PMA, ne sont actuellement que des
spectateurs aux travaux de l’OMC et de l’OMPI, si même ils y assistent.
Le
mieux serait que les pays en développement puissent envoyer des délégations
d’experts depuis leur capitale pour assister aux négociations et réunions
internationales concernant différentes questions de PI. Pour la plupart de ces
pays, un obstacle fondamental est l’absence de ressources financières pour les
frais de voyage, indépendamment des programmes d’assistance financière que
l’OMPI met à leur disposition.[427]
Même lorsque des délégations viennent des capitales pour assister aux travaux,
leur compétence est parfois limitée à la gestion des DPI, par opposition à une
connaissance de la PI en tant qu’instrument de politique de développement. A
notre avis, il serait utile que les pays en développement soient en mesure
d’inclure certains experts en économie, santé, environnement et agriculture
dans les délégations envoyées aux réunions et négociations pertinentes en
matière de PI.
Il s’agit là à notre avis d’un problème important qui peut avoir des
répercussions dommageables et doit donc être résolu. Certains bailleurs de
fonds financent des initiatives importantes centrées sur des projets.[428] Et
plusieurs pays en développement ont fait des progrès remarquables (par exemple,
le Botswana a ouvert une mission à Genève en 2001 et assiste maintenant
régulièrement aux réunions du Conseil des ADPIC). Mais il faudra encore faire
davantage pour que nous puissions constater une amélioration significative pour
un nombre important de pays en développement.
Nous présentons ci-dessous deux recommandations visant à augmenter de
manière significative la participation des pays en développement au système de
fixation des normes internationales en matière de PI. La première
recommandation vise à veiller à ce que les pays en développement les plus
pauvres, en particulier les PMA, aient la possibilité d’envoyer des
représentants depuis leurs capitales pour assister aux importantes réunions de
l’OMPI et du Conseil des ADPIC de l’OMC. Pour y parvenir relativement
facilement et sans coût excessif, nous proposons d’élargir le programme de
subventions offert actuellement par l’OMPI pour certaines réunions. Le nouveau
programme devrait s’adresser principalement aux PMA, car ce sont eux qui sont
les moins bien représentés à Genève et sont confrontés aux contraintes
financières les plus graves lorsqu’il s’agit d’envoyer des délégations aux
négociations et réunions internationales en matière de PI. Mais ce programme
devrait également être accessible à tous les pays en développement à faible
revenu.
L’OMPI devrait élargir ses
programmes de financement des représentants des pays en développement, de sorte
que ces derniers puissent être effectivement représentés à toutes les
importantes réunions de l’OMPI et de l’OMC les intéressant directement. Il
appartient à l’OMPI et à ses Etats membres de déterminer comment réaliser
efficacement cette représentation et comment la financer à partir du budget de
l’OMPI.
Notre deuxième recommandation porte sur les moyens permettant
d’améliorer la qualité de la participation des pays en développement, dont les
représentants n’ont pas toujours les compétences et l’expérience requises pour
participer à la fixation des normes internationales de PI et à l’étude des
rapports entre la PI et les intérêts nationaux, représentants qui pourraient ne
pas bien connaître certaines questions techniques abordées à l’OMPI et au
Conseil des ADPIC. Pour répondre à ce besoin, nous proposons que deux postes à
temps complet de conseiller en PI (l’un pour la propriété industrielle, l’autre
pour le droit d’auteur, les savoirs traditionnels et autres thèmes de PI)
soient créés à la CNUCED à Genève. Après mûre réflexion, nous avons conclu que
la CNUCED est l’organisation la mieux placée pour remplir ce rôle parce qu'elle
a un mandat suffisamment large pour offrir une assistance technique et
entreprendre des travaux de recherche, non seulement en matière de PI, mais
aussi en ce qui concerne toute la gamme des questions relatives au commerce et
au développement. Il est également important, à notre avis que la CNUCED
bénéficie de la confiance des pays en développement qui vraisemblablement
seront les principaux clients d’un tel service. Il existe d’ailleurs un
précédent à cette mesure car la CNUCED a récemment créé un poste semblable,
avec un financement émanant du DFID, pour les pays en développement assistant aux
négociations de l’OMC sur le commerce des services.
La CNUCED devrait établir deux nouveaux postes
de conseillers en matière de propriété intellectuelle pour aider les pays en
développement dans les négociations internationales sur la PI. Nous proposons que
le DFID envisage un financement initial
de ces postes pour prendre la suite du financement actuel du projet lié aux
ADPIC de la CNUCED.
Nous soulignons que ces mesures n’ont aucunement pour but de se
substituer au renforcement des capacités analytiques et administratives liées à
la PI au sein des institutions nationales des pays en développement. En fait,
notre intention est que ces recommandations appuient celles qui ont été faites
au Chapitre 7.
Nous avons été
frappés par l’ampleur et l’influence des activités récentes des ONG en matière
de PI. Nous pensons que les ONG apportent, et peuvent continuer à apporter à
l’avenir, une contribution positive à la promotion des intérêts des pays en
développement. Les campagnes visant à sensibiliser l’opinion entreprises par
les ONG des domaines du développement et de la santé ont été des éléments
importants qui sont venus appuyer la cause des pays en développement pendant
les négociations de la Déclaration ministérielle à Doha. Dans le domaine de
l’agriculture, des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, certains
groupes d’ONG jouent un rôle essentiel parce qu’ils soulignent et analysent les
points intéressant directement les pays en développement.
Bien sûr, les ONG diffèrent considérablement les unes des autres en ce
qui concerne les intérêts qu’elles représentent, le dosage entre défense des
intérêts et recherche dans leurs activités, et la vigueur avec laquelle elles
défendent leurs intérêts. On s’est posé à juste titre la question de savoir qui
les ONG représentaient exactement et devant qui elles étaient responsables. De
temps à autre, nous estimons pour notre part que certaines des questions
abordées exigeraient une réflexion plus approfondie. Mais le fait est que les
ONG ont aidé à faire mieux connaître les questions relatives à la PI et que
certaines d’entre elles ont accès à une plus grande expertise dans ce domaine
que de nombreux fonctionnaires des pays en développement. Il est par conséquent
indispensable de veiller à ce que le rôle joué par les ONG soit constructif de
manière à apprécier correctement les besoins des pays en développement, et à ce
qu’on les laisse jouer un rôle dans le dialogue international relatif à toutes
ces questions.
Certains sont préoccupés par le fait que certaines ONG agissent en tant
que « représentants par procuration » des gouvernements des pays en
développement dans le dialogue international. Mais d’autres soulignent que les
pays en développement font preuve de discernement lorsqu’ils cherchent à
obtenir l’aide des ONG, ou tout au moins devraient le faire. Quelles que soient
les formes qu’un tel soutien puisse prendre, il importe que les pays en
développement aient les moyens d’identifier et de présenter leurs propres
intérêts, et soient aidés dans cette tâche. Pour cela, le mieux serait à notre
avis que les pays en développement disposent d’une large variété de ressources
auxquelles ils puissent faire appel pour les aider à élaborer leur politique en
matière de PI et à participer aux négociations.
Les ONG peuvent certainement apporter cette aide, mais leur rôle actuel
consiste plutôt dans une certaine mesure à combler une lacune. Comme nous
l’avons fait remarquer plus haut, il est indispensable que d’autres sources
d’une telle aide, notamment les institutions internationales concernées, comme
l’OMS et la FAO, cherchent comment mieux adapter leurs conseils en matière de
politique et leur assistance technique aux besoins des pays en développement
dans le domaine de la PI. Mais en même temps, les ONG, de même que d’autres
groupes de la société civile, pourraient avoir un rôle plus constructif si on
leur donnait plus souvent l’occasion de participer aux délibérations.
L’OMC et l’OMPI
devraient donner aux organisations représentant la société civile de plus
nombreuses possibilités de jouer leur rôle légitime d’une manière aussi
constructive que possible. Par exemple, on pourrait inviter les ONG et d’autres
groupes de la société civile concernés à participer aux réunions des comités
consultatifs appropriés, ou à y assister en qualité d’observateurs, ou encore
organiser régulièrement des dialogues publics sur des thèmes actuels auxquels
les ONG pourraient participer.
Les règles
internationales concernant la PI s’enrichissent très rapidement. Comme nous
l’avons signalé au Chapitre 5, environ une année après la conclusion de
l’Accord sur les ADPIC, l’OMPI a achevé deux nouveaux traités internationaux
concernant le droit d’auteur et l’Internet. Le Comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs
traditionnels et au folklore s’occupe de ces questions complexes à l’OMPI. Et
plus récemment, les membres de l’OMPI ont commencé à s’intéresser à l’avenir du
système des brevets au niveau international. A mesure que les règles évoluent,
il est important que leur impact réel et potentiel soit correctement compris
afin que les mesures prises reposent sur des données fermement établies, et
moins sur des idées préconçues concernant ce que ces règles représentent pour
les pays en développement.
Cette entreprise
difficile comporte deux aspects. Tout d’abord, comme nous l’avons noté, il faut
obtenir plus de données factuelles sur l’effet que pourrait avoir sur les pays
en développement un renforcement de la protection de la PI, notamment dans les
pays à faible revenu qui manquent d’une base technologique viable.
Deuxièmement, il existe toute une gamme de nouvelles questions au sujet
desquelles il faudra analyser et bien comprendre les rapports entre protection
de la PI et besoins en matière de développement. Par exemple, une liste‑type
de certains des thèmes qu’il faudrait examiner au cours des cinq à dix
prochaines années pourrait comprendre :
·
Les conséquences d’une application
complète de l’Accord sur les ADPIC dans le monde développé, y compris les
dispositions relatives aux moyens nécessaires pour le faire respecter.
·
Les conséquences du mouvement vers
l’harmonisation et l’intégration des systèmes de brevets au niveau
international.
·
L’impact des brevets et autres DPI
dans les nouveaux domaines technologiques en évolution rapide, comme la
biotechnologie et les logiciels.
·
L’impact sur l’accès aux
informations essentielles au développement par l’Internet, y compris la
protection technologique par les éditeurs et autres fournisseurs de contenu, et
la législation anti-contournement. De plus, il y aura les questions concernant
la réaction à avoir lorsque des pays tenteront d’exercer une compétence juridique
sur des serveurs étrangers en vue d’influer la manière dont ces serveurs
distribuent l’information sur l’Internet.
·
D’autres modèles de protection des
DPI convenant aux pays en développement.
·
Les meilleurs moyens de renforcer
les capacités en matière d’élaboration des politiques de PI et d’administration
et de respect de la PI dans les pays en développement, et de rendre plus
efficace l’aide apportée par les bailleurs de fonds.
A l’heure actuelle,
le travail de recherche sur la PI est financé et entrepris par une variété
d’organisations des secteurs public et privé : universités, ONG,
associations professionnelles, instituts de PI et organismes de développement.
L’OMPI commandite des études sur certains thèmes (elle vient par exemple de
terminer un très utile programme d’étude de cas dans le domaine des savoirs
traditionnels) et, de temps en temps, des documents de recherche, mais nous
sommes surpris qu’elle ne finance pas un programme de recherche plus étendu et
plus approfondi orienté vers les nouvelles questions dans ce domaine.
L’Académie mondiale de l’OMPI s’occupe principalement de formation à l’heure
actuelle, mais la recherche fait partie de son mandat. Nous pensons qu’il
serait intéressant que l’OMPI étende le travail de recherche entrepris à l’Académie
afin de mieux s’informer, ainsi que ses membres, sur les incidences de la PI
dans les pays en développement arrivés à différents stades de développement.
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les recherches axées sur les pays en
développement à faible revenu sont trop rares, et celles qui sont entreprises
par les organisations des pays en développement elles-mêmes dans le cadre de
leurs programmes nationaux le sont encore plus.
Nous pensons que le
système ne peut s’améliorer du point de vue du développement que si nous
parvenons à mieux comprendre les rapports entre la PI et le développement. Par
conséquent, il est important pour la communauté de ceux qui financent et qui
entreprennent les travaux de recherche dans le monde de relever ce défi. Il faudra
certainement entreprendre sur des sujets comme ceux que nous avons énumérés
plus haut de nouveaux travaux de recherche et recueillir des études de cas
concernant les pays. Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Toutefois, en
dehors des questions de ressources et des priorités à affecter à la recherche,
nous pensons qu’il y aurait également tout à gagner à accroître dans ce domaine
la collaboration et la coordination entre les bailleurs de fonds et les
chercheurs dans les pays développés et dans les pays en développement.
Nous pensons à un
réseau national et à une initiative de partenariat réunissant les organismes de
développement, les gouvernements des pays en développement, les chercheurs en
matière de PI et les ONG. Ses objectifs consisteraient à identifier les
priorités et à encourager la coordination des programmes de recherche, à
améliorer le partage des connaissances entre partenaires et à faciliter une
plus grande diffusion des résultats grâce au financement de publications, de
conférences et de ressources mettant en jeu l’Internet. Un comité de direction
surveillerait les opérations de cette initiative et des groupes de travail
pourraient être créés sur certains thèmes particuliers. Cette initiative aurait
probablement besoin d’un petit secrétariat très efficace, mais l’idéal serait
qu’il trouve sa place dans l’une des organisations partenaires.
Les commanditaires des travaux de recherche, y
compris l’OMPI, devraient fournir des fonds pour soutenir de nouveaux travaux
relatifs aux liens entre la PI et le développement dans les domaines qui ont
été identifiés dans notre rapport. La création d’un réseau international et
d’une initiative de partenariat entre les commanditaires de travaux de
recherche, les gouvernements des pays en développement, les agences de
développement et les universités dans le domaine de la PI pourrait aider à
identifier et à coordonner les priorités de la recherche, à partager les
connaissances et à faciliter une plus grande diffusion des résultats. Nous
recommandons avant tout que le DFID entreprenne, en collaboration avec
d’autres, la définition d’une telle initiative.
SIGLES
ADPIC – Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
ARIPO –
Organisation régionale africaine de la propriété industrielle
ARV –
(médicament) antirétroviral
CDB –
Convention sur la diversité biologique
CIB –
Classification internationale des brevets
CMH –
Commission Macroéconomie et Santé (OMS)
CNUCED – Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement
DFID – Ministère britannique du
développement international
DMCA – Digital Millennium Copyright Act (Loi du millénaire
sur le droit d’auteur numérique)
DOV – Droit
d'obtention végétale
DPI –
Droits de propriété intellectuelle
FAO – Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FDA – Food
and Drugs Administration (Etats-Unis)
GATT – Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
GCRAI – Groupe
consultatif pour la recherche agricole internationale
GM – Génétiquement
modifié
GSK –
GlaxoSmithKline Plc
ICTSD – Centre international du commerce et du développement
durable
IFAD – Fonds
international de développement agricole
IG –
Indications géographiques
IPGRI –
Institut international des ressources phytogénétiques
ITPGR – Traité
international sur les ressources phytogénétiques
IUPGR –
Engagement international sur les ressources phytogénétiques
MRC – Conseil
de la recherche médicale (Royaume-Uni)
MSF –
Médecins sans Frontières
MST – Maladies
sexuellement transmissibles
NIH –
Instituts nationaux de la santé (Etats-Unis)
OAPI –
Organisation africaine de la propriété Intellectuelle
OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques
OEB – Office
européen des brevets
OMC –
Organisation mondiale du commerce
OMPI – Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OMS –
Organisation mondiale de la santé
ONG –
Organisation non gouvernementale
ONU –
Organisation des Nations Unies
ONUDI –
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
ONUSIDA – Programme
conjoint des Nations Unies pour le VIH/SIDA
OUA –
Organisation de l’unité africaine
PCT –
Traité de coopération en matière de brevets
PI –
Propriété intellectuelle
PMA – Pays
les moins avancés
PME –
Petites et moyennes entreprises
PNUD –
Programme des Nations Unies pour le développement
PVV –
Protection des variétés végétales
R&D –
Recherche et développement
SIDA –
Syndrome d’immunodéficience acquise
TKDL –
Bibliothèque numérique des savoirs traditionnels
UE –
Union européenne
UNESCO –
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UPOV – Union internationale pour
la protection des obtentions végétales
USDA –
Ministère de l’agriculture des Etats-Unis
USPTO – Office américain des
brevets et des marques
VIH – Virus
de l’immunodéficience humaine
GLOSSAIRE
Biopiraterie : Il n’existe aucune définition
officielle de la « biopiraterie ». Le Groupe d’action sur l’érosion, la
technologie et la concentration (Groupe ETC) définit ce terme comme «
l’appropriation des savoirs et des ressources génétiques des communautés
agricoles et autochtones par des personnes ou des institutions visant à obtenir
un contrôle monopolistique exclusif (généralement par le biais de brevets ou de
droits d'obtention végétale) sur ces ressources et ces savoirs ».
Brevet : (voir Encadré 1.1) Droit exclusif
conféré pendant une durée donnée à un inventeur en vue d’empêcher des tiers de
fabriquer, vendre, distribuer, importer ou utiliser son invention, sans
concession de licence ou autorisation. En échange, la société exige que le
titulaire du brevet divulgue l’invention au public. Pour être brevetable, une
invention doit habituellement satisfaire à trois conditions : nouveauté
(caractéristiques nouvelles qui ne font pas partie de « l'état de la technique
»), activité inventive ou non-évidence (connaissances non évidentes à un homme
du métier) et applicabilité industrielle, ou utilité (Etats-Unis).
Concession réciproque
de licences :
Echange mutuel de licences entre titulaires de brevets.
Consentement préalable
donné en connaissance de cause : Consentement donné par une partie à une
activité après avoir été dûment informée de tous les faits matériels liés à
ladite activité. La CDB stipule que l’accès aux ressources génétiques est
soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause du pays qui
fournit les ressources.
Déclaration de Doha
(sur les ADPIC et la santé publique) : (voir Encadré 2.1) Déclaration convenue à la Réunion
ministérielle de l’OMC à Doha en 2001, dans laquelle il est dit que l’Accord
sur les ADPIC doit être interprété et mis en œuvre de manière à protéger la
santé publique et qui précise certaines flexibilités accordées par l’Accord
dans ce but.
Divulgation de
l’origine :
(voir Encadré 4.4) Obligation pour les demandeurs de brevets de divulguer dans
les demandes déposées l’origine de la matière biologique sur laquelle
l’invention est fondée.
Droit d’auteur : (voir Encadré 1.1) Le droit
d'auteur confère aux créateurs d’œuvres originales littéraires, scientifiques
et artistiques des droits exclusifs qui sont créés
sans formalité par la création de l’œuvre, et sa durée est (en général)
égale à la vie du créateur plus 50 ans (70 ans aux Etats‑Unis et dans l’UE).
Ce droit empêche la reproduction, la représentation
publique, l’enregistrement, la diffusion, la traduction ou l’adaptation non
autorisées, et permet la perception de redevances pour tout usage autorisé.
Droits de propriété intellectuelle (DPI) : (voir Encadré 1.1) Droits conférés par la société à des particuliers
ou à des organisations au titre d’inventions, d’œuvres littéraires et
artistiques, et de symboles, de noms, d’images et de dessins et modèles
utilisés dans le commerce. Ils donnent pendant une durée limitée le droit au
titulaire d’empêcher toute autre personne d’utiliser sans autorisation l’objet
du droit de propriété.
Droits des
agriculteurs :
(voir Encadré 3.2) Droits que confèrent aux agriculteurs et particulièrement à
ceux des centres d'origine/de diversité des ressources phytogénétiques leurs
contributions passées, présentes et futures à la conservation, l’amélioration
et la disponibilité de ces ressources.
Droits d'obtention
végétale (DOV) :
(voir Encadré 1.1) Droits conférés aux obtenteurs de variétés végétales
nouvelles, distinctes, uniformes et stables. Ils offrent normalement une
protection pour vingt ans au minimum. La plupart des pays concèdent des
exceptions aux agriculteurs pour conserver et replanter les semences sur leurs exploitations
et pour de nouvelles recherches et sélections.
Enregistrement : Procédure officielle pour obtenir
un droit de PI exigeant habituellement une demande et l’examen de cette
demande. Certains droits de PI, comme le droit d’auteur, sont disponibles
automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de les enregistrer. Les demandes de
brevets déposées dans certains pays peuvent être simplement enregistrées après
une vérification élémentaire.
Epuisement des
droits :
Principe selon lequel les droits de PI du détenteur des droits concernant un
produit sont considérés comme épuisés (c’est‑à‑dire qu’il ne peut
plus exercer aucun droit) lorsque ce produit a été mis sur le marché par le
détenteur de la PI ou par une personne autorisée.
Etat de la
technique :
Publications ou autres divulgations publiques effectuées avant la date de dépôt
(ou de priorité) d’une demande de brevet et par rapport auxquelles sont jugées
la nouveauté et l’activité inventive de la demande de brevet.
Examen (examen quant au fond) : Examen complet de la demande de brevet effectué par un examinateur de
brevet pour déterminer si la demande remplit toutes les exigences légales de
brevetabilité telles qu’elles figurent dans la loi. L’examen prend en compte tout document trouvé
lors de la recherche.
Exception « Bolar » : Exception à l’application des
droits de brevet permettant à un tiers d’accomplir, sans l’autorisation du
titulaire du brevet, des actes en rapport avec une invention brevetée
nécessaires pour obtenir l’approbation réglementaire d’un produit.
Génomique : Discipline scientifique relative à
la cartographie, au séquençage et à l’analyse des génomes.
Importations
parallèles :
Désigne l’importation d’un produit breveté en provenance d’un autre pays après
qu’il a été mis sur le marché du pays d’importation par le titulaire du titre,
ou toute autre partie autorisée. Par exemple, dans l'UE il est légal d’acheter
un produit auprès d’un grossiste au Portugal pour le vendre au détail au
Royaume-Uni, bien que ce produit soit breveté dans les deux pays. Le statut
juridique des importations parallèles dépend d’une décision nationale et est
lié à la question de l’épuisement des
droits.
Indication
géographique (IG) : (voir Encadré 1.1) Nom qui identifie l’origine géographique spécifique
d’un produit lorsque certaines qualités, la réputation ou d’autres
caractéristiques des produits peuvent être associées à cette origine. Par
exemple, les produits alimentaires ont parfois des qualités dérivées de leur
lieu de production et de facteurs issus de l’environnement local. L’indication
géographique empêche les personnes non autorisées d’utiliser une IG protégée
pour des produits ne provenant pas de cette région ou d’induire en erreur le
public s’agissant de la véritable origine du produit.
Ingénierie
inverse :
Processus d’évaluation d’une chose pour comprendre comment elle fonctionne afin
de la reproduire ou de l’améliorer. S’applique en particulier dans le domaine
du droit d’auteur où l’ingénierie inverse des logiciels peut être nécessaire
pour garantir l’interopérabilité avec d’autres programmes. S’applique
également, par exemple, aux semi-conducteurs et à la production de médicaments
génériques.
Instruments de
recherche :
Ensemble de toutes les ressources, méthodes et techniques utilisées dans la
recherche.
Licence obligatoire : Licence permettant d’exploiter une
invention brevetée octroyée par l’Etat sur demande d’un tiers, par exemple pour
corriger un usage abusif des droits par le titulaire du brevet.
Logiciels
libres : Logiciels
dans lesquels le code source est à la disposition du public.
Marque (de fabrique ou
de commerce) : (voir
Encadré 1.1) Droits exclusifs d’utiliser des signes distinctifs, tels que
symboles, couleurs, lettres, formes ou noms en vue d’identifier le producteur
d’un produit, et de protéger la réputation qui y est associée. La période de
protection varie, mais une marque peut être renouvelée indéfiniment.
Médicament
générique : Un
médicament générique est un produit chimique équivalent à un médicament
breveté.
Modèle d’utilité : (voir Encadré 1.1) Un modèle
d’utilité est un droit enregistré qui confère à son titulaire une protection
exclusive pour une invention, semblable à celle d’un brevet. Dans de nombreux pays développés et dans plusieurs pays en
développement il existe en plus du système des brevets certains types de
systèmes de modèles d’utilité, dont la nature précise varie considérablement.
En général, comme dans le cas des brevets, il faut pour être protégée par un
modèle d’utilité que l’invention soit nouvelle, implique une activité inventive
et soit susceptible d'application industrielle. Toutefois, le degré d’activité
inventive nécessaire est habituellement inférieur à celui qui est nécessaire
pour conférer un brevet. De plus, les modèles d’utilité peuvent être octroyés
sans examen préalable destiné à établir que les conditions requises sont
remplies.
Prix
différenciés :
Pratique consistant à fixer des prix différents selon les marchés,
habituellement des prix plus élevés pour les marchés riches, et des prix plus
bas pour les marchés plus pauvres.
Protection des bases
de données :
(Voir Encadrés 1.1 et 5.2) Système de
protection sui generis, empêchant
l’utilisation non autorisée des compilations de données, même si elles ne sont
pas originales.
Protection des
variétés végétales (PVV) : Voir droits d'obtention végétale.
Protection technologique : On entend par « protection
technologique » les moyens permettant d’introduire par des procédés techniques
une défense contre la copie et l’utilisation non autorisée. Les exemples les
plus courants sont les formes de cryptage dans les médias numériques et
l’introduction dans les plantes de caractéristiques qui font que les semences
récoltées sont moins productives, éventuellement stériles.
Recherche (en matière
de brevets) : Recherche
relative à l'état de la technique effectuée
par un examinateur de brevet, qui appelle l’attention du demandeur de brevet sur des documents qui, de l’opinion de
l’examinateur, établissent si l’invention de la demande de brevet répond aux critères
de nouveauté et d’activité inventive. Les documents de recherche primaire sont
les divulgations des autres demandes de brevets, mais toutes les formes d’état de la technique devraient en
principe être couvertes.
Savoirs traditionnels
: Bien qu’il n’y
ait pas de définition acceptée par tous, les savoirs traditionnels comprennent
par exemple les créations, les innovations, les productions littéraires,
scientifiques ou artistiques, les représentations et les dessins fondés sur la
tradition. Ces savoirs se transmettent souvent de génération en génération et
sont souvent associés à une population ou à un territoire particuliers.
Secret
d’affaires : (voir
Encadré 1.1) Informations commercialement utiles sur les méthodes de
production, les plans commerciaux, la clientèle, etc. Elles sont protégées dans
la mesure où elles restent secrètes grâce à des lois qui empêchent leur
acquisition par des moyens commercialement déloyaux ou par divulgation non
autorisée.
Sui generis : Expression
latine signifiant « de sa propre catégorie ». Un système de protection sui generis serait par exemple le fait
que les savoirs traditionnels constituent un système de protection distinct du
système de PI existant.
Utilisation équitable
(fair use ou fair dealing) : (voir Encadré 5.1) Exception au droit d’auteur permettant aux tiers
d’utiliser dans certaines circonstances un matériel protégé par le droit
d’auteur. Dans la plupart des pays, les lois nationales sur le droit d’auteur
incluent des exceptions portant sur la reproduction à des fins personnelles, de
recherche, d’enseignement, d’archivage, d'utilisation par les bibliothèques et
de journalisme, fondées sur le principe d’une « utilisation équitable ».
Variété de pays : Cultivar
(variété cultivée) ou race animale issue de l’activité d’agronomes
traditionnels ou d’améliorations génétiques apportées par ces derniers, mais
sans être influencée par des pratiques de sélection modernes.
Variétés hybrides : Variétés commercialisées par le
biais de semences obtenues à partir de deux variétés différentes de plantes.
REMERCIEMENTS
La Commission
souhaite remercier toutes les nombreuses personnes que nous avons consultées
pendant nos recherches et qui nous ont permis de faire usage de leurs points de
vue, de leurs connaissances et de leur temps précieux. Nous avons pris en
compte avec soin toutes les opinions exprimées dans la rédaction du présent
rapport. Nous voulons aussi remercier tous ceux que nous avons rencontrés lors
de nos déplacements en Afrique du Sud, en Chine, en Inde, au Brésil, au Kenya,
à Genève, à Bruxelles, à Washington et à Londres. Nous avons beaucoup apprécié
la participation active de tous ceux qui ont assisté à notre conférence
internationale, en février 2002. Nous voudrions aussi remercier tout
particulièrement les auteurs des documents de travail de la Commission et ceux
qui ont pris part à nos ateliers d’experts.
Liste des organisations consultées
BRESIL
:
A2R Environmental Fund, ABAPI, ABES, ABRASEM, Action Aid Brazil, Bioamozonia,
Bibliothèque nationale brésilienne, CREA, Daniel & Cia, Dannerman, Siemsen
& Ipenema Moreira, EMPRAPA, Extracta, FAPESP, FINEP, FIOCRUZ, Forum
ONG/Aids, GlaxoSmithKline, Grupo dela Vidda, IBAMA, IBPI, INPI, Instituto Socio
Ambiental, Interfarma, ministère de l'Agriculture, ministère de la Culture,
ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce, ministère de
l'Environnement, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Santé,
ministère de la Science et de la Technologie, Monsen, Leonardos & Cia,
SBACEM, SOCIMPRO, Sun Microsystems.
BRUXELLES,
BELGIQUE : Association internationale de la mutualité (AIM), EFPIA (Fédération
européenne des associations de l’industrie pharmaceutique), Commission
européenne – DG Développement, Commission européenne – DG Commerce.
CHINE : Haute Cour de Beijing, Bureau
chinois du droit d'auteur, Académie chinoise des sciences, Double Crane
Pharmaceuticals, Fudan University, Legend Computers, Microsoft, ministère de la
Science et de la Technologie, Office pour la protection des obtentions végétales,
Centre de la propriété intellectuelle de Shanghaï Pudong, Shanghai Video and
Audio Software Co. Ltd, SIBS, Monsanto, SIPO, Tong Ren Tang, Université
Tsinghua, Ambassade de Grande-Bretagne à Beijing, United Gene Institute,
Consulat général des Etats-Unis à Beijing, Yong You Software Company.
GENEVE,
SUISSE : Mission permanente australienne,
Mission permanente canadienne, Centre pour les lois internationales de
l'environnement (CIEL), Mission permanente ghanéenne, FIIM, Mission permanente
indienne, Mission permanente malaisienne, Mission permanente péruvienne, Bureau
Quaker auprès des Nations Unies, Third World Network, Mission permanente
britannique, CNUCED, OMS, OMPI, OMC, WWF.
INDE:
Abbott, Anand & Anand, BDH Biotech Ltd, Centre de technologie biomédicale,
CIPLA Ltd, Corporate Law Group, Département des systèmes indiens de médecine et
d'homéopathie, Département de la politique et de la promotion industrielles,
Département de la science et de la technologie, GlaxoSmithKline plc, ICI India
Ltd, ICRIER, IDMA, IPA, Kumaran & Sagar, Institut national de recherche
botanique, Fondation nationale pour l'innovation, Institut national de la
communication scientifique, Groupe de travail national sur la législation en
matière de brevets, Nicholas Piramal India Ltd, Novartis Ltd, OPPI, Pfizer Ltd,
Ranbaxy Laboratories Ltd, Subramaniam, Nateraj & Associates, Themis
Medicare Ltd, Unichem.
KENYA : Centre africain pour les études technologiques (ACTS), Organisation
régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), Association
africaine du commerce des semences (AFSTA), Fondation pour la recherche sur la
café, Cosmos Pharmaceuticals Limited, GlaxoSmithKline (GSK), Institut des
affaires économiques (IEA), Institut kényan de la recherche agricole (KARI),
Office kényan de la propriété industrielle (KIPO), Service d'inspection
phytosanitaire du Kenya (KEPHIS), Coalition kényane pour l'accès aux
médicaments essentiels (KCAEM), Syndicat national agricole kényan (KNFU),
ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé - Pharmacien en chef,
ministère du Tourisme et du Commerce, Bureau du conservateur des archives de
l'état civil, Association kényane du commerce des semences (STAK), Fondation
pour la recherche sur le thé.
LONDRES, ROYAUME-UNI (Conférence internationale et ateliers de la
Commission) : ActionAid, Actions Jeunesse, African Centre for Technology Studies,
AIPPI, Amersham PLC, Amsterdam Center for International Law, Institut de
recherche sur les maladies des animaux, Aslib-IMI, Assinsel, Association des
enseignants d'université, AstraZeneca, Université nationale australienne,
Authors’ Licensing and Collecting Society Ltd, Déclaration de Berne,
Biogenerics Inc, BioIndustry Association, Bowdoin College, Ambassade du Brésil
au Royaume-Uni, British Computer Society, Conseil britannique du droit
d'auteur, British Music Rights, Industrie phonographique britannique, Buko
Pharma-Kampagne, Burns, Doane, Swecker and Mathis, LLP, CAB International, Cafod, Cambridge Economic Policy Associates Ltd, Caribbean Regional Negotiating
Machinery, Centre for International Development à l'Université Harvard, Centre
for International Programmes and Links, CGIAR–ISNAR, Institut des conseils en
brevets, CIPLA Ltd, CISAC, Secrétariat du Commonwealth, Confédération des
industriels britanniques, Conserve Africa International, Consumer Project on
Technology, Consumers International, ministère de l'Environnement, de
l'Alimentation et des Questions rurales, ministère de la Santé, ministère du
Développement international, Dow Jones Newswires, Drug Study Group, Duke
University School of Law, Services sanitaires internationaux de ECHO,
Commission économique pour l'Afrique, EPSRC, Essential Drugs Project, e-TALC,
Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, Bureau européen des
brevets, Falco-Archer, Inc, ministère des Affaires étrangères et du
Commonwealth, Florida State University College of Law, Foga, Daley & Co,
Food Right, Forum for Biotechnology and Food Security, Foundation for
International Environmental Law and Development (Field), Free Software
Foundation European, Service économique de l'Ambassade de France, GENE
CAMPAIGN, Genetic Engineering Alliance, Genewatch UK, Office allemand des
brevets et des marques, GlaxoSmithKline, Alliance mondiale pour la mise au
point de médicaments antituberculeux, Herbert Smith, ministère des Finances,
Honeybee Network, Chambre des Lords, IFPI, Institut indien de management,
Institut national indien de la recherche botanique, Indigenous Peoples
Biodiversity Network, Information Waystations and Staging Posts, Institut pour
la politique agricole et commerciale, Institut pour la santé mondiale, Institut
de recherche sur les cultures sur labours, Institut des études sur le
développement, Association internationale pour la protection de la propriété
intellectuelle (AIPPI), International Centre for Trade et Chambre de commerce
internationale, Fédération internationale de l'industrie du médicament,
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
International Indian Treaty Council, International Policy Network, Union
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV),
International Vaccine Institute, IPPPH - Global Forum for Health Research,
ITDG, John Innes Centre, Kent Law School, Mission kényane auprès de l'OMC, Service
d'inspection phytosanitaire du Kenya, Office kényan des droits d'obtention
végétale, Ketchua-Aymara Association for Sustainable Livelihoods, Lakhanpal
Productions, Library Association, Light Years IP, Limbe Botanic Garden,
Linklaters and Alliance, Université de Liverpool, Max Planck Institute for
Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, McDermot, Will
and Emery, Médecins Sans Frontières, Merck & Co Inc, Microsoft Corporation,
Monsanto, Centre national de génie génétique et de biotechnologie (Thaïlande),
Institut des ressources naturelles, Natural Resources International Limited,
Coalition nigériane pour l'accès aux médicaments essentiels, Centre médical
fédéral nigérian, NM Rothschild & Sons Limited, No Patents on Life Coalition,
Non Profit Library, Congo DR, OCDE, Open University, Oxfam, Oxford IP Research
Centre, PATH, Pfizer Inc, Institut portugais de la propriété industrielle,
Prospect, Bureau Quaker auprès des Nations Unies, Queen Mary Intellectual
Property Research Institute, Research & Information System for Developing
Countries, Reuters, Rothamsted International, Rouse and Co. International Ltd,
Jardins botaniques de Kew, Royal Courts of Justice, SCF, SciDev.Net, Science
Centre for Social Research Berlin, Université de Sheffield, Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental, South Centre, SSL International plc, Université Stanford,
Steptoe and Johnson, Stop AIDS Campaign, Sustainable Development, Institut
fédéral suisse de la propriété intellectuelle, The Association of the British
Pharmaceutical Industry, The British Council, The British Society of Plant
Breeders, The Burnhams Group, The Economist, The Journal Server Trust, The
Lancet, Office des brevets, The Rockefeller Foundation, The Royal Society,
Banque mondiale, Third World Network, Trade Marks Patents and Designs
Federation, ONUSIDA, CNUCED, PNUE, Unique Solutions, Association des Nations
Unies, University College London School of Public Policy, Université de l'Ouest
de l'Angleterre, UNU/INTECH, Fondation nationale de la science des Etats-Unis,
USTR, VSO, Wellcome Trust, Catalyst Biomedica, Willoughby & Partners,
Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, World Markets Research Centre, World Press Centre, Mission
zambienne à Genève, Zikonda and Associates.
MUNICH, ALLEMAGNE : Office européen des brevets.
WASHINGTON
DC, ETATS-UNIS : AEI, BIO, CPTech, ministère de la Santé et des Services humains,
Commission judiciaire de la Chambre des représentants, IIPA, IIPI, Merck,
Institut national de la santé, PGFM, PhRMA, Commission judiciaire du Sénat,
Département d'Etat, USTR, Venable, Banque mondiale.
[DISCLAIMER]
Bien que la Commission ait été financée par le
ministère britannique du Développement international et par l'Office britannique
des brevets, elle a travaillé en toute liberté pour parvenir à ses propres
conclusions, et les opinions exprimées dans son rapport ne sont pas celles du
gouvernement britannique.
[8] Voir note 12 ci-après.
[10] Les capacités technologiques peuvent être
mesurées notamment d’après le nombre de brevets américains déposés par an. Les
pays en développement suivants ont, parmi d’autres, obtenu plus de 50 brevets
américains en 2001 : Chine,
266 ; Inde, 179 ; Afrique du Sud, 137 ; Brésil, 125 ;
Mexique, 87 ; Argentine, 58 ; Malaisie, 56. La Chine (Taïwan) en a
obtenu 6 545 et la Corée, 3 763, mais il ne s’agit pas là de pays en
développement selon la classification de la Banque mondiale. Source : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_all.pdf
[12] En 1994, la Chine représentait 4,9 % des
dépenses mondiales de R&D, l’Inde et l’Asie centrale 2,2 %, l’Amérique latine 1,9 %, le
Pacifique et l’Asie du Sud-Est 0,9 % (à l’exclusion des pays nouvellement industrialisés)
et l’Afrique subsaharienne 0,5 %. UNESCO (1998) « Rapport mondial sur la science 1998 », UNESCO, Genève, pp.
20-21. Source : http://www.unesco.org/science/publication/eng_pub/wsr98en.htm
[15] Voir la définition dans le glossaire.
[19]
Hardin, G. (1968) « The Tragedy of the Commons », Science, vol. 162, pp. 1243-1248.
[21]
Jewkes, J., Sawers, D. & Stillerman, R. (1959) « The Sources of Invention », St Martins Press, New York, p. 255.
[22] Il s’agit notamment de : CNUCED
(1996) « L’accord sur les ADPIC et
les pays en développement », CNUCED, Genève ; PNUD (2001) « Rapport sur le développement humain 2001 »,
PNUD, Genève. Source : http://www.undp.org/hdr2001/ ;
Banque mondiale (2001), Chapitre 5 ; et Bystrom, M. & Einarsson, P. mimeo (2001) « ADPIC : conséquences pour les pays en
développement : conséquences pour la coopération au développement suédoise
», SIDA, Stockholm. Source : http://www.grain.org/docs/sida-trips-2001-en.PDF
[25] Voir la définition dans le glossaire.
[27] Voir la définition dans le glossaire.
[28] Le rôle exact du savoir et de l’évolution
de la technique est une question qui est souvent débattue par les économistes,
mais telle est l’opinion dominante. Pour un débat non technique sur cette
question, voir l’ouvrage de la Banque mondiale (1999) « Rapport sur le développement dans le monde 1998-1999 : le savoir au service du développement »,
Banque mondiale, Washington DC, pp. 18-22. Source : http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/
[29] Banque mondiale (1999), p. 20.
[30]
Maskus, K. (2000a) « Intellectual
Property Rights in the Global Economy », Institute for International
Economics, Washington DC, pp. 73-79.
[31] Mansfield, E. (1986) « Patents and Innovation
», Management Science, vol. 32:2, pp.
173-81.
[32]
Radovesic, S. (1999) « International
Technology Transfer and Catch-up in Economic Development », Elgar,
Cheltenham, p. 242. Egalement Saggi, K.
(2000) « Trade, Foreign Direct Investment
and International Technology Transfer: A Survey », Banque mondiale,
Washington DC (Source : http://www1.worldbank.org/wbiep/trade/papers_2000/saggiTT-fin.pdf),
et Rosenberg, N. (1982) « Inside the Black Box; Technology and
Economics », Cambridge University Press, Cambridge.
[33] Voir le glossaire pour l’explication du
PCT.
[34] Les pays en développement auxquels ont
été délivrés plus de 50 brevets américains en 2001 sont notamment : Chine (266), Inde (179), Afrique du Sud
(137), Brésil (125), Mexique (87), Argentine (58), Malaisie (56). La Chine
(Taïwan) en a reçu 6 545 et la Corée 3 763, mais il ne s’agit pas de
pays en développement selon la classification de la Banque mondiale. Selon
notre décompte, 1 560 brevets américains ont été octroyés à des pays en
développement figurant sur la liste de la Banque mondiale, sur un total de
184 057 délivrances de brevets en 2001.
Source : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_all.pdf
[35] Informations fournies par l’OMPI. En
1999-2001, 4 816 demandes ont été déposées par ces cinq pays sur un total
de 5 014 demandes provenant des pays en développement. Pour cette même
période, le total des demandes a atteint 268 918. La Corée (4 622) et
Singapour (640) comptent parmi les principaux demandeurs.
[36] Voir la définition dans le glossaire.
[37]
Stiglitz, J. « Knowledge as a Global Public Good », dans Kaul, I. Grunberg, I.
& Stern, M. (eds) (1999) « Global
Public Goods in the 20th Century: International Cooperation in the
20th Century », Oxford University Press, Oxford.
[38] Nous examinons ces questions de manière
plus approfondie au Chapitre 6.
[39] On peut constater que, dans les économies
« émergentes » comme la Corée, au début le secteur public prend
l’initiative, mais ensuite, à mesure que le secteur privé devient plus
innovant, il tend à prédominer. Ainsi, en Corée, la plupart des brevets
américains sont déposés par le secteur privé, notamment en électronique. En
Inde, le secteur public prédomine toujours, mais il existe des signes d’une
activité de délivrance de brevets accrue dans le secteur privé. Par exemple, en
2001, deux des plus grands laboratoires
pharmaceutiques indiens ont obtenu onze brevets aux Etats-Unis, alors que 58
étaient délivrés au Conseil indien de la recherche scientifique et
industrielle. Source : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/asgstc/inx_stc.htm
[40]
Penrose, E. (1951) « The Economics of the
International Patent System », The John Hopkins Press, Baltimore, pp.
116-117.
[41]
Machlup, F. (1958) « An Economic Review
of the Patent System », US Government Printing Office, Washington DC, p.
80.
[44]
Sachs, J. « The Global Innovation Divide », dans Jaffe, A., Lerner, J. et Stern, S. eds. (en préparation) « Innovation Policy and the Economy: Volume 3 », MIT Press, Cambridge
MA. Source : http://www.nber.org/books/innovation3/
[45] Voir la définition dans le glossaire.
[46] Les conclusions présentées par les
requérants résument leur affaire de la manière suivante : « Ces extensions
répétées et sans nuance de la durée existante du droit d’auteur outrepassent les
pouvoirs du Congrès en vertu de la clause relative au droit d’auteur, parce
qu’elles violent à la fois l’exigence de « temps limité » et
l’exigence « d’originalité » posée par le présent
tribunal. Elles enfreignent l’exigence de « durée limitée » tout d’abord
parce que la durée soumise à des extensions répétées et sans nuance n'est pas
« limitée » ; deuxièmement, parce qu’une durée octroyée pour une
œuvre qui existe déjà « n’encourage pas
les progrès de la science » et, troisièmement, parce que le fait de
conférer une durée plus longue pour des oeuvres existant déjà viole l’exigence
de contrepartie de la clause sur le droit d’auteur, à savoir que les droits de
monopole sont conférés en échange d’un
avantage pour le public. » Source :
http://eon.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/supct/opening-brief.pdf
[47] Source : http://www.myoutbox.net/poar1858.htm
[48] Voir la définition dans le glossaire.
[49] Machlup, F. & Penrose, E.
(1950) « The Patent Controversy
in the Nineteenth Century ». The Journal of Economic History, vol.
10:1, p. 20.
[50] Bien que les examinateurs de brevets et
d’autres personnes puissent douter que la délivrance d’un brevet ne laisse
« rien à la discrétion de quiconque ».
[51]
Machlup & Penrose (1950), p. 24.
[52]
Penrose (1951), pp. 120-124.
[53]L’exploitation obligatoire imposait
une obligation sous diverses formes en application de la loi sur les brevets
afin de garantir que les biens brevetés étaient fabriqués dans le pays, plutôt
qu’importés dans le pays où le brevet avait été délivré.
[54] Schiff, E. (1971) « Industrialisation Without National Patents:
The Netherlands 1869-1919,
Switzerland, 1850 – 1907 », Princeton University Press, Princeton.
[55] Voir la définition dans le glossaire.
[56] La loi prévoyait notamment la seule
protection des procédés (pour une durée de sept ans) dans l’alimentation, la
pharmacie et la chimie. Ceci permettait l’ingénierie inverse des médicaments
brevetés, à condition qu’un procédé différent soit utilisé pour leur
fabrication.
[57] Voir la définition dans le glossaire.
[58]
Kumar, N. (2002) « Intellectual Property Rights, Technology and Economic
Development: Experiences of Asian Countries », Commission Background Paper 1b,
Londres, pp. 27-35. Source : http://www.iprcommission.org
[60] Ministère du Commerce des Etats-Unis,
Bureau d’analyse économique, diverses publications.
[62] Voir la définition des termes utilisés
dans cette phrase dans le glossaire.
[63]
Khan, Z. (2002) « Intellectual Property and Economic Development: Lessons from American
and European History », Commission Background Paper 1a, Londres, p. 16. Source : http://www.iprcommission.org
[64] Maskus, K. & McDaniel, C. (1999)
« Impacts of the Japanese Patent System on Productivity Growth ». Japan
and the World Economy, vol. 11, pp. 557-574.
[65] Dahab, S. (1986) « Technological Change in the Brazilian Agriculture Implements Industry
», Thèse de doctorat non publiée, Université de Yale, New Haven ; et Mikkelsen,
K. (1984) « Inventive Activity in
Philippines Industry », Thèse de doctorat non publiée, Université de
Yale, New Haven.
[66] Tiré de Maskus et McDaniel (1999) et
Kumar (2002).
[68]
Thomas, S. « Intellectual Property in Biotechnology SMEs », dans
Blackburn, R. (ed.) (sous presse) « Intellectual
Property and Innovation Management in Small Firms », Routledge, London.
[70] Voir la discussion figurant dans les
travaux de Kumar (2002), p. 6, et Maskus (2000a), p. 169.
[71] Gould, D. & Gruben, W. (1996) « The Role of Intellectual Property
Rights in Economic Growth », Journal of
Development Economics, vol. 48, pp. 323-350.
[72] Voir discussion dans Maskus (2000a), pp.
102-109.
[75]
Maskus, K. & Penubarti, M. (1997) « How Trade-Related Are Intellectual
Property Rights? » Journal of
International Economics, vol. 39, pp. 227-248 ; et Smith, P. (1999) « Are
Weak Patent Rights a Barrier to US Exports? », Journal of International Economics, vol. 48, pp. 151-177.
[76]
Maskus (2000a), p. 113.
[77] Ces ouvrages sont examinés dans les
travaux de Maskus (2000a), pp. 119-142 ; et de Kumar (2002), pp. 11-18.
[78]
Maskus (2000a), p. 131.
[80] On trouve une allusion juste en passant
dans la description de l’accord conclu à Doha dans le document de la Banque
mondiale (2002) « Financement du développement dans le monde 2002 », Banque mondiale,
Washington DC. Source : http://www.worldbank.org/prospects/gdf2002/
[81] Document de l’Assemblée générale des
Nations Unies A/55/1000, 26 juin 2001. Les DPI sont mentionnés, mais ne
figurent pas dans l’examen des flux de capitaux privés ni des investissements
étrangers directs. Source : http://www.un.org/esa/ffd/a55-1000.pdf
[84] Cette histoire et ses conséquences
actuelles sont examinées dans Patel, S., Roffe, P. & Yusuf, A. (2001) « International Technology Transfer: The
Origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of
Conduct », Kluwer Law International, La Haye.
[86] Les National Institutes of Health
(Instituts nationaux de la santé) des Etats-Unis ont récemment proposé une
mesure pour conférer au gouvernement américain les droits de PI internationaux
acquis par des chercheurs étrangers, sauf pour ce qui concerne le propre pays
du chercheur. Source : http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-02-039.html
[88] L'USTR a lancé des recherches (au titre
de la section 301 de la loi sur le commerce) pour savoir pourquoi les pays
n’étaient pas parvenus à fournir une protection de la PI adéquate aux produits
pharmaceutiques au Brésil (1987), en Argentine (1988) et en Thaïlande (1991).
Source : http://www.ustr.gov/html/act301.htm#301_52
[90] Examen des données disponibles dans
Scherer, F.M. (2001) « The Patent System and Innovation in Pharmaceuticals », Revue internationale de droit économique,
(Edition spéciale, « Pharmaceutical Patents, Innovations and Public Health »),
pp. 109-112
[91] Présentation de Sir Richard Sykes au
Royal Institute of International Affairs, Londres, 14 mars 2002.
[99] Commission Macroéconomie et Santé (2001).
[100] Commission Macroéconomie et Santé (2001),
p. 77.
[101] Voir la définition dans le glossaire.
[102] Commission Macroéconomie et Santé (2001),
pp. 86-91.
[103] Commission Macroéconomie et Santé (2001),
p. 79, et note 103 pour un examen des diverses estimations.
[105] Scrips Pharmaceutical R&D Compendium
2000. Source : www.inpharm.com/intelligence/largesize/cmr020801al.gif.
Mais il faut noter que les estimations varient. L'estimation provenant
de cette source pour 1998 est de 38 milliards de dollars, alors que le Forum
mondial de la recherche en santé estime ce chiffre à 30,5 milliards de dollars
en 1998. Forum mondial de la recherche en santé
(2002) « The 10/90 Report on
Health Research 2001-2002 », Forum mondial de la recherche en santé,
Genève, p. 107. Source : http://www.globalforumhealth.org/pages/index.asp
[106]
Trouiller, P. et al (2002) « Drug Development for Neglected Diseases: a
Deficient Market and a Public Health Policy Failure » The Lancet, vol. 359, pp. 2188-94. Source : http://www.thelancet.com
[108] Pharmaceutical Research and Manufacturers
of America (2001) « PhRMA Industry Profile 2001 », PhRMA,
Washington DC, p. 16.
[109] Forum mondial de la recherche en santé
(2002), p. 107.
[110] Forum mondial de la recherche en santé
(2002), p. 107.
[111] MSF (2001), p. 21. Il n'est guère
possible que plus de 1,2 milliard de dollars soit dépensé en plus des 2,5
milliards de dollars enregistrés pour les pays en développement à faible revenu
et à revenu intermédiaire.
[112] Il s'agit notamment de l'opération
Médicaments antipaludiques (MMV), de l’Alliance mondiale pour la mise au point
de médicaments antituberculeux, de l'Initiative internationale pour un vaccin
contre le SIDA (IAVI) et de l'Initiative Médicaments pour leishmaniose et trypanosomiase (MLT) envisagée.
[113]
Lanjouw, J. & Cockburn, I. (2001) « New Pills for Poor People? Empirical
Evidence after GATT », World Development,
vol. 29:2, pp. 265-289.
27 Voir ONUSIDA (2002), p. 105.
[117] Le bacille peut rester dormant et non
détecté dans l'organisme pendant plusieurs mois ou années.
[118] Alliance mondiale pour la mise au point
de médicaments antituberculeux (2001) « The Economics of TB Drug Development », Alliance mondiale pour la mise au point de
médicaments antituberculeux, New York. Source : http://www.tballiance.org/pdf/rpt_per.PDF
[119] L'industrie souligne qu'un nouveau
médicament réussi peut prendre de 10 à 15 ans de travaux et de mise au point,
et que trois sur dix seulement de ces nouveaux médicaments entraînent un bon
rendement. La mise au point d'un médicament peut coûter de 500 à 800 millions
de dollars. Ces chiffres, toutefois, sont controversés. Pour obtenir le point
de vue de l'industrie, voir par exemple : http://www.phrma.org/publications/publications/primer01
[120]
Kettler, H. (2002) « Using Innovative
Action to Meet Global Health Needs through Existing Intellectual Property
Regimes », Commission Background Paper 1a, Londres, pp. 24-26. Source : http://www.iprcommission.org
[121] Commission Macroéconomie et Santé (2001),
p. 85.
[122] On signale que les entreprises
pharmaceutiques étrangères hésitent à augmenter leur R&D en raison de
l'absence de protection attachée aux produits pharmaceutiques. D'autre part,
certaines données factuelles indiquent une augmentation des investissements au
cours de ces dernières années pour tirer parti des chercheurs indiens
qualifiés. Par exemple, AstraZeneca a récemment créé un centre de recherche
à Bangalore pour effectuer des travaux
sur la tuberculose. Voir par exemple Kumar, N. (2002) « Intellectual Property Rights, Technology and
Economic Development: Experiences of Asian Countries », Commission
Background Paper 1b, Londres, p. 35. Source : http://www.iprcommission.org Voir aussi
Express Pharma Pulse, 2 Mai
2002. Source : http://www.expresspharmapulse.com/20020502/story3.shtml
[123] Le Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale, coordonné par un Secrétariat au sein de la Banque
mondiale. Source : http://www.cgiar.org/
[126] Attaran, A. & Gillespie-White, L.
(2001), p. 1891.
[127] Voir ONUSIDA (2002), pp. 189-201.
[129] Dans une large mesure, l'absence de
brevets indique également l'absence de recherches récentes sur ces maladies.
Voir Trouiller, P. et al (2002).
[131] Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America
(2001), p. 61.
[132] Par exemple, GSK est actuellement en
procès aux Etats-Unis pour établir la validité des brevets concernant son
médicament Augmentin qui arrivent à expiration en 2017 et 2018. Les fabricants
de génériques cherchent à entrer sur le marché après l'expiration des premiers
brevets concernant ce médicament en 2002. La décision relative au brevet de son
médicament le mieux vendu, le Paxil, a été récemment infirmée par la Haute Cour
à Londres. Voir l'article « GSK Suffers from Paxil Patent Ruling », Financial Times, 13 juillet 2002. Source
: http://www.ft.com.
Pour un tour d'horizon sur les procès en matière de brevets dans l'industrie
pharmaceutique, voir l'article « Pharma Sector Loses its Defensive Edge », Investors Chronicle, 19 juin 2002.
Source : http://investorschronicle.ft.com/IC/home
[134] Kumar, N. (2002), p. 28.
[136] Scherer, F. M. & Watal, J. (2001), p.
45.
[141] Borrell, J-R. & Watal, J.
(2002) « Impact of Patents on Access to
HIV/AIDS Drugs in Developing Countries », CID Working Paper No. 92, Centre
for International Development, Harvard University, Cambridge MA, p. 5. Source : http://www2.cid.harvard.edu/cidwp/092.pdf
[142] Voir Scherer, F.M. (2001), pp. 116 -118
pour un examen de la situation au Canada et en Italie.
[143] Au Canada, 16,1 % de toute la R&D en
2001 a été orientée vers la recherche fondamentale, 44,1 % vers les essais
cliniques, 7,9 % vers les améliorations des procédés de fabrication, 7,9 % vers
les études précliniques et 24 % vers les présentations de réglementation sur
les médicaments, des études de biodisponibilité et des études cliniques de
phase IV. Patented Medicines Prices Review Board (2002) « Annual Report 2001 », PMPRB, Ottawa, p.
28. Source : http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/english/06_e/06ann01_e.htm
[145]
Voir par exemple « India’s Plague: Cheaper drugs may help millions who have
AIDS – but how many will they hurt? » The
New Yorker, 17 décembre 2001. Source
: http://www.newyorker.com/
[146]
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (2002).
[147] Voir par exemple le Rapport de la
Conférence sur l’accès des pays de l’Afrique de l’Est aux médicaments
essentiels « Improving Access to Essential Medicines in East Africa: Patents
and Prices in a Global Economy », organisée par Médecins Sans Frontières (MSF)
et Health Action International (HAI), Nairobi, 15-16 juin 2000. Source : http://www.haiweb.org/mtgs/nairobi200006.html
[149] Intervention de Sisule Musungu à la
Session sur les médicaments, Conférence de la Commission, Londres, 21-22
février 2002. Source : http://www.iprcommission.org
[150] Voir la définition des termes de cette
phrase dans le glossaire.
[151] Voir l’explication donnée ci-dessous lors
de la discussion sur la protection des données d’essai.
[152] La justification théorique en est plus
complexe qu’indiqué, puisqu’elle dépend des élasticités relatives de la
demande. On en trouvera une bonne analyse dans Scherer et Watal (2001), pp.
45-49.
[153] Ces offres sont détaillées de manière
utile pour les médicaments contre le VIH/SIDA dans MSF (2002), pp. 11-15.
[154]
Maskus, K. (2000) « Intellectual Property
Rights in the Global Economy », Institute for International Economics,
Washington DC, p. 210.
[155] Scherer et Watal (2001), p. 28.
[156] Le bureau du ministre de la Santé et des
Services humains nous a dit : « Les Etats-Unis peuvent fournir des
articles sans tout d’abord obtenir une licence, tant qu’ils paient une
« rémunération raisonnable et entière ». Le ministre n’a pas eu
besoin d’exercer ce pouvoir. Il a pu négocier un accord historique avec Bayer
qui a garanti une production sans précédent du médicament Cipro. En attendant les
négociations avec Bayer, le ministre a dit très clairement que s’il avait
besoin de l’autorité nécessaire pour fournir des génériques, il demanderait au
Congrès. Cette offre de travailler avec le Congrès sur une question d’une telle
importance ne peut guère être comparée à « menacer » une société. Le
ministre a agit correctement et après mûre réflexion dans la question du brevet
de Bayer pour le Cipro. » Communication personnelle du Dr Stuart
Nightingale, HHS, 10 février 2002.
[157] ONUSIDA (2002), p. 145.
[158] Présentation par Christopher Garrison,
Conseiller juridique de MSF, à la conférence MSF, CPTech, OXFAM et HAI, « Implementation of the Doha Declaration on
the TRIPS Agreement and Public Health: Technical Assistance – How to Get it
Right », Genève, 28 mars 2002.
[160] Ceci reprend en grande partie le contenu
du document de Engelberg, A. (2002) « Implementing
the Doha Declaration - A Potential Strategy for Dealing with Legal and Economic
Barriers to Affordable Medicines ». Source : http://www.cptech.org/ip/health/pc/engelberg.html
[161] Ceci comprend l’utilisation par les
pouvoirs publics à des fins non commerciales, qui est visée à l’article 31 de
l’Accord sur les ADPIC, de même que les autres licences obligatoires.
[162] Les opinions des pays/groupes à ce sujet,
et plus loin dans cette section, sont tirées de la note du Secrétariat de l’OMC
du 11 juillet 2002, résumant les déclarations et les documents présentés par
les membres (Document OMC No IP/C/W/363). Source
: http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/IP/C/W363.doc
[164] De plus, dans le cas d’un moratoire, un
autre membre ne peut entamer de procédure contre le membre qui en est
bénéficiaire, mais le titulaire d’un brevet pourrait demander à un tribunal
national de faire respecter l’obligation du traité à laquelle le membre serait
toujours contraint de se conformer (à la différence d’une dérogation, qui
suspend l’application de l’obligation).
[169] De telles revendications de type premier
usage et usage ultérieur sont acceptées dans l’UE et plusieurs pays en
développement, y compris ceux de l’ARIPO et de l’OAPI. Voir par exemple le
brevet ARIPO No AP868 et le brevet OAPI No
OA09495.
[171]
Thorpe, P. (2002) « Implementation of the
TRIPS agreement by Developing Countries », Commission Background Paper 7,
Londres, p. 20. Source : http://www.iprcommission.org
[172]
Thorpe (2002), p. 8.
[174] Voir la définition dans le glossaire.
[175] Voir la section suivante.
[177] Voir la définition dans le glossaire.
[178] Voir la définition dans le glossaire.
[179] Cette technologie n’est pas encore
exploitée commercialement.
[180]
Pardey, P. & Beintema, M. (2001) « Slow
Magic: Agricultural R&D a Century After Mendel » International Food
Policy Research Institute, Washington DC, p. 10. Source : http://www.ifpri.cgiar.org/pubs/fps/fps36.pdf. Noter que ces chiffres sont basés sur
les taux de change fondés sur la parité du pouvoir d’achat que les auteurs
considèrent comme un moyen plus précis pour donner une idée des grandeurs
relatives. En valeur exprimée en dollar ordinaire, la part des pays développés
est considérablement plus élevée (69 % au lieu de 44 %, voir p. 5).
[181] Pardey, P. & Beintema, M. (2001), p.
4
[183] Pardey, P. & Beintema, M. (2001), p.
8.
[185] Butler
L. & Marion, B. (1985) « The Impacts
of Patent Protection on the US Seed Industry and Public Plant Breeding »,
Food Systems Research Group Monograph 16, Université du Wisconsin, Madison.
[186]
Shoemaker, R. et al (2001) « Economic
Issues in Biotechnology », ERS Agriculture Information Bulletin No. 762,
USDA, Washington DC, p. 36.
[187]
Alston, J. & Venner, R. (2000) « The
Effects of the US Plant Variety Protection Act on Wheat Genetic Improvement
», EPTD Discussion Paper No. 62, Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires, Washington DC. Source : http://www.grain.org/docs/eptdp62.pdf
[188]
Van Wijk, J. & Jaffe, W. (1995) « Impact
of Plant Breeders Rights in Developing Countries » Inter-American Institute
for Cooperation on Agriculture, San Jose, et Université d'Amsterdam.
[189]
Rangnekar, D. (2002) « Access to Genetic
Resources, Gene-based Inventions and Agriculture », Commission Background
Paper, 3a, Londres, p. 39. Source : http://www.iprcommission.org
[190]
Louwaars, N. & Marrewijk, G. (1996), « Seed
Supply Systems in Developing Countries
», Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, Université agricole
de Wageningen, Wageningen, p. 99.
[192] L'IPGRI a produit un document utile qui
traite des questions que les pays en développement devraient examiner lors de
l'adoption de régimes sui generis. IPGRI
(1999) « Key Questions for Decision
makers: Protection of Plant Varieties under the WTO TRIPS Agreement »,
IPGRI, Rome. Source :
http://www.ipgri.cgiar.org/publications/pubsurvey.asp?id_publication=41.
Nous nous sommes également inspirés d'un examen plus détaillé, tiré de :
Leskien, D. & Flitner, M. (1997) « Intellectual
Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a Sui Generis System
», Issues in Genetic Resources No. 6, IPGRI, Rome. Source : http://www.ipgri.cgiar.org/publications/pubfile.asp?ID_PUB=497
[194]
« Législation modèle africaine pour la protection des droits des communautés
locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les règles d'accès aux
ressources biologiques », Organisation de l’unité africaine, 2000, Article 26. Source : http://www.grain.org/publications/oau-model-law-en.cfm
[196] Cette idée est tirée de l’ouvrage de
Leskien et Flitner (1997).
[198] Voir la directive 98/44/CE, Article 9 (et aussi Article 8).
[200] Les avantages et les risques éventuels
des cultures génétiquement modifiées pour les pays en développement sont
examinés dans le document du Conseil Nuffield sur la bioéthique (1999) « Genetically Modified Crops: The Ethical and Social Issues »
Nuffield Council on Bioethics, London, Chapitre 4. Source : http://www.nuffieldbioethics.org/filelibrary/pdf/gmcrop.pdf
[202] Pardey, P. & Beintema, M. (2001), p.
19.
[203] Barton, J. & Berger, P. (2001) p. 4.
[205] Voir la définition dans le glossaire.
[206] Voir par exemple deux accords récents
annoncés les 2/3 avril 2002, entre Monsanto et DuPont, et Monsanto et Ceres.
Source : http://www.monsanto.com/monsanto/media/02/default.htm
[207] On considérait normalement que les six
grandes sociétés étaient AstraZeneca, Aventis, Dow, DuPont, Monsanto et
Novartis, qui ne furent plus que cinq en 2000 avec la fusion des branches
agricoles de Novartis et AstraZeneca.
[211] Shoemaker, R. et al (2001), p. 37.
[212] Les gènes ne sont pas des micro-organismes,
pas plus, en vertu d’une définition étroite, que les lignées de cellules, bien
que, par exemple, le droit britannique des brevets considère que ces dernières
sont des micro-organismes. Voir le « Manual of Patent Practice, Section 1.40 »
de l’Office britannique des brevets. Voir également Adcock, M. & Llewelyn,
M. (2000) « Micro-organisms, Definitions
and Options under TRIPS », Occasional Paper 2, QUNO, Genève.
[213] Voir la définition dans le glossaire.
[215] Voir la résolution ITPGR 4/89.
[217] ITPGRFA,
Article 18.5.
[218] ITPGRFA,
Article 12.3 d).
[219] Un accord contractuel entre le
fournisseur et le bénéficiaire du matériel fixant les conditions régissant ce
transfert.
[220] Dans la suite de ce chapitre, les
références aux « savoirs traditionnels » doivent être entendues comme
incluant également le folklore, sauf mention contraire.
[222] L’article 8 j) de la CDB prévoit que
« Chaque partie contractante respecte, préserve et maintient les
connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales
qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise
l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation
des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le
partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces
connaissances, innovations et pratiques ». Source : http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
[223] Voir la définition dans le glossaire.
[224] Voir la définition dans le glossaire.
[225] Pour de plus amples informations sur les
divers débats en cours, voir par exemple « The State of the Debate on TK », Note d’information rédigée
par le secrétariat de la CNUCED pour le Séminaire international sur les
systèmes de protection et de commercialisation des savoirs traditionnels, en
particulier des médecines traditionnelles, 3-5 avril 2002, New Delhi.
Source : http://www.unctad.org/trade_env/test1/meetings/delhi/statedebateTK.doc
[233] Le système de protection sui generis est un système distinct
personnalisé ou modifié pour s’adapter aux caractéristiques particulières des
savoirs traditionnels ou du folklore. Des systèmes de protection sui generis sont déjà offerts dans des
domaines comme la protection des variétés végétales (système UPOV) et la
protection des bases de données (Directive de la CE 96/9/CE,
11 mars 1996). Source : http://www.eurogeographics.org/WorkGroups/WG1/eu_directive.pdf).
[237] Milpurrurru et al. c. Indofurn Pty Ltd et
al. (1995) 30 IPR 209.
[239] Sixième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, La Haye,
Pays-Bas, 7-19 avril 2002. La décision VI/24 C 3(b) demande un examen plus approfondi du rôle des lois et
des pratiques coutumières concernant la protection des ressources génétiques,
ainsi que les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles et leurs
relations avec les droits de propriété intellectuelle. Source : http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?lg=0&m=cop-06&d=24
[242] A titre d’exemple, la Fondation nationale
de l’innovation de l’Inde cherche à obtenir le consentement préalable donné en
connaissance de cause des innovateurs et détenteurs locaux de savoirs
traditionnels avant de communiquer leurs innovations ou savoirs à des tiers.
Les modalités de partage des avantages sont également convenues. Source : http://www.nifindia.org/benefit.htm
[247] Article premier de la CDB.
[248] Article 15 de la CDB.
[249] Voir note 3 ci-dessus.
[250] Article 16 de la CDB.
[254] Article 2 de la CDB.
[256] Voir les Directives communes pour les jardins
botaniques participants (Common Policy
Guidelines for Participating Botanic Gardens) et autres exemples cités dans
Laird, S. (ed.) (2002) « Biodiversity
and Traditional Knowledge – Equitable Partnerships in Practice »,
Earthscan, Londres, pp. 51-53.
[257] Pires de Carvalho, N. (2000) « Requiring Disclosure of the Origin of
Genetic Resources and Prior Informed Consent in Patent Applications without
Infringing the Trips Agreement: The Problem and the Solution », Washington
University Journal of Law and Policy, vol. 2, pp. 371-401. Source : http://www.law.wustl.edu/Journal/2/p371carvalho.pdf
[258] Precision Instrument Mfg. Co. c. Auto.
Maint. Mach. Co. 324 US 806 (1945).
[259] Keystone Driller Co. c. General Excavator
Co., 290 U.S. 240, 245 (1933) citant Deweese c. Reinhard, 165 U.S. 386, 390
(1887).
[268] On entend par appellation d’origine la
« dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité
servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les
caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique,
comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains », Article 2 de
l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine.
Source : http://www.wipo.org/treaties/registration/lisbon/
[275] Voir par exemple Oman, R (2000) « Copyright – engine of development »,
UNESCO, Paris. Notez que cet ouvrage est disponible sur l’Internet sous forme
de livre électronique contre paiement d’un droit d’accès de 10,67 euros.
Ce droit d’accès permet de parcourir le livre en ligne, mais pas de l’imprimer.
Il s’agit d’un bon exemple de la protection technologique sur l’Internet.
Source : http://upo.unesco.org/ebookdetails.asp?id=3004
[276] Ces données ont été obtenues auprès de
l’Association nationale indienne des sociétés de logiciels et de services (National Association of Software and Service
Companies - NASSCOM) http://www.nasscom.org/it_industry/sw_industry_home.asp
[278] Story, A. (2002) p. 53.
[279] Banque mondiale (1999) « Rapport sur le développement dans le monde
1998-1999 : le savoir au service du développement », Banque
mondiale, Washington DC, p. 14. Source : http://www.worldbank.org/wdr/wdr98/
[281] Pour un historique du Protocole et de
l’Annexe, voir Ricketson, S. (1987) « The
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986 »,
Kluwer, Londres, Chapitre 11.
[282] Ricketson, S. (1987), p. 591.
[283] Par exemple, Business Software Alliance
estime qu’en 2000, les niveaux de contrefaçon de logiciels informatiques
atteignaient respectivement 97 % et 94 % au Vietnam et en Chine.
Business Software Alliance (2001) « Sixth
Annual BSA Global Software Piracy Study », BSA. Source : http://www.bsa.org/resources/2001-05-21.55.pdf
[284] Par exemple, l’Amérique du Nord, l’Europe
occidentale et le Japon représentent à eux seuls plus de 65 % des pertes de
recettes mondiales résultant de la contrefaçon de logiciels informatiques,
Business Software Alliance (2001). Il convient de noter que la méthodologie de
ces études a été critiquée. Leur description indique qu’elles sont fondées sur
l’écart entre l’estimation du nombre de logiciels installés et l’estimation de
la fourniture licite, évaluées aux prix de la fourniture licite. Il n’est fait
aucune mention du fait que, en l’absence de « piraterie », les ventes
licites supplémentaires auraient nécessairement été bien inférieures. Sur ce
fondement, certains ont allégué que ces chiffres constituent des surestimations
substantielles des pertes de revenus commerciaux.
[285] L’éventail et le nombre de ces
initiatives les rendent impossibles à décrire toutes ici, mais l’exemple le
plus réputé est peut-être l’Interréseau-Santé Initiative d’accès aux recherches
(HINARI) parrainé par l’OMS, qui offre à 100 pays en développement un accès en
ligne gratuit à 1 000 grands périodiques médicaux environ. Pour une liste
plus complète d’initiatives d’accès de ce type pour les pays en développement,
voir : http://www.alpsp.org/htp_dev.htm ou http://www.library.yale.edu/~llicense/develop.shtml
[286] Rapport du comité constitué sous la
présidence de M. le juge Whitford pour examiner la législation relative au
droit d’auteur et aux dessins et modèles, le Whitford Report, présenté au
Parlement britannique en 1977 ; décision provisoire rendue par le tribunal
britannique compétent en matière de droit d’auteur dans l’affaire Universities
UK c. CLA en septembre 2001 Source : http://www.patent.gov.uk/copy/tribunal/uukvcla.pdf
[288] Altbach, P. (1995) « Copyright and Development: Inequality in the
Information Age », Bellagio Publishing Network, Boston MA ; et Bgoya,
W. et al (1997).
[290] Pendant les années 1980, les dépenses
publiques par étudiant de l’enseignement tertiaire en Afrique subsaharienne ont
chuté de 6 300 dollars à 1 500 dollars en termes réels, et
les années 90 ont été témoins d’un nouveau recul estimé à 30 %. Saint, W.
(1999) « Enseignement tertiaire à
distance et technologie en Afrique subsaharienne », Groupe de travail
sur l'enseignement supérieur de l’ADEA, Washington DC.
[291] Par exemple, selon l’UNESCO (1998), la
Banque mondiale a accordé un prêt de 15,8 millions de dollars au
gouvernement sénégalais pour l’amélioration des services bibliothécaires de
l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar.
[292] Par exemple, à l’Université de Dar es
Salaam en Tanzanie, des classes de 100 étudiants se partagent souvent un exemplaire
unique d’un manuel dans la bibliothèque et les collections de manuels ont
souvent deux éditions de retard. Rosenberg, D. (1997) « University Libraries in Africa: A Review of their Current State and
Future Potential », International African Institute, Londres.
[293] UNESCO (1998), chapitre 4.
[294] Voir « Journal Wars » The
Economist, 10 mai 2001.
[295] Altbach, P. (1995), p. 7.
[296] Il est peu probable que cette situation
change rapidement. Il existe des barrières considérables non liées à la PI, qui
empêchent les sociétés de logiciels des pays en développement de pénétrer le marché des produits prêts à l'emploi à
un niveau significatif, du moins à court et moyen termes. Ces barrières
comprennent la taille réduite du marché intérieur des pays en développement, qui
s’élève au total à moins de 5 % du marché mondial des logiciels. OCDE
(2000) « Perspectives des technologies de l'information 2000 »,
OECD, Paris, p. 67. Source : http://www.oecd.org/dsti/sti/it/prod/it-out2000-e.htm
[297] A titre d’exemple, la suite de logiciels
de gestion « StarOffice », produite par Sun Corporation, présente une
interopérabilité intégrale avec le produit « Office » très populaire
de Microsoft et peut être téléchargée gratuitement depuis le site web de la
société.
[298] Voir la définition dans le glossaire.
[299] Un exemple célèbre de logiciel libre est
« Linux », système d’exploitation de type Unix pour les ordinateurs
personnels, développé à l’Université d’Helsinki en 1991 et disponible
gratuitement. Linux est distribué avec son code source sous une « licence
publique générale ».
[300] Lyman, P. (1996) « What is a Digital
Library? Technology, Intellectual Property, and the Public Interest », Daedalus: Journal of the American Academy of
Arts and Sciences, vol. 125 No. 4, p. 12.
[301] Pour de plus amples informations, voir www.avu.org
[307] Lettre à Robert Hooke, 5 février 1676.
[308] Merges et Nelson (1990), p. 916.
[309] Voir la définition dans le glossaire.
[311] « Recherche de rente » est une
expression employée par les économistes pour désigner la manière dont les
acteurs du marché peuvent percevoir les incitations perverses (du point de vue
social) créées par les « rentes monopolistiques » résultant de
diverses interventions de l’Etat sur le marché. Les DPI sont un exemple de ces
interventions. Le texte fondamental est : Krueger, A (1974) « The Political Economy of the Rent-Seeking
Society », American Economic Review, 291-303 Vol. 64 (3) pp.
291-303.
[314] Par exemple CNUCED (1996) « The TRIPS Agreement and Developing Countries »,
CNUCED, Genève, Document N° UNCTAD/ITE/1 ; Correa, C. (2000) « Intellectual Property Rights, The WTO and
Developing Countries », Zed Books, Londres et Third World Network,
Penang ; Heald, P. (2002) « Intellectual Property Strategies for
Developing Countries: Flexibility, Leverage, and Self Help Within the Framework
of the TRIPS Agreement » (polycopié).
[315] Accord sur les ADPIC, article 27.1.
[316] Par exemple, l’article 54, paragraphe 5,
de la CBE prévoit que la condition de nouveauté n'exclut pas la brevetabilité,
pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à l'article 52, paragraphe 4,
d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition
que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas
contenue dans l'état de la technique. Les tribunaux ont également décidé que la
deuxième indication thérapeutique et les applications ultérieures de composés
connus sont également autorisées. Pour parvenir à ces décisions, les tribunaux
ont adopté « un concept de l’état de la technique non habituel »,
Décision de l’OEB G83/0005. Source : http://legal.european-patent-office.org/legal/epc/gdechtml/en/g583.htm
[317] Ainsi qu’il est permis aux termes de
l'article 27.3, alinéas b) et a) respectivement, de l’Accord sur les ADPIC.
[319] Nous avons reçu des soumissions à ce
sujet de plusieurs ONG qui aimeraient une modification de l’Accord sur les
ADPIC concernant les brevets sur les organismes vivants.
[321] Les articles 5 et 6 de la directive
européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
(Directive 98/44/CE) limitent les brevets liés au matériel génétique humain et
animal.
[322] Article 56 CBE, 35USC S103. Aux termes de
la CBE, un homme du métier est présumé être un technicien ordinaire normalement
doté des connaissances communes générales de son métier, mais incapable
d’activité inventive. La pratique canadienne parle d’une personne « versée
dans le domaine mais n'ayant aucune imagination ou esprit inventif ; un
modèle de déduction et de dextérité, complètement dépourvu d'intuition ;
un triomphe de l'hémisphère gauche sur l’hémisphère droit ». Beloit Canada Ltd c. Valmet
OY 1986, 8 CPR (3d) 289
[325] Décision d’opposition de l’OEB révoquant
le brevet EP0630405 (ICOS Corporation), 20 juin 2001 (non publiée).
[327] Biogen Inc c. Medeva plc Chambre des
Lords (House of Lords) [1997] RPC 1.
[328] Conseil Nuffield sur la bioéthique (2002)
pp. 73-74.
[329] Au Japon, toute personne peut déposer une
opposition contre la délivrance d’un brevet dans les six mois suivant la date
de publication du brevet. Devant l’OEB, le délai de dépôt des oppositions
commence après la délivrance des droits au titre du brevet et dure neuf mois.
Devant l'USPTO, un réexamen du brevet peut être demandé lorsque des questions
de brevetabilité significatives surviennent à tout moment de la durée du
brevet. Des procédures d’opposition avant la délivrance du brevet existent en
Indonésie en vertu de l’article 45 de la loi sur les brevets (N° 14, 2001) et
dans la Communauté andine en vertu de l’article 42 de la Décision 486 du 14
septembre 2000.
[330] Scherer, F.M. (2001) « The Patent
System and Innovation in Pharmaceuticals », Revue internationale de droit économique, (Edition spéciale, «
Pharmaceutical Patents, Innovations and Public Health »), p. 119.
[331] Par exemple, les articles 48 et 49 de la
loi chinoise de 2000 sur les brevets prévoient qu’une licence obligatoire peut
être concédée à une entité qui a fait des demandes d’autorisation auprès du
titulaire d’un brevet d’invention afin d’exploiter son brevet à des conditions
raisonnables et dont les efforts n’ont pas été couronnés de succès dans un
délai raisonnable, ou lorsque l’intérêt public l’exige.
[333] Une procédure de règlement des différends
de l’OMC (IP/D/23), qui aurait pu clarifier la compatibilité des prescriptions
en matière d’exploitation locale avec l’Accord sur les ADPIC, s’est conclue
avant qu’un Groupe spécial ait pu donner son opinion. Source : http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/G/L/385.DOC
[335] Correa, C. (à paraître) « Protection and promotion of traditional
medicine », South Centre, Genève.
[336] L’article 62 de l’Accord sur les ADPIC
autorise les Membres à exiger, comme condition de l’acquisition de DPI, que soient respectées des procédures raisonnables.
Dans le règlement du différend de l’OMC relatif à l’article 211 de la loi
générale des Etats-Unis portant ouverture de crédits, le Groupe spécial a noté
que l’Accord sur les ADPIC n'interdisait pas aux Membres de refuser
l'enregistrement d'une marque au motif que le déposant n'est pas le titulaire
de la marque tel qu'il est défini dans leur système juridique national
respectif (paragraphe 8.56 du Document OMC N° WT/DS176/R). Il semblerait que
ceci s’applique également dans le cas des brevets.
[338] Dans certains pays, par exemple
l’Allemagne, le niveau d’activité inventive requis pour obtenir un modèle
d’utilité est le même que pour un brevet normal.
[339] Voir le Chapitre 1.
[344] Informations fournies par l’OMPI, tirées
des statistiques de demandes de 2001.
[345] Dasgupta, P. et David, P. (1994)
« Towards a New Economics of Science », Research Policy, vol. 23, pp. 487-521.
[349] Association des responsables de
technologie des universités (2002), p.10.
[351]
Colyvas, J. et al (2002).
[354] Sampaio, M. et Brito da Cunha, E.
« Managing Intellectual Property in Embrapa: A Question of Policy and a
Change of Heart », dans Cohen, J. (ed.) (1999) « Managing Agricultural Biotechnology: Addressing Research Program Needs
and Policy Implications », ISNAR/CABI, La Haye, pp. 240-248.
[356] Shapiro, C. « Navigating the Patent
Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting », dans Jaffe,
A., Lerner, J. et Stern, S. eds. (2001) « Innovation Policy and the Economy: Volume I », MIT Press,
Cambridge MA, p. 3. Source : http://haas.berkeley.edu/~shapiro/thicket.pdf
[357] Témoignage du 28 février 2002.
Source : http://www.ftc.gov/opp/intellect/barrrobert.doc
[362] Walsh. J. et al (2000) p. 31.
[363] Présentation donnée par Greg Galloway
(Falco-Archer) à la Conférence de la Commission, Londres, 21-22 février
2002 ; et présentation donnée par Melinda Moree (PATH) à l’Atelier de la
Commission sur les instruments de recherche, Londres, 22 janvier 2002.
Source : http://www.iprcommission.org
[364] Exemples tirés d’une présentation de
Victoria Henson-Appolonio à l’Atelier de la Commission sur les instruments de
recherche, Londres, 22 janvier 2002.
Source : http://www.iprcommission.org
[365] Kryder, R., Kowalski, S. et Krattinger, A. (2000) « The Intellectual and Technical Property
Components of Pro-Vitamin A Rice (Golden Rice): A Preliminary
Freedom-to-Operate Review », ISAAA Briefs N° 20, Service international
pour l'acquisition des applications d'agro-biotechnologie, New York.
Source : http://www.isaaa.org/publications/briefs/Brief_20.htm
[368] SNP est l’acronyme anglais de
polymorphisme d’un seul nucléotide (single nucleotide polymorphism). Ce sont
des variations des blocs de construction de base de l’ADN (une seule paire de
base) qui peuvent être rattachés à la cause de maladies, ou autre mutations
génétiques.
[371] Centre pour l’application de la biologie
moléculaire à l’agriculture internationale (Center for the Application of Molecular Biology to
International Agriculture - CAMBIA). Source : http://www.cambia.org/
[376] Un système fondé sur le principe du
premier déposant délivre un brevet à la première personne qui dépose une
demande de brevet. La grande majorité des pays opère déjà un tel système. Les
Etats-Unis, en revanche, utilisent un système fondé sur le principe du premier
inventeur, selon lequel le brevet appartient à la première personne qui a
réalisé l’invention.
[378] Il convient d’observer que de nombreux
pays développés trouvent également difficile de coordonner la politique de PI,
mais que ces difficultés ne sont généralement pas aggravées par un manque de
connaissances techniques spécialisées.
[379] Pour une étude de cas intéressante dans
le domaine des ressources phytogénétiques, voir Petit, M. et al (2001) « Why Governments Can’t Make Policy: The Case
of Plant Genetic Resources in the International Arena », CIP, Lima.
Source : http://www.cipotato.org/market/whygov/FlyerGR1.pdf
[380] Entre janvier 1996 et décembre 2000, 119
pays en développement et organisations régionales ont bénéficié d’une
assistance de l’OMPI par le biais de la préparation de projets de lois en
matière de PI. Voir OMPI (2001a) « WIPO’s
Legal and Technical Assistance to Developing Countries For the Implementation
of the TRIPS Agreement From January 1 1996 to December 31 2000 »,
OMPI, Genève. Source : http://www.wipo.org/eng/meetings/2000/ace_ip/pdf/wipo_trips_2000_1.pdf
[381] Drahos, P. (2002) « Developing Countries and International
Intellectual Property Standard-Setting », Commission Background Paper
8, Londres, p. 21. Source : http://www.iprcommission.org
[382] Institute for Economic Research (1996)
« Study on the Financial and Other
Implications of the Implementation of the TRIPS Agreement for Developing
Countries », OMPI, Genève.
[384] A
la date de rédaction, le nombre d’Etats membres du système de Madrid (70 pays)
est très inférieur à celui des membres du PCT (115 pays).
[385] Selon le site web de l’OMPI, « WPIS offre à un large éventail d’utilisateurs des pays en
développement une voie d’accès aux offices de propriété industrielle des pays
qui ont accepté d’aider à effectuer ces recherches. Les recherches sont
gratuites pour ceux qui les demandent. Pour certaines demandes de recherche,
par exemple celles de l’ARIPO, l’examen est également assuré. Depuis le début du
programme en 1975 jusqu’à la fin du mois de juillet 2001, près de 15 000
demandes de recherche ont été traitées gratuitement, émanant de plus de 90 pays
en développement et de 14 organisations intergouvernementales et pays en
transition. En 2000, 1 315 demandes de recherche ont été reçues de
39 pays en développement. Ces rapports couvrent également les demandes
spéciales de recherche de la nouveauté et d’examen quant au fond concernant la
brevetabilité des demandes de brevets dans les pays en développement, ainsi que
les demandes spéciales de recherche et d’examen des demandes de brevets
déposées par l’ARIPO. Au début des années 90, la majorité des demandes
provenaient d’utilisateurs de la région Asie et Pacifique ; plus
récemment, les utilisateurs des pays d’Amérique latine sont devenus plus
actifs ».
[386] Pour une explication plus détaillée des
systèmes régionaux de propriété intellectuelle de l’ARIPO et de l’OAPI, voir
Leesti, M. & Pengelly, T. (2002) « Institutional
Issues for Developing Countries in Intellectual Property Policymaking,
Administration and Enforcement », Commission Background Paper 9,
Londres, pp. 38-39. Source : http://www.iprcommission.org
[387] CNUCED (1996) « The TRIPS Agreement and the Developing Countries », CNUCED,
Genève.
[391] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), p.
109.
[392] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002),
Section 3.5.
[393] Par exemple, il a été estimé que les
niveaux de contrefaçon des logiciels informatiques au Vietnam et en Chine
atteignaient respectivement 97 % et 94 % en 2000. Business Software
Alliance (2001) « Sixth Annual BSA
Global Software Piracy Study », BSA. Source : http://www.bsa.org/resources/2001-05-21.55.pdf
[394] Par exemple, l’Amérique du Nord, l’Europe
occidentale et le Japon comptent à eux seuls pour plus de 65 % du manque à
gagner mondial issu de la contrefaçon de logiciels d’ordinateur, Business
Software Alliance (2001).
[395] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), p.
95.
[396] Aux Etats-Unis par exemple, les tribunaux
appliquent un test quadripartite classique relevant de la théorie de l’équité
pour décider de la délivrance ou non d’une injonction préliminaire, dont une
analyse de la probabilité raisonnable de confirmation de la validité d’un
brevet si celle-ci était contestée par le défendeur. Ce système présume qu’un
préjudice sera causé au titulaire des droits, mais compare ce préjudice à celui
que le contrevenant présumé subira si l’injonction est délivrée à tort. L’effet
sur l’intérêt public (par exemple, l’accès à des médicaments) de la délivrance
d’une injonction est également pris en compte. Les injonctions ne sont
accordées que très exceptionnellement sans entendre les parties. Voir Chisum, D. (2000) « Chisum on patents. A treatise of the law of
patentability, validity and infringement », Lexis Publishing,
Etats-Unis.
[398] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), p.
32.
[399] Correa, C. (1999), p. 1.
[400] Les 530 millions de francs suisses
de recettes totales prévues de l’OMPI pour 2002-2003 comprennent plus de 455
millions de francs suisses de recettes issues des redevances.
[401] Si
les taxes du PCT étaient simplement restées au niveau des deux années 1996 et
1997 (plutôt que d’être considérablement réduites), les prévisions de recettes
issues des taxes du PCT pour les deux années 2002 et 2003 auraient été supérieures de 279 millions de francs, voir OMPI (2001b).
[402] Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), p.
44
[404] Voir Encadré O.1 de la partie intitulée
Vue d’ensemble qui porte sur l’Accord sur les ADPIC.
[408] Voir l’article 4 de la Convention.
[411] C’est également l’opinion de l’OMS et de l’UE qui ont publié une
déclaration conjointe à la suite d’une réunion qui s’est déroulée à Bruxelles
le 6 juin 2002 : « L’OMS cherchera
également à collaborer étroitement, dans les domaines appropriés, avec l’OMC et
l’OMPI, sur l’aide technique à apporter aux pays en développement appliquant
l’Accord sur les ADPIC en suivant les orientations de la Déclaration de
Doha. » Source : http://www.who.int/inf/en/cp-2002-45.html
[413]
Par exemple, Correa, C. (2000) « Intellectual
Property Rights, the WTO and Developing Countries: the TRIPS Agreement and
Policy Options », Zed Books, New York & Third World Network, Penang.
[414]
Voir Thorpe, P. (2002) « The
Implementation of the TRIPS Agreement by Developing Countries », Commission
Background Paper 7, Londres. Source
: http://www.iprcommission.org
[417] La loi
type mise à jour, tout en constituant certainement une amélioration par
rapport à la précédente version que nous avons vue, n’aborde toujours pas
spécifiquement certaines questions clés ni dans le texte ni dans le commentaire
d’accompagnement. Il s’agit notamment de la brevetabilité des programmes
d'ordinateur ou de matières biologiques comme les gènes et tout autre matériel
pré-existant dans la nature. Nous voudrions suggérer par exemple que la loi
souligne, tout au moins dans les notes explicatives qui l’accompagnent, les
différentes positions adoptées également sur d’autres questions telles que les
droits des agriculteurs, les droits concernant la production de matériel
breveté et d’autres exceptions aux droits de brevet, comme par exemple les
utilisations éducatives. Les différentes raisons pour lesquelles certains pays
prévoient des licences obligatoires pourraient également être examinées, sous
réserve bien sûr de toute restriction nécessaire concernant une éventuelle
incompatibilité avec des accords internationaux. D’autres questions pourraient
également être abordées plus ouvertement, notamment les interprétations
possibles de la nouveauté, de l’activité inventive et de l’applicabilité
industrielle (voir Chapitre 6) et la divulgation de l’origine de la matière
biologique (Chapitre 4).
[418] Article 66.1 de l’Accord sur les ADPIC.
[419]
Voir Lall, S. & Albaladejo, M. (2001) « Indicators of the Relative Importance of IPRs in Developing Countries
», CNUCED/ICTSD, Genève. Source : http://www.ictsd.org/unctad-ictsd/docs/Lall2001.pdf. Ce rapport présente diverses mesures de
la capacité scientifique et technique des pays en développement.
[420]
Drahos, P. (2001) « Developing Countries
and International Intellectual Property Standard-Setting », Commission
Background Paper 8, Londres. Source
: http://www.iprcommission.org
[421] La loi américaine sur le commerce de 2002 (pouvoir de négociation prévu par la
procédure accélérée), HR3009, déclare :
« Les principaux objectifs de négociation des
Etats-Unis concernant la propriété intellectuelle liée au commerce sont :
A) d’encourager davantage une protection suffisante et
efficace des droits de propriété intellectuelle, par les moyens suivants :
i) I) garantir une
mise en oeuvre accélérée et complète de l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce mentionné à la section 101 d)
15) de la loi relative aux accords du Cycle d’Uruguay (19 U.S.C. 11 3511d)15)), notamment le
respect des obligations d’application assumées au titre du présent accord ; et
II) garantir que
les dispositions de tout accord commercial multilatéral ou bilatéral régissant
les droits de propriété intellectuelle signé par les Etats-Unis traduisent une
norme de protection semblable à celle qui est accordée par la législation
américaine ;
ii) fournir une solide protection aux technologies
nouvelles et émergentes et aux nouvelles méthodes de transmission ou de
distribution des produits contenant une propriété intellectuelle ;
iii) prévenir ou éliminer toute discrimination relative aux
questions affectant la disponibilité, l’acquisition, la portée, le maintien,
l’utilisation et le respect des droits de propriété intellectuelle ;
iv) garantir que les normes de protection et leur
application suivent le rythme de l’évolution technologique, et en particulier
faire en sorte que les détenteurs de droits soient dotés des moyens juridiques
et technologiques nécessaires pour contrôler l’utilisation de leurs œuvres par
l’Internet et tout autre moyen de communication mondial et pour empêcher leur
utilisation non autorisée ;
v) faire respecter strictement les droits de propriété
intellectuelle, y compris au moyen des mécanismes de droit civil administratif
et pénal accessibles, rapides et efficaces ;
B) de s’assurer de possibilités d’accès au marché loyales,
équitables et non discriminatoires pour les ressortissants des Etats-Unis qui
comptent sur une protection de la propriété intellectuelle ;
C) de respecter la Déclaration de l’Accord sur les ADPIC et
la santé publique, adoptée par l’Organisation mondiale du commerce à la quatrième
Conférence ministérielle de Doha (Qatar) le 14 novembre,
2001.
Source : http://waysandmeans.house.gov/
[423] Il s’agit là de la politique actuelle du
représentant du ministère du Commerce des Etats-Unis, comme on peut le voir
dans la loi sur le commerce de 2002.
[424]
Weekes, J. et al (2001) « A Study on
Assistance and Representation of the Developing Countries without WTO Permanent
Representation in Geneva », Commonwealth Secretariat, Londres.
[425] L’étude du Secrétariat du Commonwealth a estimé que les frais totaux
d’établissement et de fonctionnement d’une mission de 3 ou 4 personnes à Genève
représentent environ 340 000 dollars par an.
[426]
Michalopoulos, C. (2001) « Developing
countries in the WTO », Palgrave, Londres.
[427] Les Assemblées des Unions établies en
vertu du PCT et l’Arrangement de Madrid, deux traités administrés par l’OMPI,
ont convenu de financer les frais de voyage et de séjour d’un représentant
gouvernemental de chaque Etat membre à leurs réunions siégeant en session
ordinaire ou extraordinaire. De plus, à la suite d’une décision prise à
l’Assemblée des Etats membres de l’OMPI en 1999, l’OMPI finance la
participation de 26 fonctionnaires gouvernementaux de différents pays en
développement et en transition (cinq représentants de chacune des régions
suivantes : Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, pays arabes, certains
pays d’Asie et d’Europe, plus un représentant de Chine) pour assister aux
réunions d’un choix de commissions (traitant des brevets, des marques, du droit
d’auteur et des savoirs traditionnels). Voir Leesti, M. & Pengelly,
T. (2002) « Institutional Issues for
Developing Countries in Intellectual Property Policymaking, Administration and
Enforcement », Commission Background Paper 9, Londres, note 17. Source : http://www.iprcommission.org
[428]Par exemple, la CNUCED, en collaboration
avec le Centre international du commerce et du développement durable, élabore à
l’heure actuelle un projet visant à fournir aux pays en développement un manuel
sur l’application de l’Accord sur les ADPIC et sur les réexamens futurs de cet
Accord. Ce projet est financé par le ministère britannique du Développement
international. Voir Leesti, M. & Pengelly, T. (2002), pp. 39-41.